
Le Bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh
Quand j’emprunte cette bande-dessinée, je me fais la réflexion que le titre plairait à Michel Pastoureau : le bleu n’a pas toujours été une couleur froide ; ce serait même historiquement assez récent. J’avais complètement oublié que La Vie d’Adèle était tirée de cette bande-dessinée ; il a fallu la mention des spaghettis bolognaises pour que les vagues soupçons coagulent en une révélation horrifiée : quoi, c’est cette magnifique bande-dessinée que’Abdellatif Kechiche prétend avoir adaptée ? Là où le film n’est que pleurnicheries et sensibleries, le dessin révèle sensibilité et vulnérabilité. Le récit en flash-back, qui démarre après la mort de Clémentine (Adèle), n’y contribue pas peu en donnant de suite le ton ; dans le film, où le récit n’est pas encadré, toute tentative de gravité tourne à la grandiloquence. Mais brisons là la comparaison.
La bande-dessinée de Julie Maroh nous fait suivre le cheminement d’une jeune fille qui découvre des désirs par lesquels elle n’aurait jamais imaginé être concernée. C’est d’autant plus dur à assumer que la société, à commencer par ses parents, craint voire rejette l’homosexualité (facile à oublier quand on fait partie des classes moyennes et supérieures parisiennes). Pour autant, le récit ne se focalise pas sur les difficultés ou les luttes des LGBT : ça, c’est la perspective d’Emma, la fille aux cheveux bleus sur laquelle fantasme Clémentine ; Clémentine, elle, voudrait juste être heureuse. Avec Emma.
Le récit tire sa richesse de se concentrer sur cette relation, où leurs peurs et leurs attentes vont sans cesse à contretemps : peur du regard des autres pour Clémentine (se faire traiter de gouine), peur de l’abandon pour Emma (et si Clémentine se barrait avec le premier garçon venu ? veut-elle vraiment quitter sa copine pour cette gamine ?), quête d’amour pour Clémentine, enfin, qui exige l’attention pleine et entière de celle à qui elle s’offre, et qui se dérobe.
C’est fin et émouvant. Oui, le bleu peut être une couleur chaude.

La Technique du périnée, de Ruppert & Mulot
Depuis la découverte de Fraise et chocolat, j’ai un goût marqué pour les bande-dessinées où il est question de sexe. Le dessin s’offre comme le médium parfait pour ça, sans la crudité de la vidéo ni l’écartèlement du langage entre vocabulaire anatomique aseptisé et vulgarité limite comique. Des traits et hop, le sexe prend corps. Dans La Technique du périnée, il se fait carrément décor : une métaphore assez géniale figure l’acte amoureux comme une immense falaise rectangulaire de laquelle les amants se jettent, et à laquelle ils se rattrapent en cours de route pour faire durer le plaisir, jusqu’à faire plouf dans la petite mort. Les dialogues sont simples, crus, mais la mise en scène, d’une grande poésie. C’est juste un peu dommage qu’un tel univers érotique-onirique débouche sur une intrigue plutôt plan-plan (les relations virtuelles-charnelles, l’amour qu’on tient à distance en se cachant derrière le cul…). Mais rien que pour les images métaphoriques, ça vaut le coup d’un soir.
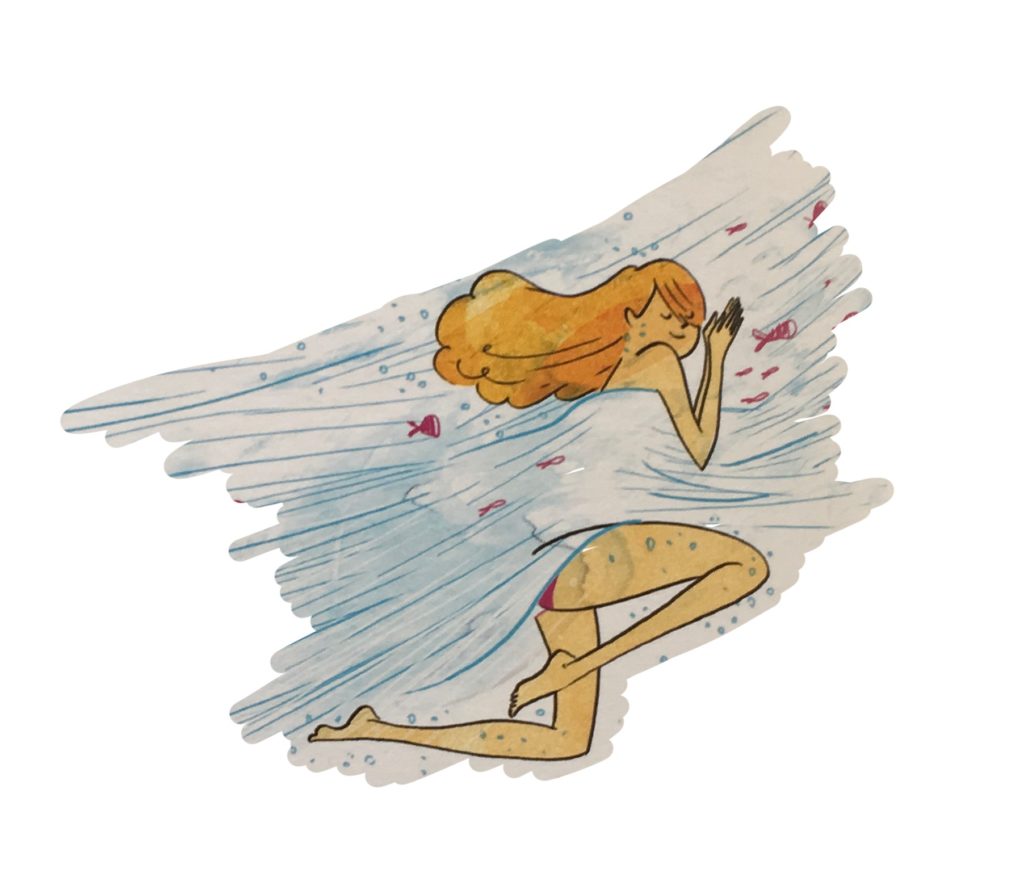
Tout est possible mais rien n’est sûr, de Lucile Gomez
Le dessin des figures me fait d’abord penser à Pénélope Bagieu : on se croirait dans Joséphine lorsque l’héroïne prend un boulot d’hôtesse d’accueil en attendant de réussir à vivre du dessin. Mais là où le récit de Joséphine bascule dans une fiction farfelue, celui de Lucile Gomez reste au contraire ancré dans les préoccupations de la nouvelle génération – essentiellement : la conscience écologique et les contraintes économiques, que l’on peine à articuler au quotidien, entre bullshit jobs, chômage et réalisation de soi.
L’album vaut moins pour les réflexions abordées (la fougue et la naïveté des personnages est parfois un peu agaçante) que pour l’expression graphique d’un imaginaire. La tension de l’héroïne entre aspiration personnelle et norme rémunératrice se retrouve dans le dessin, qui s’ancre dans les sentiers battus de la bande-dessinée-de-blogueuse et s’en échappe, plus ou moins franchement, avec plus ou moins de cohérence graphique, pour taquiner l’illustration, avec beaucoup d’humour et de poésie : c’est une couette qui devient rivière, une fourmi reprenant corps comme secrétaire d’une administration labyrinthique, ou encore des étoiles devenues points à relier en clin d’œil à Magritte (le « désir » de l’étoile perdue a été remplacée par la « réussite » tant désirée).

La Page blanche, de Boulet (scénario) et Pénélope Bagieu (dessin)
Une jeune femme s’apprête à repartir du banc sur lequel elle se trouve, quand elle s’aperçoit que, trou noir, page blanche, elle ne sait plus où elle habite ni qui elle est. La Page blanche est l’histoire de sa quête d’identité, entre recherches méthodiques (avec une timeline dessinée sur le mur comme lorsque les héros de séries policières cherchent les serial killers), quiproquos comiques (Chester ne serait pas le nom de son mec mais… de son chat) et scénarios délirants (et si elle avait été le cobaye d’extraterrestre ? une ancienne agente secrète mise en sommeil à la fin de sa mission ?).
La chute est à la hauteur de l’enquête, et même mieux que cela : en se refusant à toute révélation fracassante, elle transforme l’amnésie de son personnage en métaphore existentielle, ou peut-être même pas, nous renvoyant seulement au plaisir de la lecture après avoir épinglé notre désir de clôture, comme ça, mine de rien, sous le trait faussement frivole mais réellement drôle de Pénélope Bagieu. Moralité de la page blanche : ne pas attendre de savoir qui l’on est pour commencer à la remplir ; cela viendra chemin faisant.

Il était une fois dans l’Est (tome 1), de Clément Oubrerie (dessin) et Julie Birmant (scénario)
J’ai embarqué l’album parce qu’il était question d’Isadora Duncan, mais j’ai rarement vu un récit si mal construit. On évitera le tome 2.
