Dans Call me by your name, Elio fait remarquer à la table du déjeuner qu’il trouve prétentieuse la manière qu’a de prendre congé le nouvel assistant de son père, d’un later lapidaire. Je me suis rendue compte seulement à ce moment que ce later n’était pas une injonction à remettre les choses à plus tard, comme je l’avais cru, mais l’abréviation de See you later (à bientôt). Il n’empêche : il reste dans ce raccourci quelque chose du geste par lequel on chasse mouche et laquais. Ce n’est pas une impolitesse à proprement parler (c’était un contresens de non-native), mais une forme d’indélicatesse qui, comme Elio, me choque un peu. La personne qui le prononce semble moins prendre congé que congédier la compagnie qu’elle quitte. Later, et on se retrouve planté là.

Il me semble que cette perception tient moins au degré d’étrangeté de la langue (Elio est trilingue) qu’à une sensibilité – à l’attention. Personne n’aime se faire snober, mais certains sont plus prompts que d’autres à se sentir négligés et à prendre ombrage d’un départ précipité. Je fais partie des gens qui n’aiment pas le moment de se quitter : je ne parle pas de rupture ou d’adieux, pas même de séparation ou d’au revoir ; juste du moment banal où l’on prend congé les uns des autres pour aller vaquer à d’autres occupations, ce moment de transition où l’on passe de la compagnie à la solitude, ou même d’une compagnie à une autre.
Quand j’allais un week-end sur deux chez mon père, il y avait toujours un bref moment de transition désagréable. À l’aller, l’inconfort amoindri par le plaisir de sortir de cours et de savoir l’étendue du week-end à venir : l’odeur de cigarette dans laquelle je m’immergeais en montant dans la voiture de mon père (qui pourtant n’y fumait pas), puis les horaires de repas décalés, la faim souvent là trop tôt ou plus du tout, et des sorties toujours (auxquelles j’ai fini par avoir le droit de couper) ou des amis à table, à l’apéro, tout un monde d’extraversion qui me divertissait autant qu’il me bousculait. Au retour : le blues du dimanche soir après avoir chanté et soupiré dans les embouteillages (j’avais trop peur à moto, même au ralenti autour du pâté de maison), le calme morne de l’intérieur impeccable et de la semaine d’école à venir, mon introversion naturelle qui me semblait soudain un peu austère. Je ne préférais pas être chez l’un ou chez l’autre de mes parents ; je n’aimais juste pas changer : le moment de retrouver l’un était celui de quitter l’autre. Pourtant, ça ne durait pas : arrivée chez mon père, je me précipitais pour ouvrir les portes de l’immense garde-manger pour voir de quoi j’allais pouvoir me régaler et je montais dans ma chambre retrouver ma barre de danse et mes encres de calligraphie ; de retour chez ma mère, je retrouvais le cocon de mes affaires, les travaux manuels laissés en plan, mon petit bureau blanc au bordel réconfortant, et le film du soir pelotonnée dans le canapé en essayant de me faire oublier pendant les publicités pour ne pas aller au lit avant de voir la fin. Deux rythmes de joies ordinaires, et au milieu, ce petit pincement du temps, que je n’allais pas jusqu’à redouter, mais devant lequel je renâclais. Mes pas envie s’y enroulaient.
Je retrouve un semblable pincement du temps aujourd’hui, quand je rentre chez moi seule après avoir passé un moment avec Palpatine. Ni lui ni moi ne partons souvent de chez l’autre pour rentrer directement chez nous ; il y a une certaine violence à s’extraire d’une compagnie agréable, et un arbitraire contre lequel on se rebiffe mollement en traînant : pourquoi maintenant plutôt que dans quelques minutes ? Souvent, quand la rationalité exige que nous rentrions chacun de notre côté, nous sortons de concert : on se quitte plus naturellement après un film ou une promenade ; il n’y a pas l’un qui part et l’autre qui reste, chacun rentre chez soi.
Si nous faisons un bout de chemin ensemble et que l’un descend du métro ou du RER avant l’autre, alors c’est le jeu des regards en arrière : celui qui se retourne une fois de trop a perdu. Dans mon envie de grappiller encore un sourire, un regard, j’oublie le risque de me retourner sur une silhouette qui trace sa route. Le bonheur d’attraper des fossettes ou une main qui gigote ! C’est à vous faire retomber dans l’enfance du sentiment amoureux (le fameux c’est toi qui raccroches, auquel je ne crois jamais avoir joué – moi et le téléphone, ça fait deux). Et parfois, je perds : la silhouette ne se retourne pas ou, sommée intérieurement de reprendre une attitude adulte (indifférente, stoïque, je m’en-foutiste, rationnelle), j’ignore l’ironie tragique de nos retournements asynchrones, comme dans un bon mélo que je ne parviens pas à tourner. La sac à dos qui court prendre son train, c’est attendu, attendrissant même parfois ; mais la casquette qui marche régulièrement me renvoie ma solitude immédiate comme une solitude ancienne, bien ancrée dans ma vie, qui perdurera au-delà des moments partagés. Pendant un instant, plus ou moins bref, le temps se renverse, la perspective s’inverse : les moments de solitude ne sont plus des îlots sur une mer de partage ; c’est la mer, immense, qui entoure des îlots de chaleur humaine. Et ça ne l’est plus, je ne sais plus : la beauté et la tristesse au bord des lèvres, ça clignote, comme sur la carte en noir et blanc d’un archipel inconnu où l’on ne saurait plus ce qui est mer et ce qui est terre.
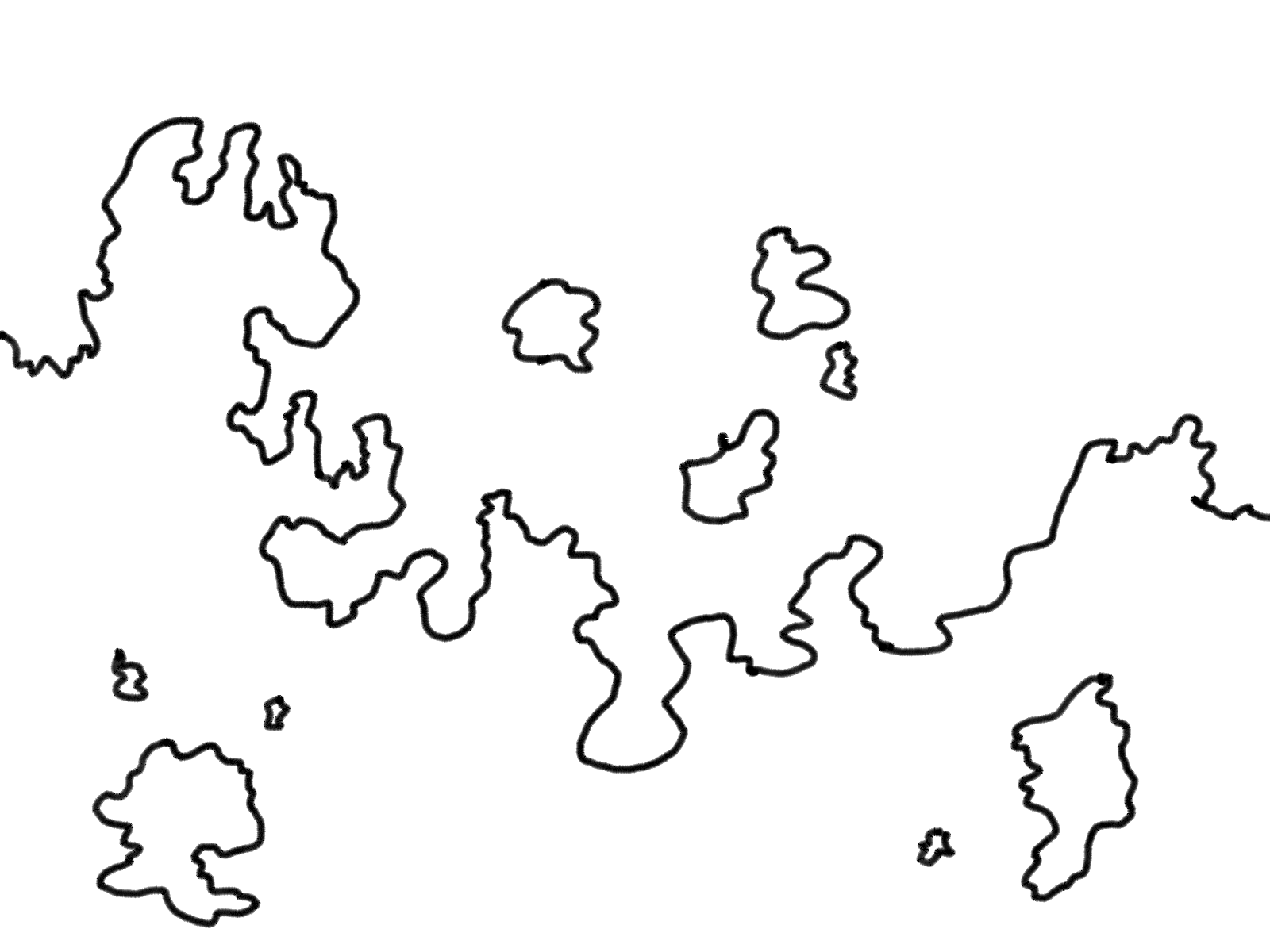
La solitude n’a plus rien à voir avec ça, c’est autre chose, entrevu, inconnu : l’isolement. Et cela passe comme ça, ou ça traîne un peu, une demie-heure peut-être, une peur vidée de toute anticipation et qui ne laisse plus que la nostalgie d’un chagrin que je n’ai pas connu. Puis je retrouve la solitude, ma solitude, celle que je chéris dans le pouvoir qu’elle a de me reconnecter aux autres en leur absence, et je suis heureuse d’être seule, alors. Écrire, dessiner, lire, rêver, je donne libre cours à mon introversion, à tout ce que je ne sais pas faire entourée et qui m’est essentiel, sans quoi je finirais par reprocher aux autres mon intériorité en jachère. Je me retrouve – dans l’intériorité des autres ; et c’est tout ce que j’ai ensuite envie de partager dans des discussions à n’en plus finir.
Je n’aime rien tant que les entrevues qui se prolongent, les goûters qui se transforment à l’improviste en dîner, parce que le temps s’est étiré dans la parole et la luminosité a changé. J’aime ce sentiment de satisfaction et de plaisir quand on découvre que l’autre personne est exactement dans les mêmes dispositions, qu’elle non plus n’a pas envie que ça se termine. C’est souvent là que l’intimité se dit, dans l’entre, entre-nous, entre-deux-repas ou rituels sociaux. Et ce qui enchaîne permet de poursuivre puis de refermer doucement ce moment à vif : l’essentiel a été dit, et entendu, il colore toutes choses à présent ; on peut revenir au contingent, aux détails qui en restent colorés : le quotidien s’entend au travers de chemins de vie, et les anecdotes n’ont plus tout à fait le caractère divertissant qu’elles avaient tantôt, quand il s’agissait de tâter le terrain, de voir du bout du pied si la conversation était assez nouée pour qu’on puisse s’y engager, là, sur le pont en corde qui relie deux intimités et dont on s’attend à tout instant qu’il rompe, comme dans les films d’aventures, au-dessus du précipice. La conversation qui s’éternise, c’est la possibilité de retraverser ce pont, apaisé. On renoue avec la terre ferme, le banal, le badin, qui ne tremble pas, redécouvrant que c’est agréable, aussi.
Lors d’une de ces conversations fleuve, j’ai parlé à Luce de ce pincement désagréable au moment de prendre congé ; elle aussi le connaissait. Ce n’était pas qu’un renchérissement amical : après dîner, elle m’a accompagnée jusqu’à la gare et, tandis que je descendais sur le quai deux minutes tout juste avant l’heure indiqué, je l’ai vue s’inventer une obligation qui fasse pendant en allant faire une course à la supérette de la gare. Je ne suis donc pas la seule à avoir ce genre de stratégie, pour briser là – et la glace qui se forme autour de soi dans ces moments de brusque refroidissement.
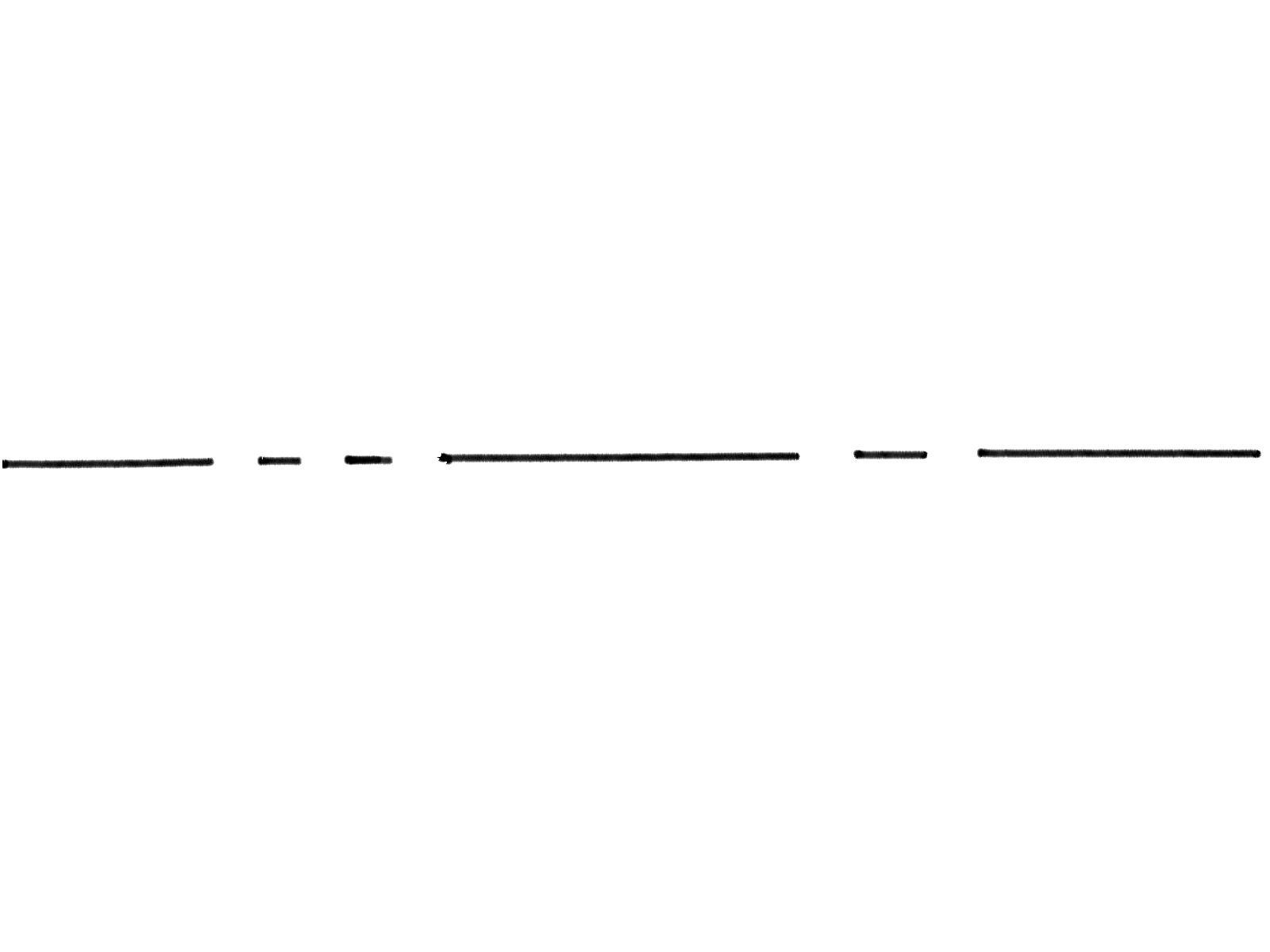 J’aimerais savoir éviter le pincement. Mieux : apprendre à éviter l’évitement. J’aimerais aimer les transitions : m’enthousiasmer spontanément pour ce qui vient au moins autant que je m’attriste de ce que je quitte ; apprécier qu’un moment, a fortiori un bon moment, n’existe jamais qu’en en abolissant un autre : il faut que les durées se concatènent. Il faut ne pas avoir peur d’ouvrir-clore pour que rien ne pince. Je veux apprendre ça, et cesser de ménager un temps propice à l’angoisse en m’accrochant à ce qui est déjà passé.
J’aimerais savoir éviter le pincement. Mieux : apprendre à éviter l’évitement. J’aimerais aimer les transitions : m’enthousiasmer spontanément pour ce qui vient au moins autant que je m’attriste de ce que je quitte ; apprécier qu’un moment, a fortiori un bon moment, n’existe jamais qu’en en abolissant un autre : il faut que les durées se concatènent. Il faut ne pas avoir peur d’ouvrir-clore pour que rien ne pince. Je veux apprendre ça, et cesser de ménager un temps propice à l’angoisse en m’accrochant à ce qui est déjà passé.
Mieux que les transitions inaperçues, je vise les transitions heureuses. J’en ai refait l’expérience il y a quelques mois, entraînée par qui y est habitué. La promenade post-brunch touchait à sa fin et je commençais à rallonger, parce que je peux tourner maintenant mais je tournerai au Truffaut, je t’accompagne jusque-là, hein. Pas loin de Truffaut, Éthyliszt a évoqué son chat, son plaid, la lecture et la tasse de thé qui l’attendait, et c’était fait : il avait pris congé et j’étais en train de remonter le boulevard menant jusque chez moi à grandes enjambées, pressée tout à coup de rentrer chez moi. Je ne le savais pas l’instant d’avant mais tout ce que je désirais, c’était ça : mon plaid, mes bouquins, une théière. J’étais contente de me retrouver seule tout comme j’avais été contente de beaucoup trop parler. J’ai pu le vérifier après : Éthyliszt a le chic de savoir clore les instants, de prendre congé sans donner l’impression qu’il veut se défiler ou se débarrasser de vous. Et même : en vous donnant si bien l’impression qu’il a passé un bon moment que vous est surpris qu’il prenne déjà fin, et de découvrir que c’est très exactement là qu’il doit prendre fin. C’est très rare, à ce point. Cela m’a fait penser à The Art of Grace, de Sarah Kaufman, parce que c’est tout à fait ça, se mouvoir harmonieusement parmi les heures et les gens. Je voudrais apprendre à faire ça, moi aussi, je vais m’y employer : accorder mon attention, toute mon attention, rien qu’à la personne en face de moi, et la reprendre ensuite pour quelqu’un d’autre ou pour moi, sans tergiversations ni brusquerie, comme si c’était inscrit dans le paysage de la journée, une roche, un bloc et puis une faille, une simple ouverture, en fait, l’occasion de constater : brisons là.
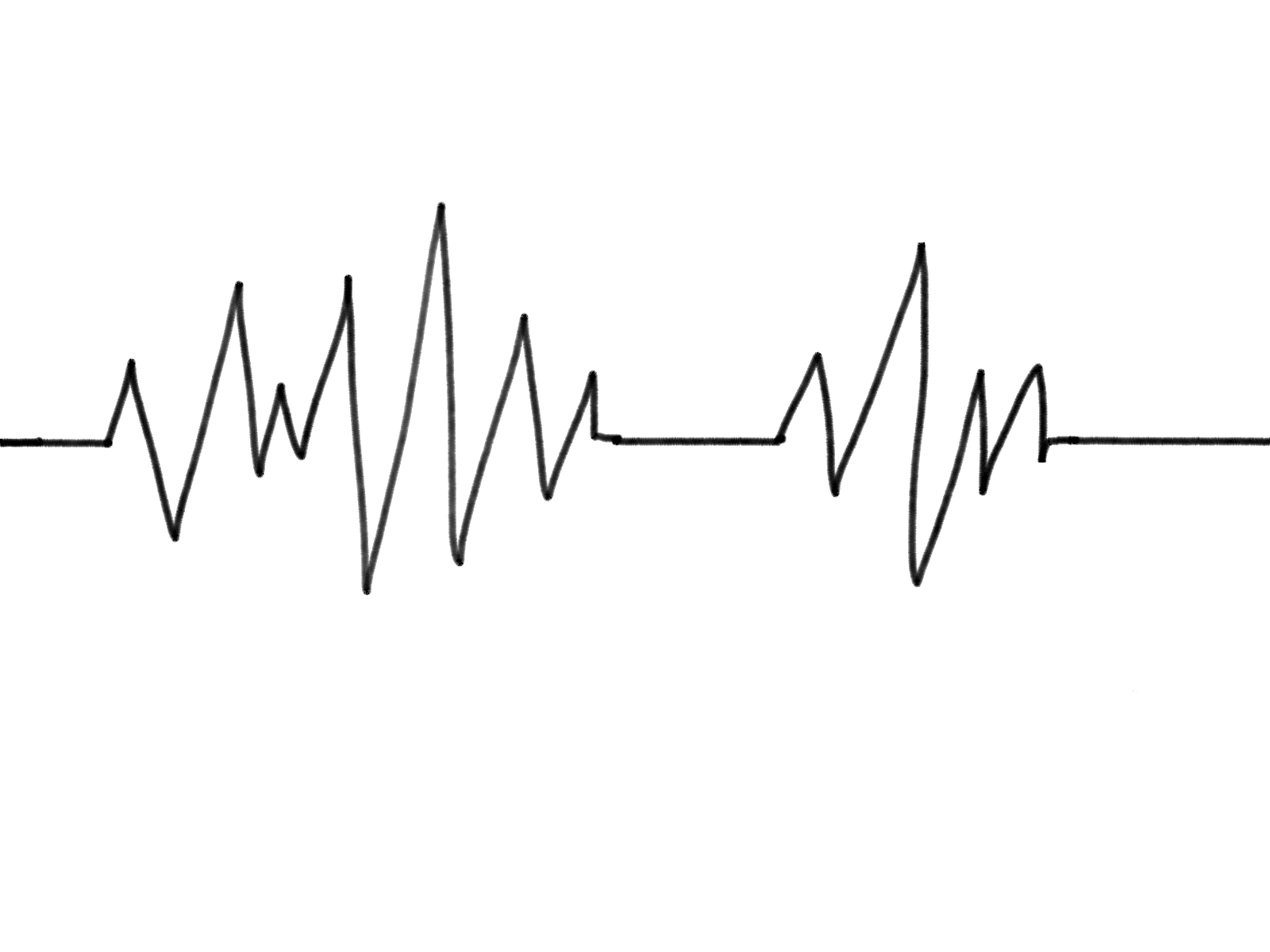

Zut, prise en flagrant délit !
Quoique je crois que j’avais effectivement une course à faire, mon cerveau fait bien les choses, il avait déjà anticipé la séparation.
Je ressens quant à moi ce pincement surtout lorsque j’ai l’impression que l’échange avec la personne n’a pas été jusqu’au bout et qu’il a un goût d’inachevé frustrant ou lorsque la séparation est brutale et se fait sans sas de décompression.
Je me souviens avoir fait ensuite le chemin avec particulièrement d’entrain et de joie malgré le froid.
Aux transitions heureuses !
P.S. : J’adore les animations, elles sont très sympas 🙂
P.P.S. : Déformation professionnelle, je me sens obligée de signaler que certaines personnes pourraient être très perturbées par ces animations qui ne s’arrêtent jamais : https://access42.net/concilier-design-accessibilite
Je suis également repartie avec joie et entrain, ponctués de bâillements : j’aurais pu conquérir le monde… depuis mon lit. (Le couscous et la marche qui ont suivi ont fait un très bon boulot de sas de décompression. ^^)
Merci pour les animations ! Il faut effectivement que je code une petite fonction pour pouvoir les arrêter ; même moi ça me fatigue de les voir gigoter au bout d’un moment. Pour que ça ne perturbe pas trop la lecture, je me suis arrangée pour qu’il n’y en ait jamais deux visibles en même temps et qu’elles soient suffisamment éloignées du texte pour voir être masquées par le scroll avec une fenêtre pas trop grande, mais clairement, c’est un contournement de fainéante.
J’ai contourné le problème en passant par des vidéos mp4 (vive HTML5) et non des gifs. Je ne sais pas si c’est une solution qui pourrait fonctionner pour toi ?
Je crois bien que l’appli où je dessine les animations permet l’export vidéo… (Effectivement, pas moyen de détecter si un gif est en marche ou pas, ni donc de l’arrêter. La solution consistant à modifier l’attribut src en chargeant une image est un pis aller qui me satisfait moyennement, parce que ça implique de tout charger en double.)