
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. Aujourd’hui, un improbable trio féminin.

Ma rencontre avec ce texte a eu lieu lors de mon apprentissage dans une maison d’édition scolaire. Je devais travailler sur un manuel de français pour les 3e, et je me faisais chier comme un rat mort : parmi les textes que j’ai lu et relu dans mon ennui, il y avait cet extrait de Corniche Kennedy. Il y avait un truc. Une histoire d’ado, de cap ou de pas cap de sauter depuis la corniche à Marseille, mais gorgée de peau, de sel, de soleil, de frisson, de violence de groupe, d’autre chose, attirance-répulsion. Une grande densité pour si peu de ligne. Je revois la couverture miniature à côté de l’extrait, vue et revue jusqu’à ne plus la voir, totalement désaturée par rapport au texte.
Puis j’ai oublié le texte parmi la myriades des choses à lire ; je ne m’en suis souvenue quelques années plus tard, probablement à l’occasion de la sortie d’un nouveau roman par l’auteur. Je l’ai lu, j’ai adoré le lire, j’ai adoré la densité des images, pas évidentes à déployer de la page à la surface de projection mentale (il ne faut pas aller trop vite, prendre le temps de construire mentalement les espaces, d’agencer les personnages en son sein), mais si évidentes, si lumineuses ensuite. Il y avait bien une intrigue en arrière-plan, mais ce qui était intrigant, c’était la surface : des corps d’enfants, de la peau, de la mer, de la roche, des éclats ; tout ce qui était dans l’extrait et qui, dans mon souvenir, absorbe le reste du roman comme un trou noir lumineux, pour ne plus renvoyer que le sentiment d’une intensité à vivre, dans un éblouissement viscéral.

Il y a des culs et des bites à chaque page, mais on a moins l’impression d’être dans le lit de quelqu’un que sur une table de dissection. Tout est intelligent, analysé, à distance. Les dialogues, souvent si ridicules dans les textes érotiques, sont démantibulés : les phrases sont les mêmes mais ne dialoguent plus au sein d’une scène ; elles sont rapportées en série, avec une exactitude qui en désamorce le caractère risible. Les amants, les expériences sont innombrables, dessinant une expérience radicalement autre – autre que celle de la majeure partie des gens, mais autre aussi dans le sens où Catherine Millet raconte sa vie sexuelle comme si elle arrivait à quelqu’un d’autre. Exit l’obscénité.
Son expérience foisonnante est l’occasion de parler d’un milieu, de ses règles tacites ; les modes d’approche pour savoir si la personne qu’on rencontre fait ou non partie des baiseurs ; les voitures qui se suivaient à la queue leu leu dans les bois avant de s’arrêter pour une partouze express – tout cela historiquement daté, j’imagine, puisque le Web a dû considérablement changer la donne. Cela peut déjà être fascinant comme monde en soi, mais je trouve encore plus intéressante l’exploration des mécanismes mentaux : sur ce qui se passe dans sa tête lors d’une pénétration ; sur la résolution d’un rare épisode de jalousie, « un terrible sentiment d’éviction » dont la douleur est si intense qu’il lui faut imaginer une issue fatale (cela m’est déjà arrivé, et c’est par le même subterfuge que j’ai négocié un retour au calme dans ma tête) ; sur l’élaboration des scénarios de masturbation, patchwork de scènes vues, vécues, rapportées, infléchies d’une certaine manière selon telle relation sentimentale… tout un tas de processus qui peuvent concerner tout un chacun, même avec une sexualité classique, mais dont on ne parle pas ou peu, soit parce qu’on n’ose pas, soit parce qu’on n’y pense même pas – les expériences n’ont pas coagulées en objet de réflexion. On n’imaginait pas forcément qu’il y avait là matière à dire ou à se dire – la biographie par le sexe.
Une personnalité se dessine, et je suis toujours étonnée de constater à quel point on n’est vraiment pas tous câblés pareil. « Si j’ai profité de mon itinéraire sexuel pour satisfaire ma curiosité intellectuelle et professionnelle, j’ai en revanche entretenu une grande indifférence à l’égard de la vie sentimentale, conjugale, de mes amies. Et même plus que de l’indifférence, un peu de dédain. » Cette indifférence dédaigneuse pour les situation sentimentales fait pièce à une sexualité perçue comme naturelle – non pas je tienne cela pour quelque chose d’anti-naturel ou honteux : je suis seulement étonnée de voir à quel point ça peut aller de soi pour certaines, l’absence de question, d’angoisse ou d’étonnement, de plaisir même. Catherine Millet raconte qu’aussi fou que cela puisse paraître, jusqu’à 30, 35 ans, elle n’avait pas pensé à son plaisir comme à la finalité de l’acte sexuel. Elle baise, c’est tout, beaucoup, avec beaucoup d’hommes différents ; c’est sa respiration en-dehors de la vie quotidienne, contrainte.
« Jusqu’à ce que naisse l’idée de ce livre, je n’ai jamais trop réfléchi sur ma sexualité. » Plus encore que cette vie sexuelle exubérante à mille lieues de la mienne, c’est cette absence à soi-même qui me fascine. On a l’impression qu’il n’y a pas, chez elle, cette voix qui sans cesse commente, interprète, pondère ce que l’on vit – qui inhibe aussi, dans une certaine mesure. Jusqu’à ce qu’elle décide de s’en emparer pour faire le récit de sa vie, cette voix n’existe pas ou n’a pas le droit de cité. Il semblerait qu’il n’y ait jamais à dialoguer, à tergiverser – juste à vivre ce qui me paraît par contrecoup une vie brute, forte… et enviable, dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure seulement, car cette puissance de vie, qui suscite mon admiration, me fait également peur : la non-conscience permanente de soi qui la permet est aussi inconscience… (Admiration et peur : le cocktail parfait de la fascination.)
De la manière dont elle la raconte, il me semble que toute sa vie sexuelle est vécue sur le modèle d’un épisode ponctuel qu’elle relate, où elle est exposée à une explosion de jalousie imprévisible et extrêmement violente de la part d’un de ses partenaires :
« Personnellement, j’ai vécu la confrontation avec ces manifestations dans une hébétude que même la mort d’êtres proches, fût-elle brutale ou agressive, n’a pas provoquée chez moi. Et il fallut que je lise Victor Hugo, oui, que j’aille chercher cette figure-là de Dieu le père, pour comprendre que cette hébétude est de même nature qu’une sorte d’enfermement propre à l’enfance. « Se rendre compte des faits n’est point de l’enfance. [L’enfant perçoit] des impressions à travers le grossissement de l’effroi mais sans les lier dans son esprit et sans conclure », ai-je lu un jour dans L’Homme qui rit, trouvant enfin l’explication de mon abrutissement. »
p. 76
Son récit me donne l’impression qu’une partie de sa vie est vécue sur le même mode, en mineur. À moins que ce ne soit ma lecture. Bizarrement, je n’ai été confrontée qu’une seule fois à cette même impression : en lisant les mémoires de Jean-Jacques Pauvert… lui aussi figure intellectuelle de l’érotisme. C’était encore plus prononcé : Jean-Jacques Pauvert semblait avoir du mal à faire retour sur lui-même dans le moment même de l’écriture. Chez Catherine Millet, à l’inverse, cette absence à elle-même dans le vécu devient dans l’analyse du souvenir un outil de grande lucidité. Et c’est ce qui rend son récit fascinant à lire, au-delà de toute posture voyeuse (quand bien même il y a de quoi voir, Catherine Millet prenant aussi plaisir à raconter).
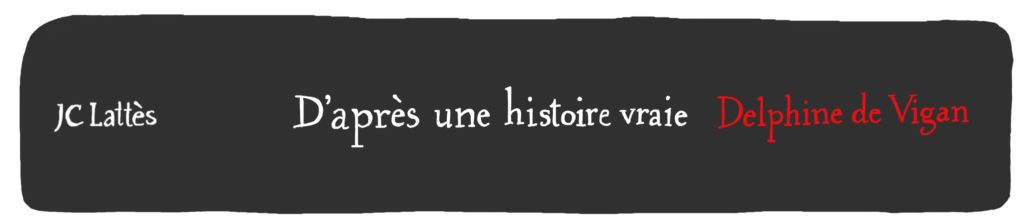
Le livre est passé entre les mains du Petit rat et de JoPrincesse avant d’arriver dans les miennes. Je n’avais jamais lu que quelques extraits de l’auteur, mais ils m’avaient plutôt mis dans des dispositions favorables.
La lecture est effectivement agréable : c’est facile et ça ne l’est pas entièrement ; on sent ça et là la finesse de certaines remarques. L’auteur décrit bien le processus par lequel une amitié improbable au premier abord, rapidement forte et bientôt exclusive, devient toxique pour la narratrice.
Je n’ai en revanche pas du tout accroché au revirement final : la double lecture qui est alors proposée est intelligente, mais pas du tout crédible. La pirouette narrative, censée donner de la profondeur au récit, l’abandonne pour moi à un rocambolesque de bas étage. Cela avait pourtant fonctionné sur le Petit rat et JoPrincesse…
