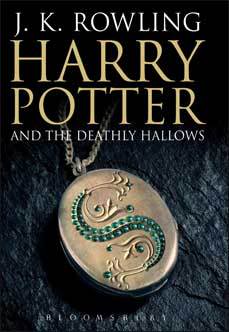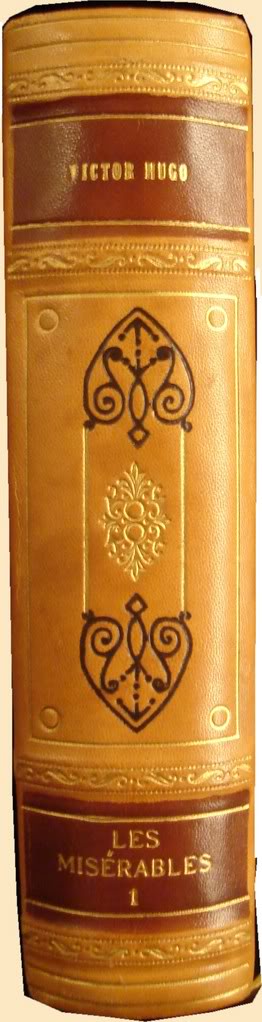A ne pas lire si vous n’avez pas vous même dévoré le dernier tome, à moins que vous ne soyez comme Anouilh pour qui le véritable suspens est de connaître le dénouement. Si vous attendez la version française ou que vous avez fait le dur choix de lectures plus scholastiques, vous pouvez lire ici, un article sans spoiler, écrit de main de maître – et à plus d’un titre, l’auteur est avocat.
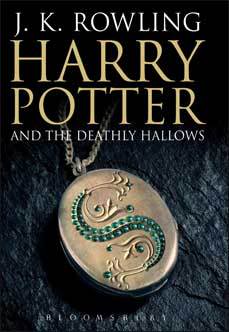
La version adulte, parce que je la trouvais beaucoup plus classe que les illustrations de l’édition anglaise pour mômes. Ce qui fait que j’ai une extraordinaire hétérogénéité dans les éditions de la saga : les trois premiers tomes sont des folio de la première heure, semblable à tout folio pour enfant, sans la police-éclair (sauf pour le premier tome que j’ai eu la mauvaise idée de prêter à ma grand-mère peu soigneuse et qui a préféré me le racheter plutôt que je fasse une syncope devant la couverture pliée et les coins cornés – manque de change, le changement de police a empêché que l’échange soit subreptice) ; les quatrième et cinquième sont en grand format, le sixième, l’édition américaine (doublé de la française pour ma mère) et le dernier, donc, a version anglaise et adulte. Une autre fois, je vous raconterai ma passion pour la comparaison des éditions.
Avant toute tentative de mise en ordre, réactions d’une pottermaniaque après la lecture de l’ultime tome :
Ahhhhh c’était génial !!!
L’épilogue est gorissime
Ces réactions quasi-épidermiques exprimées, nous pouvons passer aux considérations sinon réfléchies, du moins développées (j’allais dire construite, mais laissons les plans à la rentrée).
Le feu d’artifice (encore – celui des Weasley dans le cinquième film n’était pas mal)
Dernier tome annoncé de longue date, Harry Potter and the Deathly Hallows se devait d’être le bouquet de ce grand feu de joie – voire de fanatisme. Comme chaque tome pris individuellement, la série entière est construite sur une immense gradation : la mise en place de l’univers, les détails louches, les complications, le drame et le dénouement accompagné de ses explications (Miss Rowling a bien appris son schéma – exposition, péripétie, dénouement, situation finale). Mais le 7ème, c’est du concentré – Bruce Willis lui-même en perdrait le souffle. Guet-apens et innombrables sorties in extremis : l’accumulation pourrait virer au too much mais l’univers magique ayant été mis en place six pavés durant, le colis final passe comme une lettre à la poste. Les subtilités des baguettes, l’infiltration du ministère, l’évasion de Gringotts en dragon (« They might have noticed »), les « il est mort, mais non, il est vivant », le nouveau passage secret entre Hogwarts et Hogsmead, tout s’enchaîne – et nous avec : il devient difficile de lâcher le bouquin.
C’est ça, genre…
Blending of genres. La Miss Rowling a la formule magique et rien à envier à Hermione quant à la compulsion minutieuse de sa bibliothèque : les ingrédients des meilleures recettes s’y retrouvent.
Le film d’horreur, bien sûr, ugly creatures à l’appui. Et les géants qui démolissent les tours du château lors de la grande bataille de Hogwarts ont un petit air de King Kong.
Film d’action, il va sans dire. Le genre d’histoire impossible à résumer tant il y a de péripéties.
Le genre historique – roman de guerre. Ne trouvez-vous pas que les Death Eaters feraient de bons SS ? Magic is might… Les Juifs sont devenus des Mudbloods et les Aryens des sorciers au sang (et à la connerie) pure, mais l’obsession maladive de la pureté de la race est bien là et conduit également à es convocations, arrestations autoritaires, tortures… La fascination du pouvoir et le « for the better good » vient justifier la politique du pire (ou le pire de la politique). Il n’y a pas jusqu’aux runes du livre d’Hermione qui ne suggèrent une réécriture de cette époque noire.
Le roman policier, surtout, a toujours beaucoup de succès. Surtout quand on remplace une Miss Marple vieillissante (ou un Hercule Poirot grisonnant) par une Hermione pimpante. Les explications s’enchaînent – pas toujours immédiates dans leur déroulement ou leur entendement, mais on admire qu’au final, tout se tienne. Le trio cherche, tâtonne, se trompe une fois ou deux (mais pas plus, il ne reste déjà plus que 400 pages pour dénouer sept ans d’intrigue – un bon instinct est d’un grand secours dans ces cas-là), et ils trouvent. Avec un gentil mot d’explication au lecteur sous imperio – quitte à faire tourner Harry et Tom Riddle (bah oui, He Who Must Not Be Named est maintenant désigné par son petit nom, on vous disait bien que c’était la fin <des haricots>, mes petits chéris) face à face pendant un quart d’heure si besoin est. Voldemort est quand même bien gentil, il laisse à Harry le temps de bien exposer la situation avant d’essayer de le tuer.
Et là on touche au genre romantico-mélodramatique.
Ode de rose
Parce qu’au fond, tout le monde est plein de bons sentiments. Il n’y a guère qu’Inci pour ne pas avoir douté qu’Harry s’en sortirait sain et sauf, elle a raison : les livres pour enfants finissent toujours bien. Mais justement, à bien finir dans l’allégresse, il ne finit pas si bien. J’étais persuadée qu’Harry mourrait en tuant Voldemort. Et là, il le kill. Après cela, c’eut été vraiment fini. Mais tout le monde est plein de bons sentiments, à commencer par feu le méchant Snape, qui n’est pas un sadique mais un homme de grand courage. Je soupçonnais le double jeu au profit des « bons », mais absolument pas son engouement pour Lily. Le morveux de Draco a toujours, grâce eu martyr de Dumbledore, une âme pure et ses parents sont en réinsertion sociale, parce que ce sont des parents avant tout. Le méchant est zigouillé, le héros est survivant. Ce n’est même pas un assassin : il n’a pas a proprement parler tué Voldemort, aucun avada kedavra n’est venu souiller ses lèvres pures – Voldemort a en quelque sorte été anéanti par sa volonté destructrice.
Tout le monde il est beau, il est gentil ; les tables des quatre maisons se mélangent à la fin et accueillent pêle-mêle toutes les créatures vivantes. La fin des clans, de la xénophobie et de racisme. Avènement de l’amour du prochain. Amen. Respect de l’autre avant toute chose, c’est la morale de l‘histoire : voyez le cas Kreacher.
La propagande moraliste pro-elfe de maison et anti-esclavage pourrait être pardonnée si on ne venait pas nous ajouter cet épilogue gorissime, avec tout plein de morveux partout. Ron et Hermione, Harry et Ginny, ok, mais on n’avait nul besoin d’aller au-delà de la tour Gryffondor. La conclusion du dernier chapitre aura
it fait une dernière phrase parfaite, à contrepied de toute tentative de grandiloquence ou de moralisation. A la place de quoi: « All was well »… that ended well? Minute, c’était censé être une aventure de sorciers, pas un conte de fée – le conte de fée, c’est le destin de la romancière. Pourquoi une fin si gnian-gnian ? est-ce pour clôturer définitivement la saga, fini les émotions de Harry qui en a eu « enough for a lifetime » ? ou pour se laisser la possibilité de narrer les aventures de la progéniture, genre, on est repartis pour un tour, par ici les droits d’auteur ? (si elle fait ça, je la tue (métaphoriquement, of course), et elle tue par la même occasion le mythe potterien.)
Vers le mélodramatique : oraison funèbre.
Ce qui sauve du dégoulinage de bons sentiments, c’est qu’elle tue ses personnages à la pelle. Ils tombent comme des mouches. Heureusement, nous avons eu un sevrage en douceur. Rien de létal dans les trois premiers tomes, juste un orphelin : la mort est lointaine, une réalité sue mais non pas vécue. Au quatrième, première victime, mais finalement, Diggory, on s’en foutait un peu, (mal) tombé là comme un cheveu sur la soupe. Pas de grande émotion, mais bon, l’innocence persécutée, ça marque. Au cinquième, les choses se corsent, puisque la bonne étoile d’Harry s’éteint en la personne de Sirius. Sa mort annonce celle de toute la constellation – l’aurore, c’est dangereux (Si vous avez une réminiscence d’une brillante phrase de Legolas, je me sentirai moins seule). Au sixième, le monde s’écroule : Dumbledore tombe de haut, Harry et nous avec. Les vannes sont ouvertes – faites feu ! Mad-Eye, Dobby, Tonk, Lupin, Fred, Snape et de nombreux autres encore. De quoi adoucir un peu ces pertes cependant : Mad-Eye était un aurore, Dobby se fait remplacer par Kreacher (et puis, il est enterré avec ses chaussettes), Lupin est un loup-garou potentiellement dangereux (j’ai plus de mal pour Tonk, d’autant plus qu’ils lui ont donné une touche vraiment sympa dans le cinquième film) Fred a une copie certifiée conforme et le couple Tonk-Lupin laisse un neveu à Harry, histoire qu’il endosse le rôle et rappelle à sa mémoire Sirius.
Des effets rétroactifs du cinéma sur la littérature [ou comment faire croire que l’on étudie les pistes du cours de philo sur Walter Benjamin]
L’écriture de J.K. Rowling est presque cinématographique. Est-ce l’influence des adaptations ? Les descriptions sont très visuelles et surtout les dialogues sont de plus en plus présents – avec les cris en majuscules, on entendrait presque les modulations de volume (ces cris silencieux sont d’ailleurs éprouvants. En plus, ils attirent l’œil et poussent à sauter des lignes – c’est maaaaal). L’influence filmique se retrouve jusque dans la petite phrase désinvolte qui tue tandis qu’on se massacre ; et la fin hollywoodienne (Manquerait plus qu’ils finissent avec un cœur qui mange l’écran). Petit cadeau à la Warner Bro ? Les réalisateurs d’effets spéciaux vont s’en donner à cœur joie !
Et puis en vrac, parce que j’en ai assez d’écrire, et que vous en avez certainement encore plus de me lire :
– j’ai bien aimé les français qui en prennent pour leur grade via l’accent de Fleur
– j’ai a-do-ré Ron et son humour !
– Curieux la récurrence du chiffre 7 : 7 tomes, années, horcruxes, Harry quand on le transfère…mais bon, en additionnant le tout, multipliant par le nombre de plumes du Phénix et retranchant le nombre de frères Weaslay, on obtient l’âge du capitaine – à côté, la divination est une science exacte et Trelawney une scientifique émérite.
La pottermaniaque a fini l’exposition de ses tocs. A bientôt !