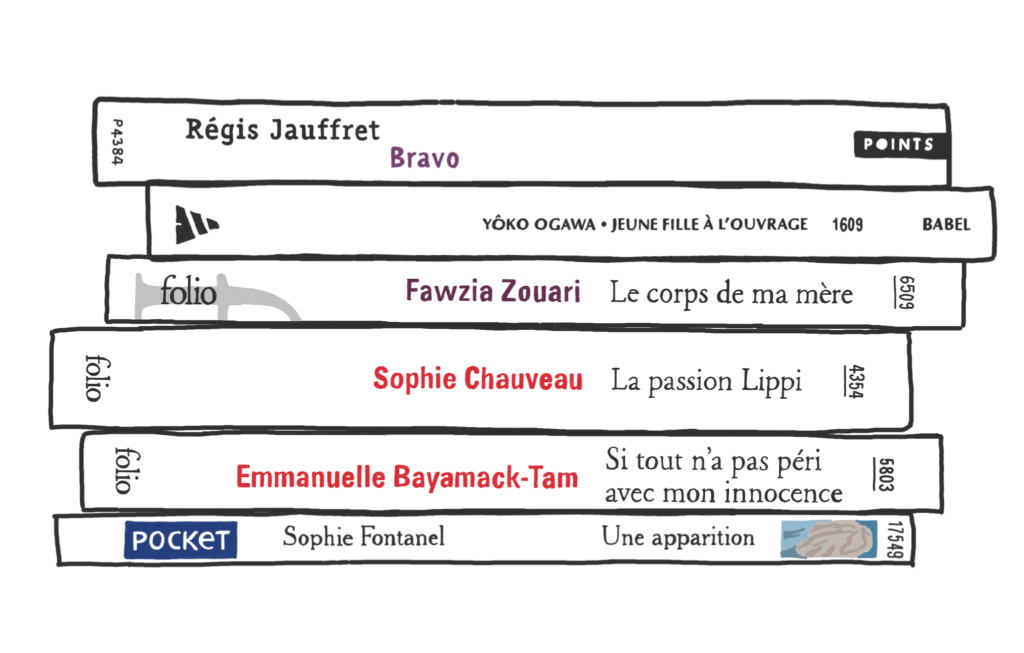
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. Aujourd’hui, une pile accumulée en 2019.

On a beau intégrer au bout de quelques nouvelles que ça va forcément dégénérer, on se fait avoir à chaque fois. C’est grinçant de bout en bout. Parfois ça grince drôle, le rire jaune bien trouvé, parfois on se demande pourquoi on s’inflige les chairs flasques du vieux dégueulasse qui sert de narrateur à telle ou telle nouvelle.
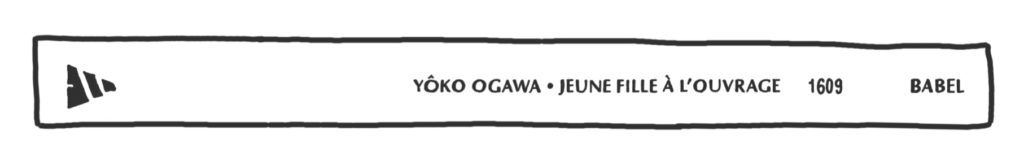
Ce sont moins des tranches de vie que des tranches de bizarreries. Comme si on décidait de ce qu’était un humain après avoir longuement détaillé une oreille – c’est d’ailleurs là que se logerait une glande ressort réglant notre rapport au temps, et dont il faudrait se débarrasser pour rendre l’éternité moins longue.

Le corps : à l’hôpital, convoquant les proches et les souvenirs, dans un monde moderne qui n’est pas le leur.
Le conte : l’univers de la mère. La romancière abandonne son sens occidental du récit pour se faire conteuse et donner corps à la vie de celle qui lui a donnée la sienne. Il n’y a plus de monde moderne qui rend l’autre archaïque ou arriéré (c’est le jugement que l’on était prêt à porter dans la première partie, retenu seulement par la narratrice faisant obligeamment le pont entre les cultures), il y a une vie d’une violence et d’une richesse inouïe, même claquemurée entre quatre murs, il y a des générations entières, des djins et des nourritures opulentes, des tissus et des histoires incroyables, dont on ne revient pas.
Et justement, l’exil : celui que l’on comprend enfin, de la mère sevrée de sa magie, laquelle, persistant dans un monde qui n’est plus le sien, se lit comme maladie, celle-ci à son tour niée, sublimée par la magie du récit.

« Moine et libertin », ça puait le sacrilège racoleur. Mais quand Sophie Chauveau raconte l’histoire de ce gamin qui n’a plus à voler son pain sitôt qu’on le découvre à dessiner, qui continue son apprentissage dans les bras de prostituées qui l’ont d’abord hébergé comme gamin, l’hypocrisie tombe et ces sœurs de cœur cohabitent avec les frères qui dorénavant le logent, jusqu’à ce que, à force de peindre pour eux, il devienne des leurs.
Le récit déjoue le jugement pour celui qui ne respecte rien, ni la morale, ni les apparences, ni les enseignements de ses maîtres. Je me suis laissée entraîner dans cette époque, ce monde dont je ne connaissais rien ; pire : pour lequel je n’éprouvais aucune curiosité. J’ai levé un sourcil puis la tête émerveillée sur les voûtes, les ateliers, sur les pigments qui se chapardent, les découvertes qui se volent, toutes les techniques qui n’ont rien d’abstraites, qui sont des recettes de cuisine, d’artisans, des matériaux qui se travaillent et s’appliquent.
J’ai jugé sévèrement ce jeune homme que son talent devait exempter de tout, puis j’ai oublié, fascinée par cette bête d’artiste qui n’en fait qu’à son instinct, encore plus qu’à sa mauvaise tête. J’ai découvert, stupéfaite, qu’il n’y a que le vocabulaire religieux pour rendre compte de l’intensité de cette vie : ce qui reste, ce qui prend, c’est la ferveur – à peindre, à vivre, à aimer. Il y a dans ce roman certaines des plus belles pages que j’ai pu lire sur le désir : tout se confond, tout fait corps, les vierges avec les moines défroqués, la pureté avec ce que l’on ne peut déjà plus appeler le vice ; tout peint, vécu, dépeint avec une ferveur telle que j’étais presque sûre qu’elle saurait me faire voir, me faire apprécier ces œuvres qui jusqu’à présent m’ont toujours laissée de marbre ; que je retrouverais les frasques dans les fresques ; que je pourrais, enfin, sentir la peinture de la Renaissance palpiter !
Presque.
Pas du tout, en fait.
Il faut vraiment un très beau roman pour soutenir cette illusion.

Ce livre raconte comment l’esprit vient aux filles. On y apprendra, entre autres :
– comment naître à neuf ans
– comment survivre à la perte de l’innocence
– comment grandir sans sombrer
– comment aimer l’autre sans souhaiter sa diminution
– comment faire entendre la musique de l’alexandrin
– comment désirer sans fin
– comment remettre sa vie dans le bon sens.
C’est rare qu’une quatrième de couverture soit à la hauteur d’un roman, rare aussi qu’un roman soit à la hauteur d’une quatrième de couverture qui retient l’attention. Mais ça arrive. Ça t’arrive même en pleine poire, dans un style que tu n’avais pas franchement anticipé, même si, si, un peu, en lisant les premières pages, ce ton gouailleur désabusé qui n’épargne rien ni personne, pas même ta petite larme, là, trop occupé à se préserver, parce que y’a urgence à s’en foutre, une fureur de survivre, de passer outre cette famille grotesque qui ferait rire s’il n’était aussi tragique d’essayer d’y grandir.
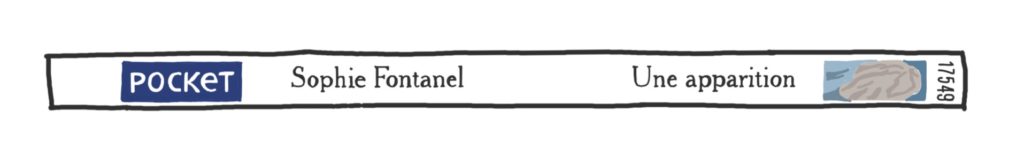
J’ai trouvé ça un peu facile, un peu trop repiqué sur soi, mais pourquoi pas après tout : il faut fixer longtemps un fait commun pour qu’il perde de son évidence admise et redevienne ce qu’il est peut-être intrinsèquement – étrange. Ici, ce sont des cheveux blancs, que la narratrice décide d’arrêter de teindre – une Bartelbyerie capillaire qui suscite tout un tas d’anecdotes et de réactions, et fait apparaître en filigrane, comme un premier cheveu blanc dans une masse brune, tout un rapport au corps, aux femmes, à la vie, la vieillesse, et leur beauté.
