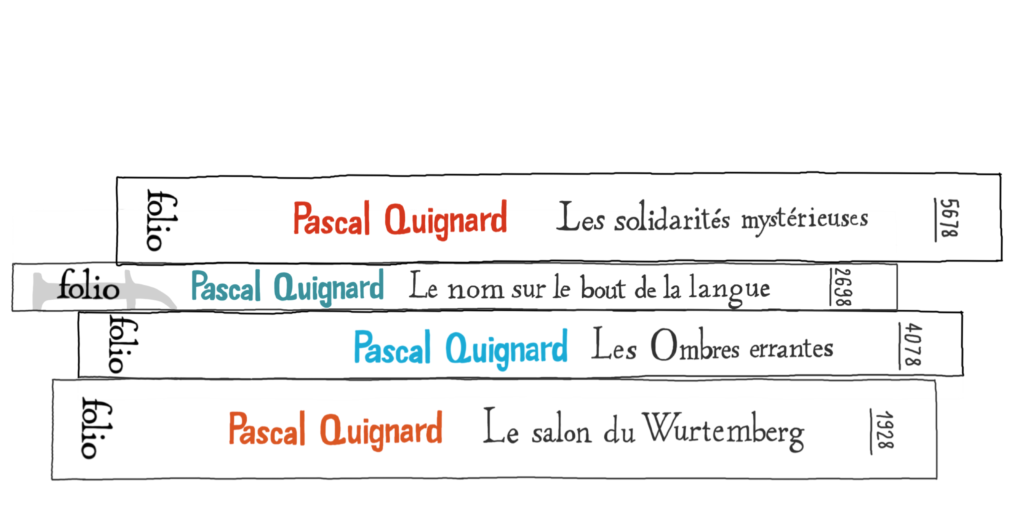
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. Aujourd’hui, une pile spéciale Pascal Quignard, avec une petite expérience : essayez de retenir le nom Heidebic de Hel ; j’y reviendrai.

Je vous ai déjà parlé de Villa Amalia et Terrasse à Rome, mais le livre qui a déclenché ma fascination pour Pascal Quignard et m’a poussé à poursuivre l’exploration de son oeuvre en dépit d’expériences plus ou moins enthousiasmantes, c’est celui-ci : Les Solidarités mystérieuses. J’en repousse la chroniquette depuis un certain temps, dans la crainte de ne pas réussir à lui rendre justice ; je n’y arriverai probablement pas, mais j’ai plus de chance de vous donner envie de le lire en en parlant imparfaitement qu’en n’en pipant mot…
Le titre m’a immédiatement fait penser à ce que Melendili m’avait dit de Mad Men : qu’elle appréciait cette série pour les relations sans nom qui y étaient développées. Des relations sans nom : des solidarités mystérieuses. Deux personnes reliées indépendamment de leur statut familial, social ou de sentiments identifiables comme l’amour, l’amitié.
Ce n’était pas de l’amour, le sentiment qui régnait entre eux deux. Ce n’était pas non plus une espèce de pardon automatique. C’était une solidarité mystérieuse. C’était un lien sans origine dans la mesure où aucun prétexte, aucun événement, à aucun moment, ne l’avait décidé ainsi.
(J’ai été étonnée de découvrir que cette citation, choisie pour la quatrième de couverture, n’était pas développée à propos des deux personnages que je croyais…)
Une relation d’intimité où ça communique d’âme à âme – sans rien de mystique là-dedans, ni même de lyrique ; plutôt quelque chose de souterrain, que l’on sent courir sous les actions, les mots très concrets, souvent prosaïques. Ça passe à même la terre, cette terre âpre de Bretagne où l’auteur enracine-déracine ses personnages, dont les vents et marées façonnent les âmes en les érodant, et leur donnent quelque chose de la pierre, des falaises, quelque chose d’immémorial qui relie les gens en dépit de leurs liens ou leur absence de lien. Je n’arriverai probablement pas à dire mieux sans relire ou tout citer : ça, quelque chose.
Les relations sans nom en ont désormais un.
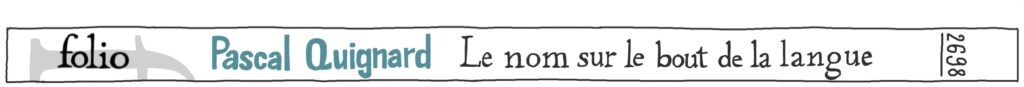
Parfois, je choisis un moment arbitraire, une personne dans une file d’attente, et j’essaye d’imaginer, s’il se passait quelque chose, si cette personne disparaissait ou était impliquée dans une affaire policière, serais-je capable de m’en souvenir, de la décrire et la reconnaître ? Je me concentre, je la détaille pour essayer d’en retenir les gestes, la silhouettes… J’ai joué à cela un certain nombre de fois, et pas une seule image ne me revient. C’est comme d’apprendre un poème par coeur ; si aucun souvenir n’y est associé, il s’efface de la mémoire à court terme sitôt récité. On ne retient vraiment que ce qui nous a marqué, indépendamment de notre volonté de l’être. J’y pense parfois quand je vois une affiche sur les enfants disparus – de moins en moins souvent, encore quelque fois dans les aéroports.
Vous souvenez-vous du nom donné en introduction ? Dans le conte du Nom sur le bout de la langue, enserré entre un souvenir et un essai, une jeune femme passe un pacte avec un diable de Seigneur : il l’aide à gagner la main de l’homme qu’elle aime, à condition qu’elle se souvienne de son nom à lui. Si elle n’est pas capable de le lui répéter lorsqu’il reviendra, des mois ou années plus tard, elle devra quitter l’homme qu’elle aime et l’épouser lui. Cela semble si facile, un nom, sans orthographe alambiqué. Heidebic de Hel. Vous l’aviez encore ? L’allitération est fourbe, à le retrouver coincé sur le bout de la lange.
Le conte inséré dans ce court essai se confond dans mon esprit avec la bande-dessinée pour laquelle Pascal Quignard a repris presque le même scénario. Et, à vrai dire, cette histoire conjuguée a fait s’évanouir l’essai sur la mémoire et le langage qui y succède, et qui s’y est comme résorbé. C’est la force de l’image – et du conte, qui en est le plus proche équivalent langagier.

L’érudition m’emmerde. Je n’y peux rien. Je déteste cette accumulation de brocante, qui souvent fait obstruction aux liens d’intelligence pour qui ne possède pas les mêmes connaissances. Pascal Quignard l’érudit m’horripile. Mais ses digressions érudites débouchent souvent sur des vérités étonnantes, qui font mouche : agacent, et nous décollent de notre point d’aveuglement. Surtout, ses digressions érudites s’interrompent parfois pour laisser place à un court récit, et Pascal Quignard est un conteur hors pair. Il peut inscrire en vous une image qui continuera de vivre et de vous habiter, sinon hanter – flottant là, quelque part, prête à se charger de sens et de nuances à leur passage, mais trop forte, trop unique pour être ravalée et évacuée comme symbole. Quelque chose de résistant, de persistant.
Bref, il y a à boire, à manger, à relire et à oublier dans les fragments chapitrés des Ombres errantes – le premier livre d’une longue série (Dernier royaume), que je doute lire dans son entièreté.

C’était une lourde demeure du début du XIXe siècle, solidement arrimée au jardin par un très lourd escalier entouré de petits lauriers, de minuscules lilas et de fleurs.
Pascal Quignard, Le Salon du Wurtemberg, chapitre premier et première page
Arrimé. Un participe passé métaphorique, et voilà une solide demeure qui flotte comme un navire, l’ennui de la description surmonté et l’envie de lire. C’est dans le premier paragraphe du Salon du Wurtemberg. Je m’en souviens à peine.
Ce sont des souvenirs qui tout à coup mettent le sang aux joues, des couleurs qui bruquement luisent, des sons, des visages et des noms qui font soudain sauter le coeur.
Quatrième de couverture de l’édition Folio
Mon souvenir remplace le sang par le pourpre, de tentures lourdes, silencieuses, et les couleurs luisent peut-être, comme dans un orchestre, mais le coeur ne saute pas, il s’étire à la limite de la déchirure, comme le temps à mesure qu’il nous en reste moins.
Des relations, des souvenirs, un peu de musique (forcément, c’est Quignard)… Je ne me souviens d’à peu près rien de ce roman, sauf que je l’ai fini sur un banc au soleil, dans un minuscule jardin public d’Ivry-sur-Seine, et que l’auteur y scrute les méandres de l’âme avec une préciosité un peu surannée mais pas désagréable.
Pour un chapelet d’extraits et citations, c’est par ici.

Merci merci merci ! En lisant ton article, j’ai eu une très forte impression de déjà vu – le nom de Pascal Quignard me disait tellement quelque chose. C’est en parcourant ma bibliothèque que j’ai retrouvé « La haine de la musique » qui m’avait énormément impactée étant ado… Et que j’ai complètement oublié. Il est remonté en flèche dans ma pile de bouquins à relire (dont la hauteur vertigineuse est en compétition avec celle des bouquins à lire, tsukondu quand tu nous tiens…)
Je vais le mettre dans ma pile à lire, alors ! Je l’ai croisé plusieurs fois, mais toujours avec les mains déjà bien remplies (à la FNAC des Halles, il est au rayon musique, et non avec les autres livres de l’auteur au rayon littérature). Quant à la pile à relire, c’est virtuellement la moitié de ma bibliothèque, du coup, je ne fais pas de pile, et je me contente de lire sans relire (ou juste quelques pages au moment d’écrire la chroniquette). J’ai du mal avec ça, mais il faut que je me fasse à l’idée d’oublier. On n’oublie pas tout quand on oublie, en plus : comme dans ton exemple, on peut se souvenir de l’émotion à défaut du contenu précis (les livres suivent manifestement le même adage que les gens : people will forget what you said, but they will remember how you made them feel). ^^