
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. C’est reparti.

Des étudiants exaltés viennent chercher un vieil homme paisiblement retraité, pour lui dire tout le bien qu’ils pensent de l’obscur recueil de poésie qu’il a publié dans sa jeunesse, sans jamais plus réécrire ensuite. Flatté, il devient la mascotte du petit cercle, où on est poète après quelques verres, dramaturge sans théâtre, Sarah Bernhardt pour deux seconds rôles, et défenseur de l’Art avec la grandiloquence de khâgneux. Le décalage entre leurs prétentions et leurs réalisations rendent ces jeunes gens ridicules, évidemment, mais ce sont des jeunes gens ; le vieil homme l’est davantage – ou moins : cette camaraderie déférente, tout en flattant l’envie de reconnaissance qu’il existe chez tout un chacun, lui offre une seconde jeunesse. Le cynisme se mêle ainsi de tendresse, et la drôlerie prend un drôle d’air, de moins en moins drôle et de plus en plus lassante : la satire facile prend ses aises, et met du temps avant de laisser affleurer la mélancolie et l’amertume qui viennent avec les désillusions. Arthur Schnitzler réussit à nous les faire accueillir avec soulagement : pour le vieil homme comme pour le lecteur, cela a assez duré.
Et il lui sembla qu’il rentrait chez lui après un court et pénible voyage, dans une maison qu’il n’avait jamais aimée mais où il retrouvait la sourde et molle quiétude d’antan.

Titiou Lecoq a le don de me faire rire lorsqu’elle écrit sur son blog, alors pourquoi pas lire ses romans ? J’ai surmonté une légère honte envers moi-même en attrapant un exemplaire sur la pile, avec sa couv’ Barbie, comme si j’allais m’adonner à un plaisir facile et méprisable. On ne se débarrasse jamais vraiment des préjugés qu’on a acquis, on en devient seulement conscient (mais bon, un préjugé re-jugé n’est plus pré-jugé, donc on devrait pouvoir s’en sortir). J’avais presque oublié qu’on pouvait se marrer en bouquinant, et pas seulement parce que les rillettes dont parle Proust vous font penser à la publicité Nous n’avons pas les mêmes valeurs.
Quand même, quelque chose m’a gênée à la lecture : le passé simple. Impossible pour moi de réconcilier le temps du récit avec un ton qui s’apparente au billet de blog. À chaque action en -a, j’ai l’impression d’un coup de stabilo fluo pour indiquer qu’il y a là roman, un vrai roman, hein, comme on voulait en écrire à dix ans avec ma cousine, débutant invariablement par la description d’une héroïne de 16 ans qui s’appelait une fois sur deux Anaïs (la coqueluche de nos cours de danse). Bref : le passé simple sonnait faux, amateur. J’ai quand même continué sans difficulté, avec plaisir même, et à la fin, je ne m’étais pas habituée, non : le récit avait rejoint le passé simple. Quelque chose s’était passé, avait passé : une époque, la sensation d’une époque. Malgré les ordinateurs, les euros, les sextapes, ce n’était plus aujourd’hui : depuis les débuts d’Internet, vus soudain à distance, avalés par le temps, c’était tout une histoire. Elle inspira un peu plus fort et reposa le livre.
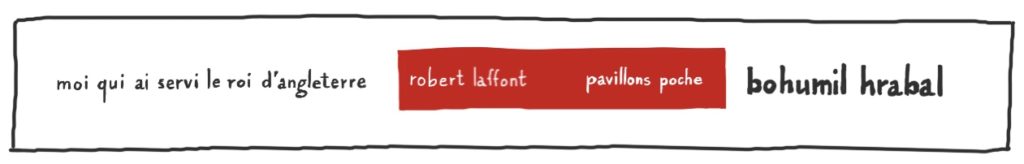
Je ne me souviens pas de tout dans Moi qui ai servi le roi d’Angleterre, mais je me souviens d’une chose : le narrateur a servi le roi d’Éthiopie, pas le roi d’Angleterre – c’est une chose dont s’enorgueillit un de ses collègues ou supérieur. L’appropriation de la citation donne le ton. La narrateur est chapardeur, voleur, égoïste, opportuniste, collabo. Mais tout ça, ce sont des noms, qui viennent après la lecture ; lors de la lecture, il n’y a que des verbes, des actions qui se succèdent et s’entrechoquent à vive allure… au point que la suspension du jugement réclamée par le roman se met à réfléchir l’absence de jugement du narrateur, son aveuglement aux concepts de bien et du mal. Pour lui, il n’y a que mieux et pire, par rapport à sa situation actuelle ; l’essentiel est de s’en sortir, et il pour cela fonctionne moins au calcul qu’à l’instinct. Crapule mais pas feignasse, il ne ménage pas sa peine ; s’en sortir le propulse dans la vie, et on suit comme on peut, remarquant toujours à retardement à quel point il est détestable – il suffit mais il faut aussi pour cela s’abstraire du point de vue interne.
Suivre ces aventures rocambolesques est déjà une expérience en soi. La fin en rajoute une couche – tout autre : de neige. Alors qu’on se rapproche dangereusement du jugement dernier avec la fin de la lecture, Bohumil Hrabal y soustrait le narrateur et son livre même, en donnant au récit un tour poétique imprévu. Isolé dans une petite maison en pleine montagne, le narrateur n’expie rien : il raconte, et tout tombe, le jugement, la neige, les événements à leur place. Il n’y a plus rien soudain que l’étrangeté des errances et des motifs qu’elles dessinent, qu’on appelle destin, et qui est sur le point de s’effacer, sans grandiloquence, dans le silence du lecteur, de la neige et des mots qui se tarissent – celui qui a servi le roi d’Éthiopie bientôt enseveli comme les autres.
… c’est dans cette auberge que j’avais découvert peu à peu que l’essentiel de la vie consiste à s’interroger sur la mort, sur son propre comportement lorsque l’heure aura sonné ; pour moi le fait de se questionner ainsi entamait déjà une conversation placée sous l’angle de l’éternité et de l’infini, envisager ainsi les modalités de sa mort inaugurait une réflexion en termes de beauté dans l’univers du beau, puisque la saveur tirée de l’absurdité de sa propre voie, qui de toute façon se clôt sur un départ prématuré, cette délectation devant le vécu de ses propres errements, ça vous emplit le coeur d’amertume et par conséquent de beauté.
Moi qui ai servi le roi d’Angleterre, Bohumil Hrabal, coll. Pavillons poches, éd. Robert Laffont, p. 273

J’ai trouvé ce roman dans un magasin d’occasion : son titre a étrangement résonné avec le nom de l’auteur, phonétiquement proche du mien. L’exercice d’abandon, c’est l’exercice d’évacuation auxquels sont soumis les protagonistes au début de leur croisière, mais aussi l’abandon amoureux auxquels un homme et une femme vont être confrontés tandis qu’à une escale, leur femme et mari se font la malle ensemble, sur un coup de foudre coup de tête. Le récit abandonne les fugitifs pour se concentrer sur le non-couple qui reste. Isolés du monde sur le bateau, et des autres passagers en son sein, ils se réfugient dans un bizarre espace commun, fait de défiance, d’invectives et rapidement de soutien car, si la cause de leur malheur est pour chacun associée à l’autre (la faute à votre femme, à votre mari), cet autre est aussi la seule personne qui peut comprendre.
Un couple en détruit deux autres ; l’arithmétique de l’ordre, du récit, l’horreur du vide et du malheur, voudraient que les deux laissés pour compte forment à leur tour couple. C’est donc trop gros et pourtant c’est là, en attente, en rapprochement. L’intrigue est grossière ; le récit, tout le contraire, tout en justesse : cela advient sans que l’on s’en aperçoive, alors que l’on n’attendait que cela. Je n’ai compris que récemment le pourquoi de ce paradoxe – en recommençant De l’intime, de François Jullien, au prisme duquel tout se relit pour moi ces derniers temps (comme Clair de femme dans la précédente pile). Ce n’est pas l’amour, le bruyant amour, qui unit les amants abandonnés : ça, c’est le coup d’éclat des déserteurs, qui s’en mordront ou non les doigts. Les amants abandonnés se replient dans un autre plan : celui de l’intime qui, discret, retiré, leur offre refuge. L’amour émergera ou n’émergera pas de ce terreau : la question n’est pas hors-sujet mais elle reste hors-champ, au bon vouloir du lecteur, qui décidera de même si les déserteurs doivent revenir auprès de leurs compagnons de vie. Ce qui intéresse ici, c’est tout ce qui bruisse entre : entre ces questions, entre deux êtres suspendus entre deux escales, entre deux événements marquants de leur biographie. Le roman tient tout entier dans cet interstice, et fait bruire de mots l’espace qui exige d’être comblé entre ces deux êtres esseulés-rassemblés.
Les illustrations sont inspirées d’@idealbookshelf.
