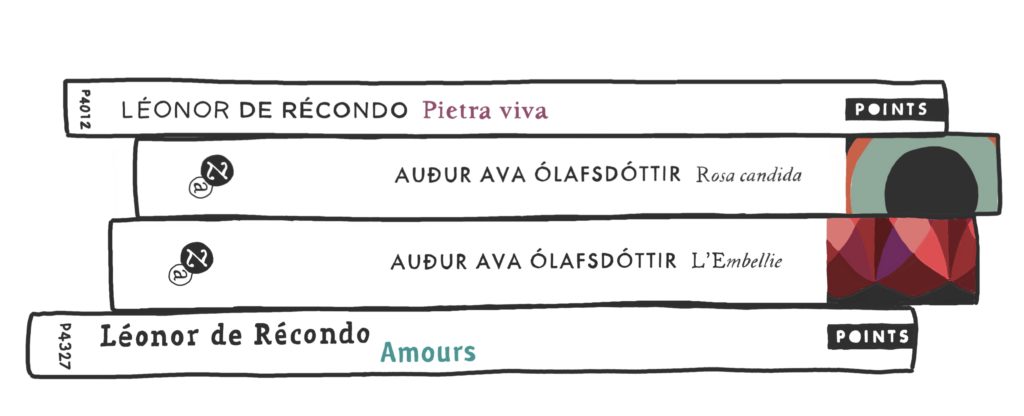
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. Aujourd’hui, un duo au carré, avec deux fois deux romans, de deux romancières. Lyrisme versus prosaïsme, beauté de la tristesse versus beauté de l’insolite inattendu.

Je l’ai sorti d’un rayonnage à Strasbourg, et la lumière de la golden hour dans laquelle je l’ai commencé s’est confondue avec celle de l’aube qui baigne la carrière dans laquelle Michelangelo vient choisir ses blocs de pierre (dans mon imaginaire, cette carrière abouche la Toscane avec le Portugal du Dieu manchot de Saramango – une même carrière pour les deux romans, seulement différemment lumineuse, plus rosée et moins peuplée, vécue de plus près dans Pietra Viva).
Traversé par la douleur et la lumière, le sculpteur est tout entier tendu vers ce qu’il a à créer, et on est, lecteur, suspendu à sa vision, à la sculpture qu’il voit déjà dans la roche, sa vie intérieure que l’on devine dans ce qu’il ôte à la pierre, une sensualité et une force poétique qui le fait cheminer aux côtés de l’enfance (un gamin un peu gênant, qui s’obstine à le coller de loin en loin) et de la folie (un compagnon-centaure qui, d’homme, se perd en rêve équin) – pour trouver son chemin d’homme.

Dans Amours, que j’ai lu en premier, c’est le même désir que dans Pietra Viva, incarné seulement par une amante plutôt que par un artiste. C’est la même tension de vie, douloureuse et sensuelle (la pierre, le corps aimé, du pareil au même), qui rend caduque le résumé du point de départ comme d’arrivée, le récit bourgeois tout aussi faux que les amours lesbiennes. Tout est plus violent, plus sidérant que cela ; tout part d’un viol, qui sidère dès la première page, et met en place les conditions d’une situation que je n’aurais pas vue venir, mais qui fait advenir le sens, jusqu’à s’y abolir, dans la confusion de la sensualité et du destin.
Si je n’avais pas lu Pietra Viva après, peut-être aurais-je plutôt évoqué Les Bonnes de Genet, et surtout Le Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau (comment ne pas entendre l’écho à Célestine lorsqu’il est question de Céleste, et l’élévation qui suit la coupe du suffixe diminutif ?).
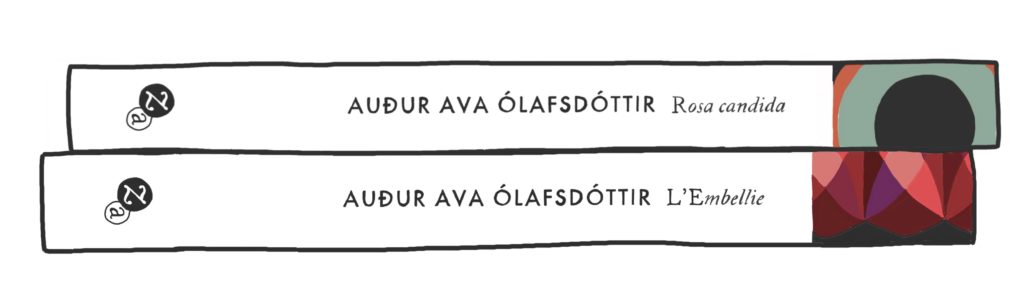
Les personnages d’Auður Ava Ólafsdóttir sont comme sourds à leurs pensées, étrangers à leurs émotions, et c’est je crois ce qui fait l’étrangeté et la beauté de ses romans. Malgré la narration à la première personne, aucun flux de conscience n’y est consigné, seulement le flux des jours, et la surprise de se découvrir changé lorsque la pensée qu’on n’a jamais réfléchie se réverbère en action détachée de soi. Ce ne sont que gestes, repas, lieux égrenés, rien que ça, et c’est tout autre chose en bout de compte. Des liens se sont tissés sur le hasard, sur ses données hétéroclites : « deux ou trois boutures de Rosa candida », « un moine cinéphile » ou encore « un petit bonhomme presque sourd et affublé de grosses loupes en guise de lunettes ». Dans les deux romans, il y a un enfant tombé de nulle part, du ciel sur soi, un petit être qui n’a pas grand-chose à voir avec le désir ou la projection de soi, mais bien davantage avec ce qu’on fait de la vie quand elle nous tombe dessus.
