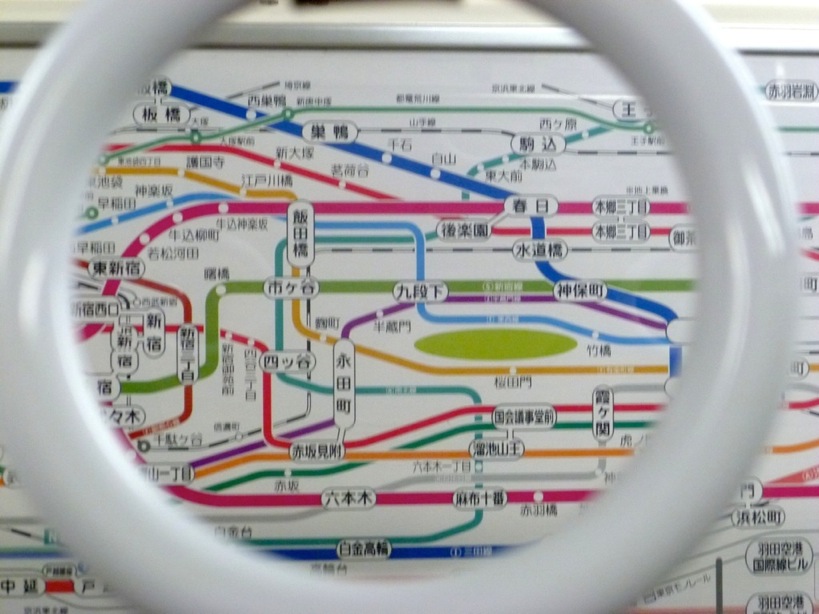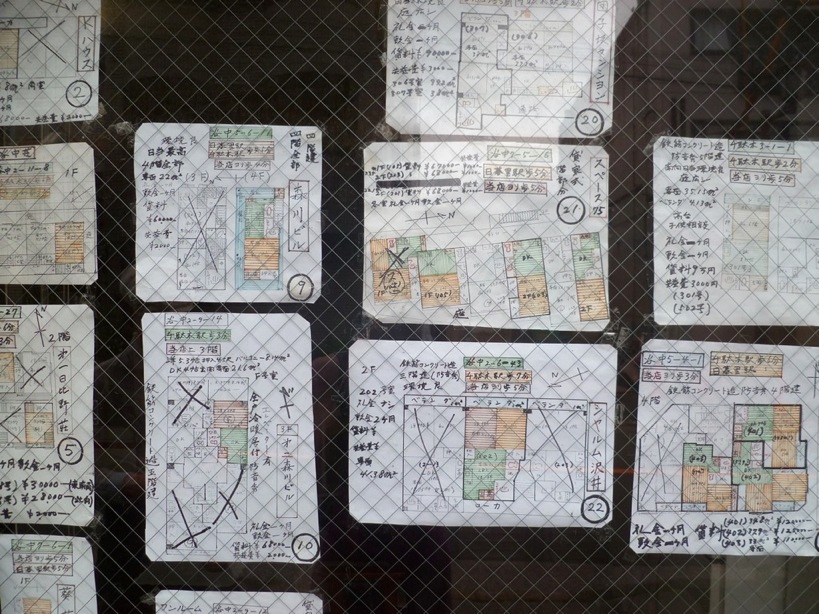Un speaker. C’est comme ça que s’est matérialisé @JoDasson à la soirée de @squintar, quand on tâtait tous le terrain à coup de Qu’est-ce que tu fais dans la vie et qu’il s’est retrouvé au centre des interrogations, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de rencontrer une personne dont la voix résonne dans un stade de football.
Un speaker. C’est comme ça que s’est matérialisé @JoDasson à la soirée de @squintar, quand on tâtait tous le terrain à coup de Qu’est-ce que tu fais dans la vie et qu’il s’est retrouvé au centre des interrogations, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de rencontrer une personne dont la voix résonne dans un stade de football.
De football, oui. On a tous des préjugés, et le foot fait (faisait ?) partie des miens : sans même que j’y pense, JoDasson s’est spontanément retrouvé rangé dans la partie personnalité-atypique-mais-pas-ma-came de mon cerveau. Je n’aurais pas imaginé que j’allais pas mal discuter avec lui, introduite par JoPrincesse qui sait décidément s’y prendre en soirée : je les ai écoutés le nez levé depuis ma chaise, puis je suis revenue à leur hauteur une fois cuvé un vertige auquel je ne suis pourtant pas sujette d’ordinaire.
Autant vous le dire tout de suite : je n’ai pas eu d’épiphanie footeuse. La conversation s’est engagée autour de la photo, des relations, peut-être un peu de danse, je ne me rappelle plus trop. Ce qu’il me reste surtout, c’est l’image d’une présence tranquille et lumineuse, qui s’éclaire davantage à mesure qu’il est question de ce et ceux qu’il aime : les paysages du dehors et ceux du dedans, qui se devinent sur les corps dénudés, sa compagne-fleuve, et sa muse photo – et ce n’est même pas ridicule ni second degré quand il le dit, tant il a l’air absorbé-inspiré par cette évocation. Il y a des gens lumineux comme ça, qu’il fait bon rencontrer même si on ne leur restera probablement pas liés, qui par leur propre enthousiasme vous font oublier vos petites névroses ordinaires et vous redonnent envie de faire, à leur image, un tas de choses – ou même pas un tas : simplement respirer avec plus d’amplitude et de confiance. Quelqu’un qui inspire confiance : peut-être pas tant en lui qu’en soi.
Tous, on a mangé, on a parlé, on a dansé ; c’était une belle soirée, qui méritera d’être racontée pour elle-même. Je suis rentrée, j’ai dormi, j’ai stalké-regardé son travail et pourquoi pas. J’aimais bien l’idée qu’il considère le nu comme un outil, pas une fin en soi ; j’étais plus curieuse de l’expérience que du résultat, je crois. Ou peut-être me disais-je cela pour faire taire mon narcissisme, inversement proportionnel à ma photogénie ; j’occultais le résultat, craint et désiré, pour ne pas avoir peur de me lancer. J’avais quand même pour moi quelques obstacles de choix : mon petit appartement bordélique, aussi photogénique que moi, et des plannings a priori peu compatibles, la distance géographique aidant. Joffrey a rigolé quand je lui ai envoyé une photo de mon salon-chambre (une rangée de fenêtres et des murs blancs réflecteurs, trop facile) et le lundi soir suivant la soirée du samedi, il a proposé de se faire le shooting au débotté.

J’avais déjà couru pour arriver à temps à mon rendez-vous médical, après avoir entré le numéro 232 à la place du 323 dans le GPS de mon téléphone – cent numéros à sprinter au soleil, une trace de sueur sur le siège du médecin. L’arrache, il n’y a que ça de vrai : pas besoin de se poser des questions autres que purement pratiques, j’étais chaude. Je suis rentrée au pas de course, DM de synchronisation à la main, mini-épilation à l’arrache, est-ce que j’ai des appréhensions, pas avant que cette question m’en fasse prendre conscience, enlever les sous-vêtements pour ne pas laisser de traces sur la peau, je ne comptais pas en porter sous la douche, me voilà nue sous ma robe T-shirt, que j’ai de toutes façons plutôt envie d’enlever à force de m’affairer, ouverture des fenêtres, repliage du canapé-lit, ramassage des mouchoirs par terre, baskets écartées du pied… Sonnerie. Verre d’eau. On y va.


Je m’étais si bien mise en condition que je suis décontenancée quand JoDasson me suggère de choisir quelques fringues que j’aime particulièrement dans ma garde-robe. Je fouille, je sors des trucs que j’empile sur mon bras gauche, j’en oublie, aussi, des fringues favorites dont je me demanderai après comment j’ai pu les oublier. Shooting man réclame aussi de la musique pour l’ambiance et… pour danser, soit la meilleure idée possible pour me mettre parfaitement à l’aise. Le photographe disparu derrière son appareil reparaît comme spectateur, dont je fais alors mon affaire. Je me retrouve sur scène, chez moi, à danser en T-shirt-culotte sans que personne ne me voit. Ou presque.
En soirée, je ne bois jamais une goutte d’alcool : la danse et la fatigue qui s’en suit suffisent à me désinhiber. Là, c’est un peu pareil, la fatigue en moins, les singeries en plus. Je fais le zouave et crapahute sur mon canapé orange, mains au plafond pour ne pas tomber ; j’ai cinq ans, je m’élance du couloir pour atterrir face contre le vieux canapé bleu affaissé qui n’existe plus. À cinq ans, rien n’est sexualisé : j’enlève la dernière robe sans retourner dans la salle de bain, enclenchant le mode vestiaire de danse post-cours (avant, on se défait de ses habits de ville mais on reste engoncé dans les manières d’une société sans corps : on se tourne le dos pour finir d’enfiler son justaucorps ; après une heure trente à suer en collants, le corps a repris ses droits et quand je sors en culotte de la douche-sauna, je m’affale sur un banc quelques instants pour essayer de refroidir un peu en ne me couvrant surtout pas – et même : qu’on ouvre la fenêtre, peu importe si on me voit ; de toutes façons, y’a pas grand-chose à voir).
Je ne te cache pas que généralement, y’a cinq minutes de gêne. Je ne dis pas que ce n’est pas étrange, que la nudité ne fait pas rentrer un peu plus en soi, et devenir un peu plus grave, soudain, mais il n’y a pas de gêne à proprement parler parce que le contexte est intime sans être érotique. C’est troublant, mais il n’y a pas la moindre ambiguïté : JoDasson ne regarde pas comme un homme mais un photographe. Il regarde à peine, en réalité, dévisage encore moins : il voit et cherche comment donner à voir. Ce n’est pas un regard-rayon x qui traverse et déshabille (force de la nudité qui se donne à voir : il n’y a plus rien à déshabiller). Ce n’est pas un regard qui fait du sujet un objet, en cherchant l’image plus que la personne : il cherche celle-ci à travers celle-là. Le corps, il le voit sans voir. Et ne renvoie rien, ni jugement, ni accusé de réception du regard en face : il s’est comme défait de son propriétaire ; c’est un regard abstrait, qui coupe la honte à la racine. Peut-être que mon corps me déborde, m’échappe, mais, caché derrière l’objectif ou seulement ce qu’il voit sans voir, le regard qui pourrait m’en informer se dérobe. La guerre de soi n’aura pas lieu – pas sur l’instant du moins : sur l’instant, c’est une force tranquille qui se découvre au sein même de la vulnérabilité. Une grande liberté, tu verras.

Le rapport de force que j’imaginais s’inverse : la proie que l’objectif devait shooter le fascine et le tient par sa fascination, comme un prédateur fige sa proie ; je regarde l’objectif comme s’il allait m’apprendre quelque chose sur moi, dont je pourrais me nourrir. Ce n’est que par intermittences que j’ai l’impression d’être débusquée, quand il me faut regarder ailleurs, ou quand je cesse un instant de bouger et que je réalise que je suis étalée par terre, en culotte, seins nus, face à un quasi inconnu. Mais plus que de la gêne, c’est une sorte de timidité subite qui survient alors, et pas désagréable, comme si on allait alors atteindre la justesse et révéler ce que l’on ne tait pas parce qu’il n’y a pas à dire – une asymptote de l’identité. Je regrette presque, ensuite, que l’on ne se soit pas davantage engagé dans ce chemin, mais après tout, le jeu, le mouvement, me caractérisent à plein ; capter la manière dont on se dérobe est peut-être la seule manière de faire surgir quelqu’un. Je ne me serais pas reconnue dans des poses lascives, qui ne correspondent pas à mon corps sans rondeur ni surtout à ma manière de me mouvoir (mais c’est tout un : JoPrincesse me faisait remarquer une fois, alors que nous débattions des significations associées au sexy, que certains corps dégagent une espèce d’aura sensuelle quand d’autres sont plus secs, plus énergiques, et c’est exactement ça – probablement aussi la raison pour laquelle je peux porter des mini-mini-jupes sans me faire emmerder).
Cela se finit, forcément. Le shooting. Le parquet crado est propre tellement je l’ai balayé de mes cheveux en dansant-roulant-traînant par terre et il est l’heure de dîner, mais : déjà ? Je suis presque déçue que cela s’arrête ; j’y avais pris goût. On discute dix minutes et JoDassin s’éclipse, coupant court à l’espèce de transfert qu’opère la gratitude lorsque quelqu’un vous fait vous sentir bien (je pourrais épouser mon ostéo quand je sors de consultation et qu’elle m’a remis d’aplomb…).
Voilà, expérience terminée. C’est ce que je croyais naïvement. Parce que : que dalle ! L’extrême bienveillance qu’instaure JoDasson pendant le shooting ne fait que repousser la confrontation avec un regard extérieur, qui n’aura donc pas été le sien sur moi, mais le mien sur mon image, un mois après, alors que l’emballement du moment était passé. C’est là que la difficulté a commencé.

Parmi la centaine de photos que JoDasson a conservées, il y en a quelques-unes qui m’ont plongées dans un état de narcissisme avancé, que j’aurais bien fait agrandir en poster s’il n’était pas un peu étrange et malaisant de s’avoir à demi-nue au-dessus de son canapé. Sur ces photos, c’est moi en mieux, moi comme je ne me vois pas (parce que j’ai du mal à y croire, peut-être, mais aussi parce que je n’ai pas de miroir au plafond et que mes boutons ne s’évanouissent pas dans un monde perpétuellement surexposé). Mais c’est moi, le visage que j’aime me voir, des pattes de bestioles, mains de grenouilles, cuisses de sauterelle, une maigreur vaguement maladroite, qui rappelle l’enfance avant le squelette. (Dans le douzième épisode du podcast La poudre, l’intervieweuse s’étonne et s’offusque presque de la manière tout aussi animalière dont Marie-Agnès Gillot se caractérise, sans voir qu’il y a aussi une sorte d’affection dans ce bestiaire en vrac.)


Mais il y a d’autres photos, tout aussi moi, où je ne me retrouve pas, où je ne supporte pas. C’est un rejet instinctif, une violente envie de se cacher le visage, de cacher la photo aux regards, même et surtout au sien propre.

On ne peut pas s’aimer sur cent clichés, c’est sûr (je trouve que c’est même un miracle de s’aimer sur plus d’une dizaine, mais on va m’accuser d’auto-dénigrement). Là où le bât blesse, c’est que JoDasson et moi n’aimons pas du tout les mêmes photographies ; or je n’ai envie ni de l’empêcher de montrer son travail, ni de lâcher dans la nature des images que je n’assume pas. JoDasson souligne la nécessité de séparer l’artistique (son affaire) de l’image publique (la mienne), mais ce n’est possible que jusqu’à un certain point : les partis pris esthétiques créent un effet dont vous assumez ou non qu’il vous soit associé. Je vous passe la noyade dans un verre d’eau, dans lequel le sentiment d’être redevable m’a plongée ; j’ai fini par trouver mon critère pour passer du j’aime / je n’aime pas au j’assume / je n’assume : si un collègue tombait sur une photo et me faisait une remarque, aurais-je l’aplomb de hausser les sourcils et de répondre Et alors ? Si je m’imagine bafouiller, je censure. Et alors ? J’assume.

Une fois établie la liste des photographies à ne pas publier, j’étais un peu écœurée d’avoir autant macéré dans mon image. Les images éprouvantes invalidaient celles où je me trouvais jolies : que ça soit publié et qu’on n’en parle plus. La publication sur Instagram m’a semblée une mise aux enchères ; j’ai compulsivement vérifié le nombre de likes à de trop nombreuses reprises, me confortant au passage dans l’idée que se tenir à l’écart des selfies n’était pas une mauvaise idée. Peu à peu, pourtant, à force de retourner voir les images, elles se sont détachées de moi et j’ai fini par les voir pour ce qu’elles sont : des images (stylées). Alors les likes m’ont amusée comme une course d’escargots, à deviner quelles photos passeraient non pas en premier (il y a des évidences de photos instagrammables) mais juste après. Il fallait que cela décante pour avoir envie de raconter, de montrer surtout, et qu’il ne reste plus de tout ça que mes photos préférées*, une espèce de kaléidoscope de ce que je peux être, qui me plaisent et me rassurent comme si j’avais là la preuve d’avoir joliment existé.

* Qui se recoupent partiellement avec les photos illustrant cet article, en partie choisies pour préserver, sinon mon anonymat, du moins ma control freakness concernant le recoupement identité-pseudonymat (que j’étais à deux doigts d’envoyer valser quand Palpatine m’a demandé si j’allais renoncer à mon pseudonyme sans visage par narcissisme)(même si, comme l’illustrait Eliness dans une réflexion à ce sujet, le visage et son image sont encore différents du nom et de l’identité civile)(du coup, j’ai opté pour des bouts de visage ou des angles qui rendent la reconnaissance malaisée).