 À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie. Le titre-dédicace place haut la barre sur l’échelle du passif-agressif. En même temps, on n’est plus vraiment sur un constat d’ami-connard ; à ce stade, ce serait presque de la non-assistance en danger. Nous sommes à la fin des années 1980, Hervé Guibert est séropositif et l’un de ses « amis » travaille pour un laboratoire qui teste un vaccin, lequel vaccin ne fonctionne pas à plein (nous sommes à la fin des années 1980), mais semble offrir quelques mois de répit dans l’avancée de la maladie. Or l’ami, tout en se posant comme sauveur, ne joint jamais le geste à la parole.
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie. Le titre-dédicace place haut la barre sur l’échelle du passif-agressif. En même temps, on n’est plus vraiment sur un constat d’ami-connard ; à ce stade, ce serait presque de la non-assistance en danger. Nous sommes à la fin des années 1980, Hervé Guibert est séropositif et l’un de ses « amis » travaille pour un laboratoire qui teste un vaccin, lequel vaccin ne fonctionne pas à plein (nous sommes à la fin des années 1980), mais semble offrir quelques mois de répit dans l’avancée de la maladie. Or l’ami, tout en se posant comme sauveur, ne joint jamais le geste à la parole.
Ça, c’est la fin du livre. Quand le temps du récit a rattrapé le temps de l’écriture. L’auteur s’accroche à cette ironie tragique pour clore son récit, pour rester vivant par la fiction qu’il crée, parce qu’il est dans la merde, comme il l’écrit — il meurt l’année suivant la parution de ce livre (qui n’est pas son dernier !). Avant cette pirouette romanesque qui donne son titre à l’ouvrage, c’est plus décousu. On pourrait dire que c’est : un témoignage de la maladie, de ce qu’on en connaît et en ignore à l’époque, du parcours médical qui se met en place une fois que l’auteur-narrateur a cessé de se leurrer sur sa possible contagion ; mais aussi : un récit fragmentaire de sa vie à lui, de son travail d’écriture, de ses amitiés (la catégorie d’ami semble englober indistinctement amis, amants et compagnons ; on prend les choses en cours de route, devinant puis comprenant au fur et à mesure qui sont pour lui Muzil, Jules et les autres). La forme est floue, les chapitres courts et nombreux ressemblent parfois à des entrées de journal, même si elles ne sont pas toujours datées et conjuguées comme telles. L’auteur n’a plus le luxe de s’assurer l’entièreté d’un récit rétrospectif au passé simple.
J’ai lu tout ça en me demandant pourquoi je le lisais. À la base, je me promenais dans les rayons de la médiathèque en me demandant à côté de qui je me trouverais si je publiais un livre (parce que pourquoi pas un petit fantasme narcissique pour créer une brèche dans les rayonnages serrés), mais la compagnie immédiate ne me disait rien et j’ai dérivé. Hervé Guibert est le premier nom connu qui est apparu. Étudiante à Paris III, j’avais lu un livre de lui sur la photo, qui m’avait fait forte impression — laquelle, je serais aujourd’hui bien en peine de le préciser, mais forte impression. J’ai aussi le souvenir de C. mentionnant À l’ami… même si je ne sais plus si c’était d’un point de vue uniquement littéraire ou littérature LGBT. Et peu importe au fond, puisque les recommandations amicales ne suffisent pas à elles seules à me convaincre d’entamer une lecture. Il doit y avoir autre chose, une occasion croisée. Peut-être était-ce un moyen d’ouvrir une fenêtre depuis ma précédente lecture, L’Été où tout a fondu, et d’offrir un sursis alternatif au personnage qui s’y suicide quand il découvre qu’est atteint du sida le mec qui, il n’y a pas d’autres termes du coup, l’a baisé (en connaissance de cause). Ou peut-être plus simplement cette forme de voyeurisme, de curiosité morbide (qu’est-ce savoir que se savoir condamné ?) était une manière d’exorciser la maladie devenue deuil, vécu par une amie proche. Je ne sais pas trop.
![]()
Je me suis vu à cet instant par hasard dans une glace, et je me suis trouvé extraordinairement beau, alors que je n’y voyais plus qu’un squelette depuis des mois. Je venais de découvrir quelque chose : il aurait fallu que je m’habitue à ce visage décharné que le miroir chaque fois me renvoie comme ne m’appartenant plus mais déjà à un cadavre, et il aurait fallu, comble ou interruption du narcissisme, que je réussis à l’aimer.
![]()
Totalement anecdotique, mais savoureux : à un moment, Hervé Guibert s’énerve contre un autre auteur et, parmi la flopée d’insultes, le traite de « diatribaveur enculeur de mouches salzbourgeoises » and I think it’s beautiful.

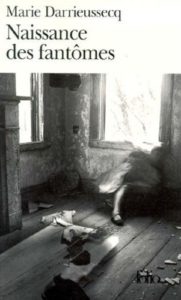 Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.
Naissance des fantômes, de Marie Darrieussecq. La titre m’a plu. La photographie de Francesca Woodman en couverture aussi. Ce livre était dans la boîte à livres de mon quartier… et risque d’y retourner sous peu, sans que cela soit un acte de générosité de ma part.




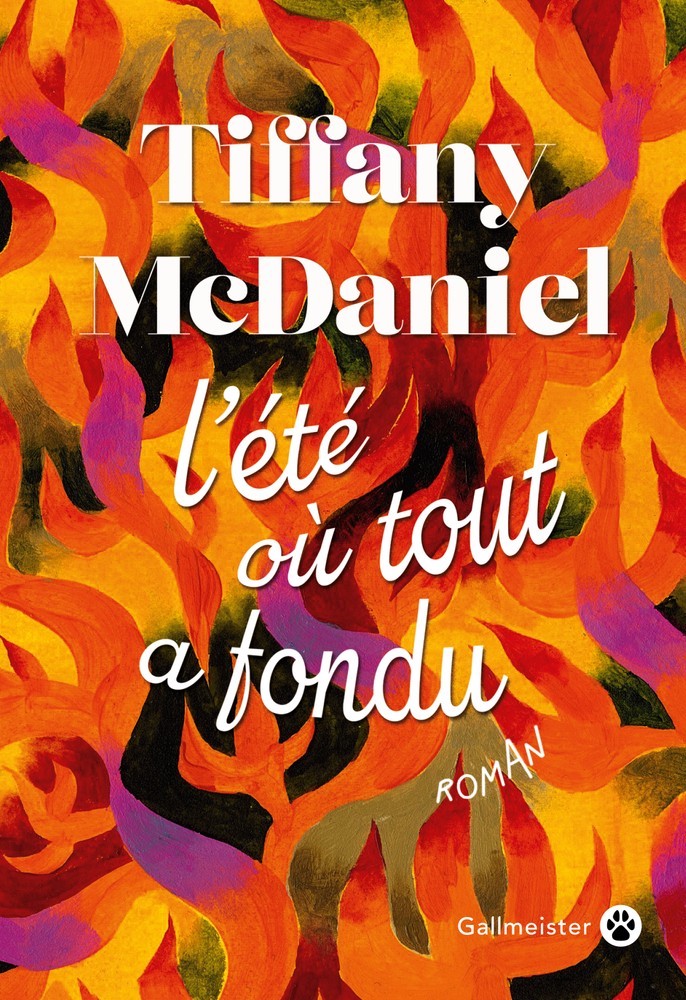
 La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.
La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.