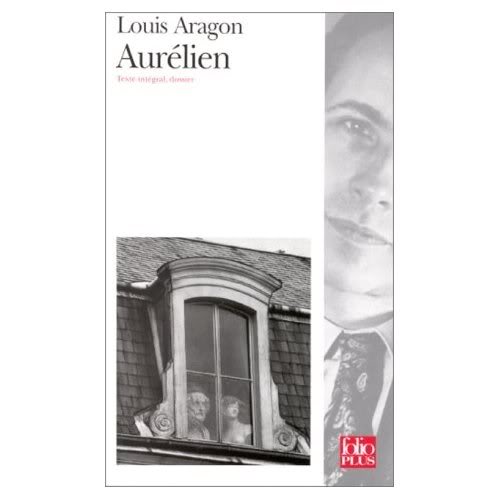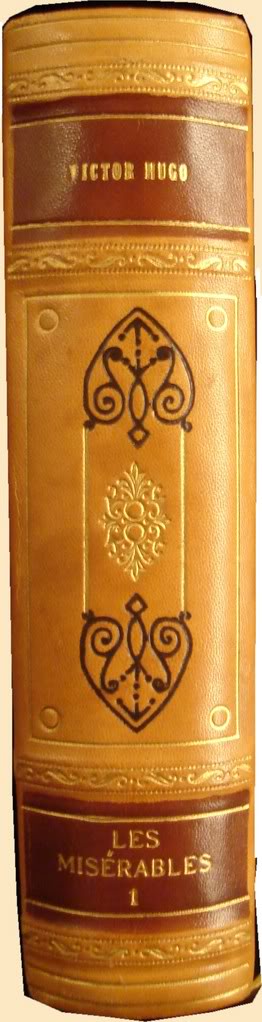Vous l’avez certainement déjà rencontré, cette histoire d’une fille qui rêve tant au prince charmant qu’elle en donne le label au premier venu, qui bien évidemment est vite détrompée –même si l’ersatz de prince est vraiment charmant-, mais par-delà ses cruelles désillusions soutient l’homme imparfait mais cependant aimable lorsqu’il entreprend de se fourrer dans une situation impossible.
Dans cette perspective, Giselle pourrait apparaître comme le précurseur de je ne sais quelle série télévisée. Transposition au XIX ème siècle où le prince en a vraiment le titre et où l’on n’avait pas encore démystifié le romantisme en naïveté. Théophile Gautier a composé l’argument pour Carlotta Grisi qu’il admirait éperdument et dont il épousa la sœur (si mes souvenirs sont bons). Il y a bien sûr un certain côté poussiéreux à la chose, la petite paysanne, la chaumière, les fantômes peuplant les forêt (et d’un point de vu tout chorégraphique, la pantomime, pas toujours lisible pour le non initié)… mais non dépourvu de pittoresque et de charme. Surtout quand on accepte de se laisser emporter par le ballet, ce qui est inévitablement le cas lorsque vous le dansez et que la musique vous rentre dans la peau. Que vous identifiez un personnage à son thème musical – « Bon, ce n’est pas compliqué les filles, sur les hilarions, vous faites un temps levé vers l’intérieur » dixit notre professeur-répétitrice-Giselle. Je vous entends d’ici… temps levé ? hilarions ? pas compliqué ? à côté Hegel est limpide.
Dans les grandes lignes, donc, voici l’histoire : Giselle, une petite paysanne qui adore danser tombe amoureuse d’un charmant jeune homme dont elle vient à apprendre le vrai visage : ce n’est pas un simple paysan, mais le prince Albrecht, déjà fiancé à la princesse Bathilde. Giselle en perd la raison et finit par mourir de déraison (c’est beau, romantique et lyrique, vous en rêvez déjà, non ? – toute irone mise à part, la scène de la folie est vraiment un moment génial). Après tant de joyeuses danses, c’est la tragédie, tout le monde pleure, le rideau se baisse. Vient l’acte blanc, où l’on retrouve Giselle, qui en tant que jeune femme fraîchement morte intègre les Willis. Ces jeunes femmes mortes avant leur mariage hantent les forêts et piègent tous les hommes qui viendront se prendre dans leurs filets – pas de pitié, ils danseront jusqu’à la mort. Une sorte de Corpse bride dansé, mais sur la musique d’Adolphe Adam. Vous pourrez toujours venir vous plaindre que c’est mièvre, vous serez reçu, je peux vous l’affirmer. En tant que reine des Willis, je soussigné, Myrtha, déclare avoir tout pouvoir discrétionnaire et tout loisir de me montrer froide, haute, distante, méprisante et par conséquent de vous envoyer bouler danser quand tel sera mon bon plaisir. Ce rôle est un délice. Donc quand Hilarion, amoureux de Giselle (au sens classique du terme) ramène ses pénates sur notre territoire, ni une ni deux, notre nature de mouche reprend le dessus et nous nous jetons sur lui jusqu’à la précipiter dans le lac. Un cas pour l’exemple en quelque sorte, Myrtha n’ayant aucune envie de penser le mal, penser la peine. Naturellement, lorsqu’à son tour Albrecht vient sur la tombe de Giselle, je lance une seconde offensive. Mais la petite nouvelle ne s’en laisse pas compter et tente d’intercéder auprès de moi en sa faveur. Niet. Bien entendu. Mais elle implore et gagne du temps, soutient son cher et tendre dans son épreuve de Marche ou crève Danse et crève, tant et si bien qu’elle parvient à la sauver. Non que je me sois laissée abuser, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Mais le gong a retenti sous la forme de trois petits coups de carillon égrainés depuis le village le plus proche : les Willis sont des êtres nocturnes, comme tous les fantômes et le jour les disperse. Giselle a réussi à sauver Albrecht. Ils ne se marièrent point et n’eurent point d’enfants. The end. Enfin un conte qui finit bien.
Le paradoxe dans le rôle d’un Willis, c’est de devoir donner d’impression d’immatérialité, de légèreté et d’évanescence tout en vous sentant terriblement matérielle dans vos pointes. Le long tutu blanc vaporeux ne suffisant manifestement pas à donner l’impression de légèreté tant recherchée, Myrtha passe sa vie à sauter. A la nuance près que Myrtha ne saute pas comme un petit cabri folâtre mais comme l’être désincarnée qu’elle est. Quand sur la version de l’Opéra de Paris (grâce soit rendue à Arte) vous remarquez que Marie-Agnès Gillot est essoufflée, vous blêmissez. Vous avez déjà la pâleur, c’est un bon point. Et lorsque vous vous mettez à répéter, alors là, vous êtes tout à fait dans le rôle : morte. Défunte élégante et non pas cadavre rigide cependant : nous sommes en plein romantisme, pas dans le feuilleton du jeudi soir à la morgue. Même s’il ne vous est désormais plus possible de mourir de honte, vous vous conduisez avec classe et dignité, sans rire – même quand votre fleur-baguette ponctue à contretemps votre geste aimable pour donner quelque ordre. Cette baguette peut donner lieu à des scènes fort comique à réserver uniquement au making-of de la chose. A un moment de ma variation, je cours de chaque côté de la scène pour lancer mes rameaux magiques dans les coulisses. Mais selon les deux principes qui veulent qu’il n’y ait pas de coulisses dans un studio de danse, et que l’on se dirige toujours dans la direction vers laquelle on porte son regard, j’ai attaqué une des mes consœurs Willis à coups de fleurs. Toujours dans la catégorie bonus du making-of, vous avez :
– le doux bruit des pointes neuves qui vous donne l’immatérialité d’un éléphant rose lors même que vous êtes censée ne pas toucher terre. Comme quoi, le monde immatériel des idées est bien bas.
– Hilarion qui saute toujours de désespoir au milieu de
la ronde infernale des Willis… mais de profil au public.
– Dans le premier acte lorsque Giselle passe montrer à ses amies le collier que viens de lui offrir Bathilde et que les petites jouant les amies en question regarde d’un air au mieux interrogateur, au pire morne, le collier en perles de rocailles que Giselle leur montre avec un air extasié : « Je sais que vous demandez ce qu’elle fiche là à nous montrer toujours son même collier. Mais il faut jouer la comédie. Sur scène on aura quelque chose d’un peu plus voyant, mais il faut imaginer. Là, je vous montre un truc incroyable ! Bathilde vient de me donner un véritable joyau ! jouez la comédie, ayez l’air un peu étonnée ! je ne sais pas moi, imaginez que c’est une rivière de diamant de chez Cartier ! »
Et j’étais sur le point d’oublier l’élément central de notre dernière répétition : les bandeaux. Non pas des bandeaux comme dans le lac des cygnes, non. Des bandeaux de cheveux ; les cheveux qui masquent les oreilles avant d’être ramenés en un chignon de gouvernante puritaine. Avec le bout des oreilles qui dépasse façon Mr Spok, c’est totalement sexy ! Et que dire de cet ornement délicieusement désuet lorsqu’il est oxymoriquement combiné avec une tunique de danse d’un design assez moderne et d’un chauffe difforme ? Nous n’avons donc pas manqué de nous payer notre propre tête. Néanmoins, il faut reconnaître à cette coiffure seyante le mérite de nous plonger de suite dans la peau d’une jeune fille angélique et pulmonaire du siècle dernier (enfin avant dernier pour être exact). On se consolera en pensant à Virginia Woolf.
Tout ça pour dire que si le cœur vous en dit, venez nous voir samedi et dimanche prochain au théâtre de Fontenay-le-Fleury.