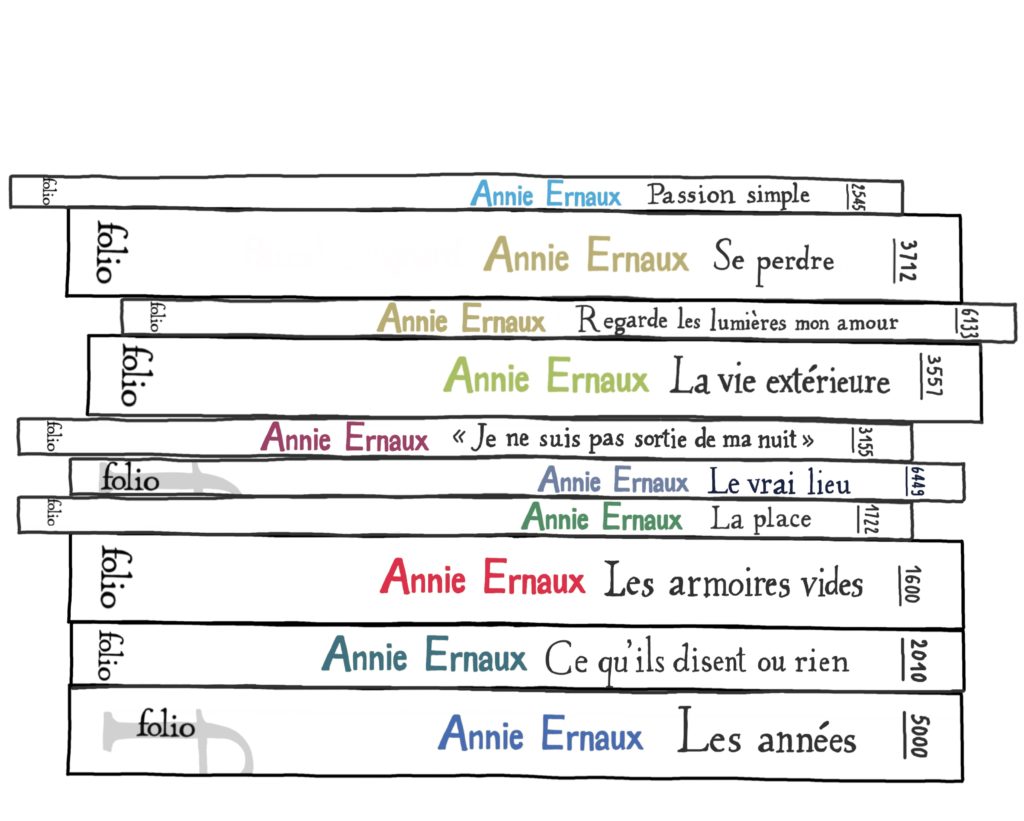
Les piles horizontales, ce sont les livres lus ces derniers mois ou dernières années, qui s’entassent chez moi au-dessus des bibliothèques en attendant d’être chroniquettés et d’acquérir ainsi leur droit à l’oubli. Aujourd’hui, une série consacrée à Annie Ernaux qui, avec Simone de Beauvoir et Alessandro Baricco, constitue l’une de mes grandes découvertes de mes 25-30 ans.

Ce livre très court a été ma porte d’entrée dans l’univers d’Annie Ernaux. Elle y décrit sa passion pour un homme, mais sans lyrisme aucun, aussi simplement qu’il est impossible de l’être. C’est son écriture blanche – blanche comme on dit d’une voix qu’elle est blanche – qui finit par bouleverser, dans l’écart qu’il y a entre ces phrases analytiques et le bouleversement d’une existence toute entière dirigée vers un autre que soi. On croirait entendre une femme qui revient des morts, et raconte ce qui lui est arrivé comme à une autre, qu’elle n’est déjà plus. Elle a tant vécu qu’elle ne vit plus qu’à demi ; on entend l’hébétude de qui vient tout juste de se réveiller – ni d’un rêve ni d’un cauchemar – un trauma inversé.
Et que tout cela commence à m’être aussi étranger que s’il s’agissait d’une autre femme ne change rien à ceci : grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l’autre, au point d’imaginer parfois la franchir.
J’ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps.
J’ai découvert de quoi on peut être capable, autant dire de tout. Désirs sublimes ou mortels, absence de dignité, croyances et conduites que je trouvais insensées chez les autres tant que je n’y avais pas moi-même recours. À son insu, il m’a reliée au monde.
Quand j’étais enfant, le luxe, c’était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de mer. Plus tard, j’ai cru que c’était mener une vie d’intellectuel. Il me semble maintenant que c’est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme.
Passion simple, toute fin du livre

Je n’ai pas lu ce livre-ci juste après Passion simple, mais quand j’ai compris qu’il s’agissait du même homme, j’ai ressenti une légère excitation – comme quand on s’installe pour retrouver ses personnages de série préférés. C’est la même histoire mais évidemment pas le même récit : alors que Passion simple est une sorte de synthèse a posteriori, Se perdre est constitué d’extraits de journal (retravaillés ?).
La temporalité est complètement différente : on est pris avec la narratrice dans l’attente, dans l’expérience de l’excitation qui monte et de la chute brusque dans le manque – avec cette caractéristique aussi évidente que déboussolante : les moments tant attendus de retrouvailles suspendent le récit. J’en avais déjà fait l’expérience avec les lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren – sauf que c’était là correspondance et non journal, publication posthume et non publication orchestrée.
Qu’elles soient narrées a posteriori ou passées sous ellipse, les heures qui nous sont retirées produisent dans Se perdre un tout autre effet que le pincement de déception éprouvé à la lecture d’une correspondance tronquée. La tension s’y engouffre et s’y abolit, pour renaître un peu plus tard, encore et encore. De la passion, nous ne partageons pas l’acmé, mais nous prenons conscience du processus qui toujours y tend, et l’on ressent encore mieux ce que concluait Annie Ernaux dans Passion simple : « J’ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. » Toutes ces heures abolies sitôt le corps de l’autre retrouvé, dans une sorte d’éternité, et néanmoins rythmées par toutes sortes d’atermoiements, de pensées, de désirs pour maintenir la fiction d’une présence, la crainte de la fin, l’espoir contradictoire, et les éclairs de lucidité sur la dissolution de soi dans l’autre…
Je n’apprends plus le russe et tout ce qui est lié à l’histoire de l’an passé n’a plus de sens : je ne vois que passion vide de volonté, mais il n’en pouvait être autrement. Et c’est cette constatation qui est affreuse. La vraie vie est dans la passion, avec le désir de mort. Et cette vie-là n’est pas créatrice. Les semaines passées à relire Beauvoir, Sartre, à réfléchir ont été le plus sûr dégrisement.
p. 368. (Je ne me souvenais pas de ce passage, des noms cités ; j’aime ces occurrences croisées.)

Je me souviens avoir emporté La vie extérieureà Séville. Cergy à Séville, drôle de géographie.
La Vie extérieure, ce sont des journaux rendus extimes par les extraits qui y sont prélevés, dirigés vers l’extérieur plutôt que soi : des fragments de vie qui ont souvent pour cadre des non-lieux ou des lieux de passage, métro, RER, télévision, Leclerc, Auchan… ; des saynètes comme Gilda en rapporte parfois sur son blog ; des réflexions ébauchées.
Dans mon esprit, La Vie extérieure se confond avec Regarde les lumières mon amour, qui opère d’autant mieux que son champ se resserre : ce ne sont plus que les centres commerciaux et même, l’hypermarché, non-lieu moderne par excellence. Annie Ernaux rapporte des scènes qui y ont lieu, mais aussi, surtout, le relate comme une expérience à part entière, et réussit à nous rendre tout le temps qu’on y a passé, que l’on croyait perdu.
Peut-être existe-t-il une mélancolie spéciale des hypermarchés.
Regarde les lumières mon amour, p. 97

Encore des extraits de journal, cette fois-ci sur la vieillesse, la maladie puis la mort de sa mère, atteinte d’Alzheimer. C’est très facile et très difficile à lire. Cela m’a fait un peu le même effet que le film Amour, de Haneke – l’étau qui se resserre, la vie, la mort, dans la gorge, précisément parce qu’elle évite « en écrivant, de [se] laisser aller à l’émotion ».
Je me suis aperçue qu’entre deux visites je l’oubliais.
p. 40
Pour la première fois, je me suis représenté sa vie ici, en dehors de mes visites, les repas dans la salle, l’attente. Je me prépare des tonnes de culpabilité pour l’avenir. Mais la garder avec moi était cesser de vivre. Elle ou moi.
p. 47
Ce matin, il me semblait qu’elle était encore vivante. À la boulangerie, devant les gâteaux, » je n’ai plus besoin d’en acheter », comme « je n’ai plus besoin d’aller à l’hôpital ».
p. 114

Il y a peu d’auteurs que j’ai assez lu pour avoir le sens d’une oeuvre ; il y a eu Kundera, pour mon mémoire de master. Ce n’est depuis peu que je transpose cette idée de complétude, lire tout d’un auteur, dans mes lectures personnelles. Avant, d’un auteur que j’aimais, je me gardais de tout lire, parce qu’il fallait qu’il m’en reste toujours au moins un en réserve, un livre dont je suis sûre qu’il va me plaire : j’ai encore un Daniel Pennac (dédicacé !) figé dans cet état-là. Peut-être est-ce parce que je ne cesse de passer au travers du temps : je préfère lire maintenant. C’est comme ça que je me suis constitué le triumvirat de ces dernières années, Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Alessandra Baricco.
On finit, je commence, par ne plus savoir très bien d’où vient quoi. Surtout dans le cas d’Annie Ernaux, qui n’en finit pas de puiser dans sa vie, et de revenir à des épisodes fondemantaux. Chaque livre devient comme une pierre dans un mur, avec ses propres aspérités, appartenant à un tout. Dans ce mur, Le vrai lieu est une petite pierre venue s’insérer dans un trou un peu grand, qu’on aurait pu néanmoins combler de ciment. Ce livre d’Entretiens n’est pas indispensable, mais il éclaire à nouveau un pan de vie, d’oeuvres, les autres livres qui absorbent cette lumière et la résorbent dans mon souvenir. Alors que c’est un des derniers livres que j’ai lus, dans ma chronologie de découverte d’Annie Ernaux, je n’en ai pas de souvenir précis ; je crois seulement qu’il m’a mieux fait comprendre la spécificité et le pourquoi du ton des premiers romans, avant que la langue blanche, à laquelle j’assimilais entièrement le style d’Annie Ernaux, ne vienne les recouvrir.
J’ai mis plus de temps pour découvrir la forme de La Place, cette écriture factuelle des choses, qui n’est au fond que de la violence rentrée et non plus exhibée comme dans Les Armoires vides, une violence d’autant plus agissante, je crois, que l’écriture se contente de montrer les faits, sans les commenter.
p. 107
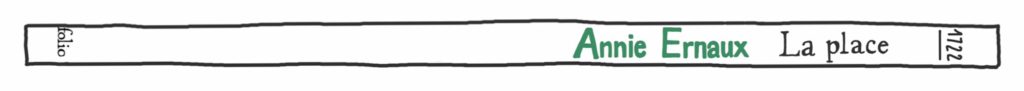
Longtemps, croisant ce titre dans les rayonnages des bibliothèques, j’ai cru que La Place faisait référence à la place du village et j’y ai assimilé l’esprit de clocher d’une littérature à la Marcel Pagnol. Cela m’a tenue à distance de ce court mais poignant livre, qui constitue une porte d’entrée privilégiée dans l’oeuvre d’Annie Ernaux – privilégiée par l’école, entre autres, parce que c’est pour ainsi dire du Bourdieu incarné (ô combien plus compréhensible).
Palpatine ne lit pas de roman, et c’est dommage parce qu’il ne pourra pas confirmer ou infirmer qu’il y a là, en substance, l’expérience qu’il a vécue, et qu’il a essayé de me communiquer à plusieurs reprises sans que j’en sente la portée (il faut dire aussi que le décalage social est probablement moins grand, opéré sur deux générations plutôt qu’une) : la fierté et l’incompréhension mêlée des parents à mesure que l’enfant dépasse leurs capacités ; auxquelles font pièce la honte et la fierté mêlée de l’enfant (qui bientôt n’en est plus un) pour le milieu dont il vient et dont il n’est plus, qu’il peut critiquer à part soi mais défendra toujours face aux autres, qui ne savent pas (justement parce qu’ils sont savant). Ni du milieu dont ils viennent, ni du milieu où ils sont arrivés : les transfuges de classe.
J’ai fini de mettre au jour l’héritage que j’ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand j’y suis entrée.
p. 111, deux pages avant la fin
La Place est évidemment plus qu’une illustration sociologique. C’est aussi et avant tout le récit d’une relation père-fille, le portrait d’un père que l’auteur, la narratrice, continue d’aimer et d’admirer quand bien même elle a renié, sur ses encouragements, les valeurs et le mode de vie qui étaient les siens. L’auteur fait retour sur le monde de son enfance, contre lequel elle s’est construite : tout contre, en lui tournant le dos. Elle y revient, d’une manière qui laisse à sentir autant le lien que la distance : le déchirement – rentré, dans la langue acquise à l’école, qui, sans être étrangère, n’est pas celle des parents.
Je dis souvent « nous » maintenant, parce que j’ai longtemps pensé de cette façon et je ne sais pas quand j’ai cessé de le faire.
p. 61
Il m’aura en effet fallu du temps pour comprendre que le style simple d’Annie Ernaux n’est pas simple du tout, qu’il est en réalité le fruit de longues négociations entre la langue maternelle et le Français châtié qu’on lui a enseigné. La simplicité n’a pas été donnée mais construite, par soustraction des fantaisies patoises comme des fioritures du tout style qui se pense tel, avec pour résultat une syntaxe épurée qui n’est représentative d’aucun monde, mais compréhensible des deux. Un trait beau trait d’union-désunion.
Peut-être sa plus grande fierté, ou même, la justification de son existence : que j’appartienne au monde qui l’avait dédaigné.
p. 112
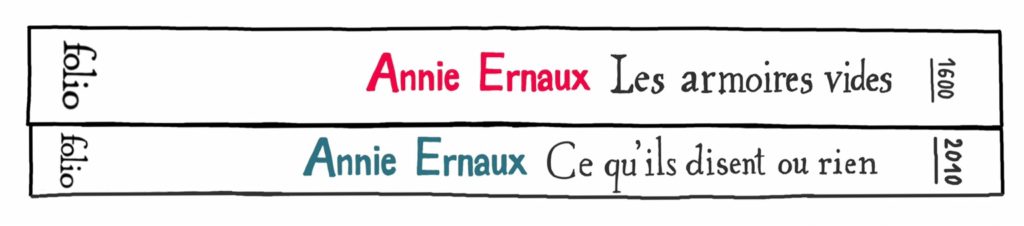
Ces deux romans-ci on fusionné dans ma mémoire. Ce sont des été de vacances qui n’en finissent pas, poisseux, dans l’épicerie familiale, des tentatives pour s’extirper de la torpeur et de la surveillance de la mère – qui veut mieux pour sa fille que fille-mère et la flique ; les garçons, les filles, le flirt, les rancoeurs adolescentes et le désir qui pègue comme les confitures qui n’existent pas dans Les armoires vides, pas plus que le sang des règles, qui ne coule plus.
J’ai été surprise à la lecture du ton différent – des autres livres d’Annie Ernaux. Dans Les Armoires vides, d’ailleurs, ce n’est pas Annie Ernaux, c’est Denise Lesur. Je n’avais pas fait gaffe à la chronologie propre de l’auteur (je n’y fais jamais gaffe), et j’ai apprécié les romans en eux-mêmes avant qu’il me vienne à l’esprit (à la lecture du Vrai lieu) de les resituer dans un processus d’écriture et de raffinement qui auraient pu me les faire voir comme du sous-Annie Ernaux, du Annie Ernaux en maturation.
Heureusement, ces idées à la con ne viennent qu’après-coup : la lecture entraîne, une écriture qui parle comme on crache – ça balance. L’adolescence, et avant et après, dans toute sa violence. On ne peut que suivre, même si c’est parfois plus difficile, dans cette fusion de langue qui n’est pas tout la nôtre, la mienne en tous cas, avec les expressions d’une époque, d’un milieu qui se vengerait ainsi par avance de toute velléité de mépris. Faut suivre, merde.
Un jour, enfin, un garçon du collège a dit de moi « vachement relaxe, cette fille », ça m’a fait cent fois plus de plaisir qu’un 20 sur 20 en math. Relaxe, ça se dit pas des péquenaudes, des pouffiasses, ni même d’Odette, agrippée à son vieux biclou qu’elle enfourche pour rentrer à la ferme, la jupe bien collée sous les fesses. Il m’avait fallu presque deux ans pour arriver à ma gloire, être relaxe comme les autres filles, balancer mon prte-documents à bout de bras, parler l’argot des collégiens, connaître les Platters, Paul Anka et l’Adagio d’Albinoni. Le reste doit suivre bientôt, un « flirt » qui me sortira complètement de moi-même et de mon milieu.
Les Armoires vides, p. 127

Quand on pense flux de conscience, on pense flux de conscience individuel. Annie Ernaux réussit en quelque sorte avec Les Années l’écriture d’un flux de conscience collectif, où le pronom « on » fait tantôt référence à un individu, réinscrit dans son époque, tantôt à une communauté, incarnée ou exemplifiée par un individu.
Évidemment, le glissement induit un biais, qui n’en rend les choses que plus intéressantes : le « on » collectif étant celui dans lequel le « on » individuel de la narration se reconnaît, il en est teinté : de l’individu à la génération, c’est une famille, un groupe d’amis, de connaissances, un groupe, une classe sociales, un cercle géographique, une génération et ses collatérales – collectif à géométrie variable qui, à chaque transformation, dégage quelque chose comme l’air du temps. Rapporté à l’individu, ce biais collectif n’est plus seulement historiquement ancré ; il devient émouvant.
Les années, ce sont ces années-là, mais aussi les années qui passent, font et défont les individus, les familles, les vies, celle d’Annie Ernaux comme les autres : car c’est bien sa biographie que l’on retrouve là en filigrane. La troisième personne du singulier induit une distance par rapport à l’habituelle narration à la première personne : on la suit ainsi comme derrière une vitre, une vie en boîte de Pétri qui se développe en accéléré sous nos yeux, le mariage, les enfants, le divorce, tout ça inclus dans une société donnée, de consommation – et de littérature, de sensibilité, toujours, avec Annie Ernaux.
Elle a perdu son sentiment d’avenir, cette sorte de fond illimité sur lequel se projetaient ses gestes, ses actes, une attente des choses inconnues et bonnes qui l’habitait […].
C’est un sentiment d’urgence qui la remplace, la ravage. […] C’est maintenant qu’elle doit mettre en forme par l’écriture son absence future, entreprendre ce livre, encore à l’état d’ébauche et de milliers de notes, qui double son existence depuis plus de vingt ans, devant du même coup couvrir une durée de plus en plus longue.
[…]Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent au fur et à mesure jusqu’à la dernière image d’une vie.
