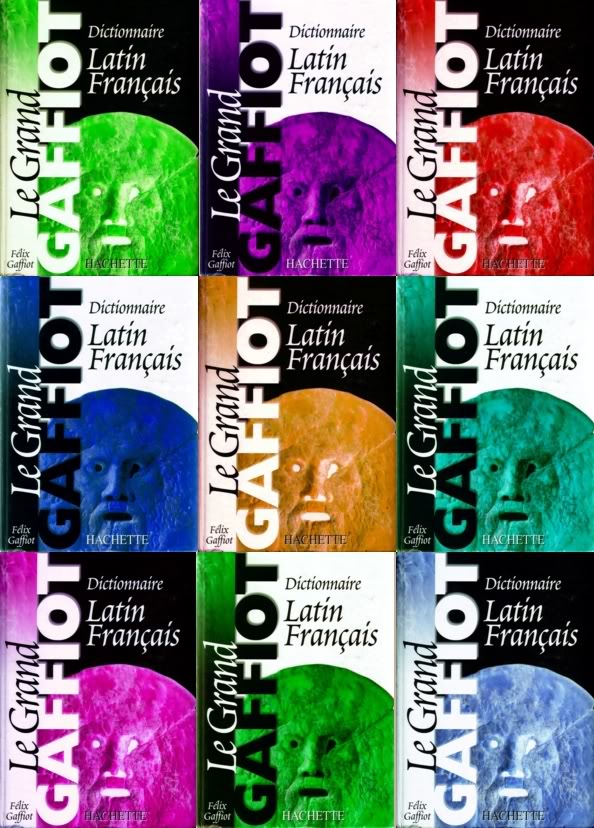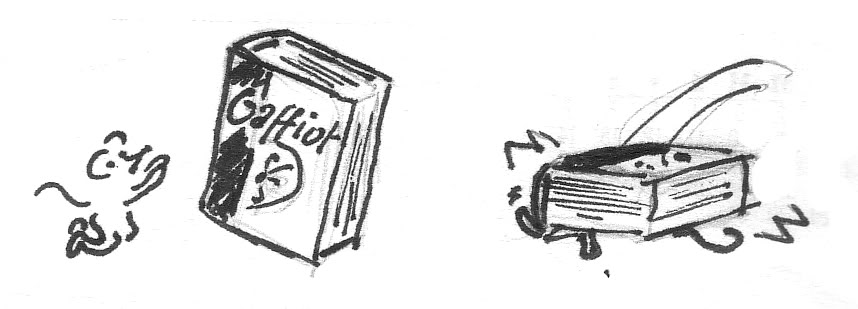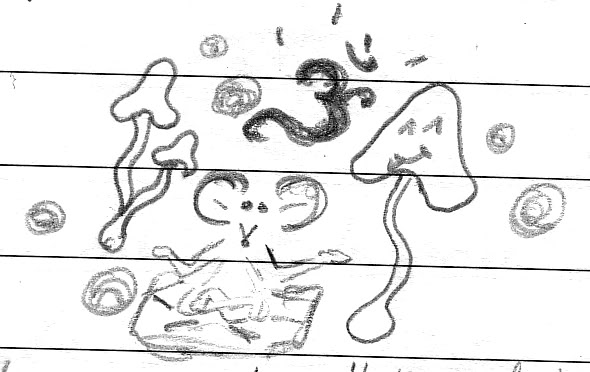…. le questionnaire pascalien, fragment 512 pour les fanatiques ^^
Dans votre bibliothèque, les livres sont plutôt rangés :
m par ordre alphabétique d’auteur ou de titre
u par collection/ édition/ de façon harmonieuse à l’œil
q par collection et à l’intérieur de chaque collection par auteur ou si vous êtes un serial liseur d’auteur en série, par auteur et à l’intérieur de chaque auteur (enfin de son aire d’influence sur l’étagère- les entrailles, ce n’est pas trop mon tripe) par collection.
Vous comprenez mieux lorsque :
m on vous fait un exposé lent et structuré avec des parties bien délimitées et des articulations clairement visibles (avec tout plein de décalages dans la disposition typographique, du souligné, voire des couleurs ou soyons fous, du stabilotage en délire)
u le sujet est analysé, pris et repris, détaillé, précisé, que l’on approfondit certains points plutôt que d’autres : ainsi dans la multitude des (re)formulations, vous en trouvez toujours une percutante qui vous parle. Genre « la pièce est tombée », c’est l’illumination qui permet rétrospectivement de tout comprendre (sauf s’il s’agit de la Physique d’Aristote).
q personne ne vous explique
Vous réussissez mieux :
m les dissertations
u les commentaires de texte
q les deux, mon capitaine
Pour faire une dissertation :
m après y avoir un peu beaucoup réfléchi, avoir lu et surligné la moitié des ressources de l’Amazonie en polycopiés, vous articulez vos idées et élaborez un plan que vous étoffez au fur et à mesure ; les exemples prennent tout naturellement leur place (un petit coup d’articulation acrobatique s’ils rechignent à entrer dans la case assignée) – et si le Ciel est avec vous, de nouvelles idées et précisions vous viennent pendant la rédaction.
u vous noircissez des pages et des pages de brouillons, en jetant les idées morcellées comme elles vous viennent. Puis vous tentez d’ordonner le magma à coups de délimitations, d’encadrés, de numéros, de sous-parties, de renvois, de flèches, barrées, puis réhabilitées, mais peut-être barrées en fin de compte, vous ne savez plus très bien. Quand cela ressemble à un champ de bataille, vous commencez à avoir un semblant de plan et partant, une vague idée de la problématique. Vous passez alors à la bataille décisive, stabilo à la main, une couleur par partie voire sous-partie et, agressés par tant d’illuminations, la mal de crâne survient, qui n’aura d’égal que celui que vous aurez dans deux jours, quand à la rédaction, il faudra jongler avec les renvois, les feuilles étalées sur votre bureau ( les jours de chance et de faible inspiration) ou par terre, la feuille désirée étant invariablement introuvable – cela vire au cauchemardesque si vos brouillons sont recto-versos.
q Vous écrivez au fil de la plume.
Vous êtes un littéraire (désolée Miss Me, tu peux toujours imaginer), votre profil est plutôt :
m philosophique
u littéraire
q cultivé
Vous êtes doués pour expliquer :
m oui
u non
q merde
En langue, vous êtes plus à l’aise :
m dans la rigueur de l’allemand ou du latin
u dans les subtilités de l’anglais – dash !
q pour embrasser – de toute manière, vous êtes polyglotte
Vous arrivez à la fin du questionnaire :
m vous ne voyez toujours pas où je vous mèn
e ou pourquoi, il aurait mieux valu un article rédigé
u cela fait trois questions que vous cocher systématiquement le losange sans même lire
q enfin ! Ce n’est pas plus intelligent que les tests de Cosmo et c’est moins drôle
Faites-vos jeux, m’sieurs dames !
Vous avez un maximum de m : vous avez un esprit de géométrie, à vous la patience du concept ! Vous raisonnez plutôt justement et surtout, vous faites l’effort de vous arracher du sens commun pour vous orienter vers les premiers principes. Vous n’étiez pas du genre à demander toujours « Pourquoi ? » quand vous étiez petit ?
+ vous êtes logique et potentiellement organisé, éloigné du sens commun dès que vous éteignez votre télé
– à avoir trop de cases, parfois on a l’impression qu’il nous en manque une
Vous avez un maximum de u : vous avez un esprit de finesse (auquel viendra ou non s’ajouter un esprit de justesse dans le raisonnement). Vous saisissez en un clin d’œil et voyez dans chaque détail un foisonnement. Touche à tout ?
+ vous êtes nuancé, vous comprenez vite
– vous êtes souvent incapable d’expliquer quoi que ce soit, les autres comprennent toujours trop lentement à votre goût. Vous risquez également de tomber dans le sens commun. Et bonjour le temps passé à faire des plans de dissert.
Vous avez un maximum de q : vous êtes au choix :
– un anti-pascalien
– un indécis du questionnaire – maladie dont je souffre également souvent
– une personne dépourvue de cœur, au sens pascalien du terme, i.e, vous n’avez pas d’intuition et vous raisonnez comme un pied, i.e. peu et fort mal.
– un emmerdeur / un menteur / un tricheur / un vantard / un maniaque / un misanthrope / un inconscient
– un génie qui allie l’esprit de finesse à l’esprit de géométrie avec un zeste de dandysme. Risque de retomber dans le second terme ci-dessus.