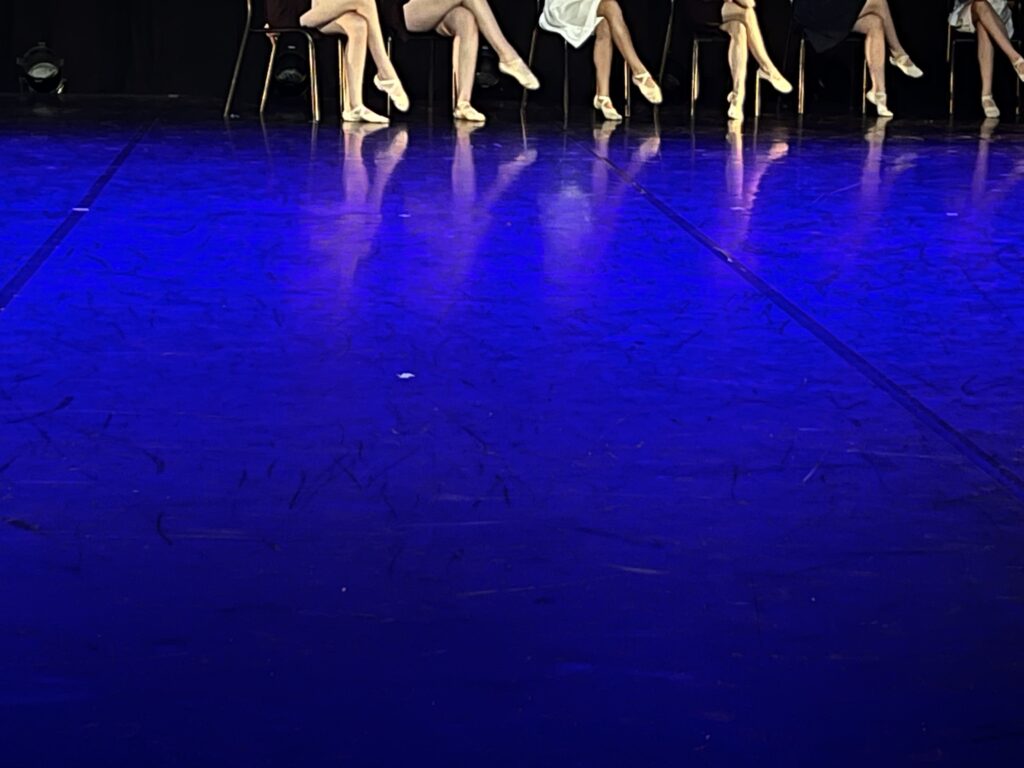Le vent d’est fait fondre la glace
Mardi 4 février
Mes félicitations à la cohorte actuelle des darons qui ont fait découvrir les dessins animés de leur enfance à eux à la génération Z. Les ados du conservatoire s’amusent de reconnaître la musique des Artistochats dans les dégagés, ça donne envie de chanter. Je les y encourage sur le ton de la blague, il faut juste se mettre d’accord pour chanter en français ou en anglais. Prudemment, personne ne connaît les paroles. Je leur promets Pocahontas pour la jambe sur la barre, après des morceaux du répertoire. La moitié des jambes sont sur la barre quand une jeune fille se met à chanter aussi fort que brièvement la totalité des paroles dont elle se souvient … un tapis de poussièèèèère… Éclat de rire général. La dissipation qui, dans un cours adulte, serait passée avec l’exercice demeure avec les ado pendant toute l’heure — c’est joyeux, mais à éviter.
Après le cours de barre à terre, nous sommes trois à avoir les muscles tétanisés au niveau de l’aine. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir étiré le psoas. Je repasse mentalement les exercices, que nous avons pourtant déjà tous faits : est-ce le froid ? l’enchaînement (tous les exercices sont dorénavant connus, on les enchaîne plus rapidement après un rapide rappel) ? l’ordre des exercices (j’ai anticipé sur ceux qui donnent chaud pour qu’on ne se gèle pas trop longtemps sur les fins tapis) ?

Mercredi 5 février
Risshun, le début du printemps, moui moui. Surtout sur les portants des boutiques de fringues. J’essaye trois leggings sur ma pause déjeuner, respectivement trop petit, trop grand, trop moche (comment est-il possible qu’un vêtement opaque plus épais qu’un collant souligne la cellulite ?).
Le bonnet enfoncé sur les oreilles, l’espace entre le manteau et l’écharpe calfeutré par de fréquents réajustements, j’ai tendu mon visage dix minutes au soleil, assise sur un banc. Finalement, entrevoir le début du printemps ? L’apaisement qui en a résulté m’a conduite plus sereine dans l’après-midi.
J’adore ton bonnet nounours, me dit une élève-maman qui récupère son fils au cours de danse. Je savais qu’on était compatibles. On échange à trois avec la maman aux immenses lunettes que j’ai croisée hier dans le cabinet où exerce ma psy. Elle a raison, on se croise le mercredi et je suis rassurée de n’avoir pas su dire de qui elle était la mère : son enfant n’est pas en cours avec moi.
On peut toujours compter sur les chansons Disney adaptées par Nate Fifield pour pimper le cours de danse. Aujourd’hui, une enfant reconnaît la musique des Aristochats et sa voisine de barre s’interroge : ce n’est pas Les Aristocrates plutôt ? On explique le jeu de mots. La semaine prochaine, Marx et Bourdieu au cours de danse — ah non raté, vacances.
Avec mes 6 ans, je m’emploie pendant tout le cours à faire observer une règle toute simple que j’aurais dû mettre en place depuis le début : si on veut dire ou demander quelque chose, on lève la main : sinon on ne parle pas. Comme à l’école ?! La stupeur est à son comble. Jusque-là j’ai laissé dans tous mes cours les interactions surgir spontanées ; elles étaient mesurées, cela m’allait bien. Mais les petites ont gagné en assurance, en copines inscrites en cours d’année et j’ai perdu mon sang-froid à plusieurs reprises les semaines passées. Je ne peux pas me permettre de les rappeler au calme d’une manière qui l’est bien peu ; elles ne comprennent pas ce qui s’apparente alors à une colère arbitraire. J’avais oublié que, pour recadrer, il faut avoir posé un cadre. C’est chose faite et refaite aujourd’hui, soulignant à chaque prise de parole intempestive qu’il n’y avait pas eu de main levée, même si la question est très bonne souvent. Je sens que ça va apaiser mon agacement face à l’incontinence verbale d’une certaine petite fille.
Cinquième semaine sur la même base de cours : ça y est, je constate des progrès dans certaines classes. Des coordinations se précisent, des losanges commencent à apparaître quand les petites plient les deux jambes dans les fondus ou jetés, et les intermédiaires ne se trompent presque quand on enchaîne devant/derrière/seconde à la barre au lieu de devant/seconde/derrière sans changer de pied. J’ai moins l’impression d’écoper les heures. Non, je ne fais pas qu’animer et meubler (ce à quoi je m’étais résignée pour me préserver mais qui me dépitait), les enfants peuvent progresser avec moi. Ça remet un peu de sens et d’enthousiasme dans la fatigue.
Au final, une bonne journée, pourtant commencée avec les muscles tétanisés (impossible de courir pour rattraper mon retard sur le chemin du métro) et quinze minutes de marche vigoureuse dans le froid après avoir loupé le bus.

Jeudi 6 février
Le kiné se souvient de moi et n’a pas l’air de trouver que je l’ai ghosté après la dernière séance pour mes lombaires, que je n’avais pas anticipé être la dernière. Il ne m’apprend rien, sinon que les électrodes sont loin de faire autour du genou l’effet massage qu’elles prodiguaient dans le dos.
Les niveaux et profils divers me font douter de mes exercices en barre au sol : les concepts de la danse classiques sont évidents pour certains, hermétiques pour d’autres (en-dehors ? vers où ?) ; les étirements ne font rien aux hyperlaxes tandis que les plus raides galèrent parfois à adopter la position de base, condition préalable à l’exercice ; le gainage et renforcement musculaire laissent perplexes celles qui font de la muscu ou du fitness par ailleurs (qu’est-ce qu’on est censé sentir ?) tandis que d’autres doivent s’interrompre avant la fin de l’exercice. Peut-être que mon mélange de barre, pilates, yoga, renforcement musculaire est un peu trop foutraque et que je devrais revenir à un barre au sol qui soit vraiment la transposition de la barre classique au sol (mais ça défonce le psoas, je trouve, sans forcément aider davantage à comprendre ce qui se joue dans le mouvement). De plus en plus, j’ai envie d’aller vers des moments d’ateliers qui aident à la compréhension et à la sensation, mais ce n’est pas hyper compatible avec un exercice rythmé en musique.
Je lance mes adultes débutants dans les tours piqués. Elles s’en sortent pas mal du tout, ça me met en joie. L’une semble même avoir fait ça toute sa vie. Tu es bien sûre que tu n’en avais jamais fait ? À l’extrême inverse, il y a cette femme aux yeux qui brillent et au corps tellement maigre que les muscles ne font pas le poids pour assurer un minimum d’équilibre. Impossible non plus de s’ancrer avec le regard, elle a la tête qui tourne dès qu’elle essaye de spotter. Après cinq mois à la voir chaque semaine, à apprendre entre deux portes son métier, s’installe la possibilité, la quasi-évidence d’une maladie que je n’avais pas vue, la forme du corps effacée derrière celle des mouvements.
Sur le trottoir devant l’école, on cause chocolat noir : dose quotidienne, pourcentage de cacao, prix et dealers recommandables.
Il me semblait bien que les bibliothèques de Paris mettaient à disposition des ressources numériques pour réviser le code de la route. Remettant la main sur mes mots de passe pour le boyfriend, je me connecte à la base d’apprentissage en ligne et découvre tout un tas de choses qui me font frétiller : de quoi reprendre l’apprentissage de l’italien après avoir fini le parcours de Duolingo ! une base de vidéos pour le dessin façon Skillshare ! Tout ça pour la modique somme de rien, nada, c’est gratuit du moment que l’on se présente dans une médiathèque parisienne pour se faire faire une carte. (J’ai pensé à toi, Dame Ambre, pour le dessin !) Il est minuit passé, je clique sur des cœurs de partout, favori, favori, favori.

Vendredi 7 février
E que s’apelerio fatigue.
Dernier remplacement à assurer. Je devais être accompagnée, j’ai chantonné mes musiques sous la douche, aux toilettes, toute la matinée pour ne pas être prise au dépourvu, mais il n’y a pas de pianiste. Je branche l’adaptateur, mon téléphone et rebondis entre les playlists.
Je pensais avoir les grands en plus des élèves suivis jusque-là : ce sont en réalité des débuts de cycle, plus jeunes. Forcément, mes exercices sont un poil trop compliqués pour eux, mais ils ne sont pas du tout pour une simplification à laquelle je réfléchis à voix haute, avides au contraire d’accéder à un niveau supérieur au leur — on apprend des choses différentes ! qu’ils me disent sur le ton de bas les pattes, give us the real deal. C’est une aubaine pour eux, un contretemps pour les plus grands.
Huit élèves doivent exceptionnellement aller répéter ailleurs à moins le quart mais à moins le quart leur prof est en réunion, ils reviennent, repartent, reviennent, on fait un exercice de pointes au milieu, il n’y a plus de pointes, ah si, faisons-en un et après vous les retirez, ah vous voulez les garder ? si vous voulez les garder, gardez-les, mais on ne fera pas d’exercices dédiés.
Les micro-décisions engendrées par ces réajustements constants deviennent coûteuses avec la fatigue, de plus en plus difficiles à prendre, de moins en moins cohérentes. Juste, arriver au bout.

Les fauvettes chantent à nouveau dans les montagnes
Samedi 8 février
Le visage de l’élève-pianiste me fascine sans que je sache pourquoi, un visage d’actrice, je me dis tout en sachant que cela ne veut rien dire, et bien plus tard mais c’est bien sûr : elle a la grâce nonchalante de Casey dans Atypical.
Dernier cours avant les vacances puis le spectacle : nous avons un blessé et trop d’absents pour réorganiser le placement. Le violon est en réalité un alto, qui ne m’a jamais corrigée ; l’accompagnatrice le fait sans ménagement. Il n’y a plus non plus d’aménagement dans la musique, on n’y peut rien si la note est longue. Ce qu’on peut, c’est ajuster la chorégraphie, alors j’amende, encore une fois — une correction que les absentes ne sont pas là pour incorporer, que les autres leur passeront j’espère lors de l’ultime répétition pendant laquelle je donnerai cours à d’autres. Tout cela est approximatif, j’en ai bien conscience et en prends mon parti, il n’y a plus grand-chose d’autre à faire. Avec les tuniques à voile taille Empire, ça passe dans le mouvement. Les filles semblent ravies de les porter, tiennent dès l’essayage à répéter avec. Je note des prénoms qui ne sont pas les leurs, mais ceux d’élèves qui les ont précédées et figurent sur les étiquettes, pour savoir quelles bretelles il faudra rallonger ou raccourcir ; j’apporterai de quoi coudre lors de la répétition générale.
Tout est un peu chaotique, mais doux aussi dans ce moment d’à-quoi-bon, de renoncement à la panique. Une partie de moi est un peu émue lorsque je suspends les costumes par grappe à des cintres — et glisse en-dessous le carton avec les tuniques qui n’ont pas été attribuées, dont je prie qu’elles aillent aux absentes (si seulement je n’avais pas oublié la semaine d’avant). La fluidité des tissus roses et mauves baigne le groupe dans un flou artistique, ça devrait passer. Un professeur passe une tête dans le studio, encourage mes élèves de sa voix chaleureuse : « C’est bien, les filles. » C’est bien.
Ce même professeur, dont j’ai été l’élève, me propose de venir observer une élève avancée travailler sa variation pour un concours. Il a la gentillesse de m’inclure, me demande à plusieurs reprises si je vois d’autres choses, si j’ai des conseils à donner, et je trouve d’une délicatesse rare cette manière qu’il a de poursuivre son travail de formateur avec moi tout en me légitimant comme professeure. Avec lui, je peux être une ancienne élève et une collègue, ce n’est pas antinomique. Moins expérimentée, mais pas inférieure.

Dimanche 9 février
[rêve] Je dois rendre l’appart étudiant dans je bénéficiais dans une structure collective, un espace tout en longueur et moulures blanches, au-dessus d’un bar-squat-maison de quartier en perpétuelle fête bruyante, nocturne, graffitié de partout. Ramasser ses affaires n’est pas une mince affaire, la chambre n’est pas juste meublée, elle est aussi affairée, déjà habitée, il faut faire la part de tout ce qui était là avant et y restera, ne rien oublier, sonder les piles, les pots, les interstices, je retrouve des livres que j’ai oublié de ramener à la bibliothèque de l’université, et quantité de déchets, il y en a partout, je ne pensais pas, miettes, emballages, bouteilles vides, je ramasse, jette, regrette un peu de devoir quitter cet espace que je n’ai pas vraiment investi, j’y ai dormi, m’y suis douchée parfois, mais n’y ai jamais cuisiné, je restais parfois dormir mais rentrais chez moi le plus souvent, pourquoi ai-je un chez moi ailleurs alors que j’avais cet appartement blanc ? cela fait sens que je doive le rendre pour que quelqu’un d’autre en profite, quelqu’un qui n’a pas d’autre chez soi
Faire et ne rien faire avec, malgré, au-delà de la fatigue (et d’une vague crève en toile de fond). À 22h, je suis en train de régler un grand pas de tours et une diagonale à tout berzingue. Ou comment reconduire la fatigue après l’avoir dépassée.

Lundi 10 février
[rêve] les enfants dansent flou, je leur demande de prendre un livre pour ancrer leur regard, ils prennent des romans en poche, des manuels, un dictionnaire, dansent avec, voilà du concret, ça commence à être mieux, je parcours la salle, en sors, je suis dans ce qui ne ressemble pas à Roubaix mais qui est évidemment Roubaix, qu’est-ce que je fais là, j’ai laissé les enfants seuls, il faut que je revienne, mais mes pas sont toujours plus lents que mon retard, avancer est difficile sans que rien d’extérieur n’explique la force qu’il faut déployer, je suis revenue, allongée à l’intérieur, un homme avance ses doigts sur moi, je ne veux pas mais me débattre est aussi difficile qu’auparavant avancer, mon corps me résiste trop pour que je puisse efficacement résister, je finis par sortir de la salle, explique aux collègues qu’il a essayé de me violer et que, non, non, ne riez pas, ce n’est pas pour rire, il a vraiment essayé mais comment expliquer le corps qui résiste de l’intérieur, qu’il faut un effort considérable pour mouvoir
[rêve] avec ma grand-mère paternelle nous regardons un film sur grand écran, une scène se passe à Rome, je reconnais, on y va, dans l’image, on y est, à Rome, je reconnais, j’entraîne ma grand-mère à pieds puis en voiture, on se gare là pour rejoindre la mer derrière les immeubles, la plage est de la glace, je m’en rends compte quand elle cède sous mon poids et que mes pieds s’enfoncent mouillés, tout est gelé, il fait nuit, je m’avance près d’une paroi de glace, vague gelée, mon pied est touché c’est une petite stalactite qui s’est détachée et a enfoncé le dessus de ma chaussure, petit trou rond pas troué, heureusement que j’ai de gros godillots bleu marine sinon ça m’aurait transpercé le pied, j’inspecte la vague gelée, les stalactites en bordure, la lumière dans les masses translucides derrière
(joli mix entre le canal du parc Barbieux et les émotions qui font bloc, se suspendent en bloc, glacé le temps de prendre du recul, de tout bien inspecter, passage en revue psy avant la fonte)
Premier jour de stage, j’ai toujours un peu le trac à rencontrer de nouveaux élèves. J’adore le cours des adultes intermédiaires : ils en savent assez pour se débrouiller, sont avides de progresser, se marrent, posent mille questions pertinentes. J’ai l’impression de pouvoir leur apporter des choses, de nous ménager à tous un bon moment.
C’est un peu différent avec les adultes avancés : je ne sais pas si c’est leur nombre moindre, l’heure avancée de la soirée ou un passé probable en conservatoire, mais l’ambiance est plus austère, les élèves plus studieuses qu’enthousiastes, chacune sur son bout de barre, son quant-à-soi. Cette réserve a le don de raviver en miroir ma peur d’être jugée (et si les élèves trouvaient le cours nul ? regrettaient d’avoir payé pour ça ?). Alors que le trac passe en débordements toonesques avec les intermédiaires, il se transforme avec les avancés en fébrilité. D’autant qu’une Russe avec un niveau pro (je ne sais pas si elle l’a été ou non) ravive mon syndrome de l’imposteur ; je n’ai aucune correction, aucune indication à lui suggérer, elle danse mille fois mieux que je ne le ferai jamais. Et connaît déjà par cœur la variation de Nikiya du premier acte que j’apprends aux autres dans la version Noureev, y superposant la version du Bolshoï avec les cambrés toutes côtes sorties, de toute beauté.
Les prénoms rentrent un peu plus vites qu’en début d’année, j’ai l’impression, même celui composé de deux prénoms que je n’aurais jamais pensé à accoler (les cathos vous forment des prénoms-valises avec un flegme lexical proprement britannique). Les profils sont divers et parfois surprenants, comme cette jeune fille au corps couvert de tatouages en collants roses, une inscription en lettres gothiques dans le V du justaucorps — un oxymore visuel fort réjouissant. Il y a aussi cette femme qui se sent bloquée quand il s’agit de faire lyrique, dépitée de ne pas trouver sa drama queen intérieure dans le mouvement. Elle m’en reparle à la fin du cours, elle n’aime pas que les choses lui résistent manifestement, cela fait un an et demie qu’elle a commencé la danse et… Un an et demie ?! J’aurais parié sur le double : une danse très académique est tout le mal qu’on peut souhaiter à cet stade d’apprentissage !
À 22h passées, on débriefe de notre première soirée de stage avec le prof de contemporain. Il est plus expérimenté, mais a manifestement la même propension à douter que moi. Est-ce un trait commun aux professeurs qui n’ont pas été danseurs auparavant ? un syndrome d’imposteur qui traîne ses guêtres ? De le constater chez autrui bizarrement me redonne un peu d’assurance.

Mardi 11 février
Le voisin passe la tête dans l’entrebâillement de sa porte, se demande si tout va bien : il a entendu des bruits de clés. C’est la première fois que je me fais attraper en pleine session de TOC ; je me confonds en excuses sans rien expliquer et file chez le kiné.
J’arrive un peu en retard chez ledit kiné et très en avance pour le stage. Le chat a littéralement mis le feu aux cours du prof de contemporain en renversant une bougie sur ses notes de préparation.
Une femme du cours intermédiaire a quelques courbatures de la veille, m’explique qu’elle n’a pas dansé depuis un an. Je la charrie gentiment en installant les barres mobiles : reprendre après un an de pause avec un stage de cinq jours, c’est bien une mentalité de danseuse classique, ça, tout dans la demi-mesure. Elle me rétorque que c’est L. (une élève adulte avancé du mardi) qui lui a dit qu’elle pouvait y aller, la prof est géniale. Comment voulez-vous que je n’ai pas des ailes après ça ?
On démêle quelles jambes sont pliées ou tendues dans les tours en-dehors et en-dedans. Une femme aux cheveux blancs splendide d’élégance découvre que le retiré est identique pour un développé devant ou seconde (elle pensait qu’il fallait avancer le genou). Je parviens à faire souffler et même sourire la toute jeune fille tellement déterminée que sa danse en devient brutale pour son corps — un instant, ça s’allège.
L’heure et demie passe vite, un peu de barre, un peu de milieu, un peu de variation et d’impro, deux minutes à la suite du danseur en brun dans Dances at a Gathering pour s’imprégner de la dynamique poétique tout en décélérations… C’est beau à voir, et révélateur des individualités — y compris pour cette femme qui n’ose pas, reste bloquée à la barre malgré mes encouragements et invitations à tourner le dos au miroir ou reprendre des morceaux de variation pour ne pas avoir à inventer. Peut-être est-ce parce qu’elle n’en sait pas assez, ne connait pas assez de pas pour se lancer, suggère-t-elle ensuite. Mais ce n’est pas ça, je le sais, et ce qu’elle ajoute me le confirme : elle ne se sent pas légitime, n’a pas l’impression d’avoir sa place dans le cours. J’essaye de la rassurer, de lui dire qu’elle a toute sa place et qu’il n’y a pas plus d’attente dans une improvisation comme celle-ci que lorsqu’on danse dans son salon.
L’atmosphère du cours avancé se réchauffe un peu. Les pointes me donnent davantage d’assurance parce que j’adore ce travail… et parce que les élèves sont moins à l’aise que je l’aurais imaginé. Reste à trouver comment, mais j’ai des choses à leur apporter.
On passe moins de temps sur la variation pour faire quelques exercices de tours et de sauts au milieu. Mon tongue twister pour les pieds fonctionne bien ; on s’emmêle joyeusement entre jetés-temps levés en descendant et assemblés en remontant (et vice-versa). Je prends note de ce qu’il faut travailler les sauts en remontant, ce n’est pas du tout une habitude dans cette école (j’ai moi-même mis très longtemps à m’y mettre et cela me demande encore un temps de réflexion non négligeable, alors que c’est quasi-instantané chez JoPrincesse par exemple).
À 22h, je déborde d’énergie ; à 22h10, je suis un aspirateur qu’on vient de débrancher. La fatigue me tombe dessus d’un coup, ce qui n’empêche pas de débriefer-papoter plus d’une demie-heure avec le prof de contemporain, dont j’apprends qu’il a été formé au même endroit que moi (il faisait partie de la toute première promo). On confronte nos souvenirs et nos perplexités, on en rit, cette sociabilité me fait du bien. Je me sens à la fois chanceuse et profondément à ma place.

Mercredi 12 février
La dame élégante arrive très en avance, me dit qu’elle me trouve pétillante. Son regard surtout l’est. Je comprendrai les jours suivants que la bulle spatio-temporelle du stage lui est un safe space, qu’elle l’étire pour la savourer à plein.
Troisième jour de stage, et déjà la routine semble installée. C’est bien, oui, oui, l’enthousiasme en demi-teinte. Serait-ce lié à cette visio avec le boyfriend, à nos désirs de lieux de vie qui ne coïncident pas, ravivés par la reprise du feuilleton achat de maison ? Je le vois dépité, agacé que personne d’autre que lui ne s’enthousiasme pour cette maison (ni l’ami qui visitait avec lui, ni moi qui ai envie qu’il se sente bien, mais n’ai pas envie d’y vivre).

Les poissons jaillissent de la glace
Jeudi 13 février
[rêve] des enfants me réveillent en jouant à la balle, je les reconduis hors de la salle en les poussant par les épaules, tous sont partis, mais ils reviennent avec un professeur cette fois, m’empêchent de dormir
Cours de stretching postural : à quatre pattes, mains tournées vers l’intérieur, on remonte la nuque au niveau du reste de la colonne vertébrale et c’est tout, c’est l’exercice, et aux muscles qui protestent, on prend conscience de notre posture de tortue la plupart du temps, suspendue au-dessus de nos livres, nos claviers, nos téléphones. Et toujours le travail de l’arabesque ; Kathryn Morgan a raison, ce sont les épaules qui restent droites tandis que la hanche s’ouvre, il faut trouver à s’organiser entre les deux.
Avant d’embrayer sur une nouvelle soirée de stage, je sonde la fatigue parmi les premiers arrivés. Une élève adulte est plus fatiguée de son boulot, quatre rendez-vous aujourd’hui pourtant ça allait — elle est psychologue du travail — mais les gens racontaient des trucs vraiment pas très intéressants, elle a un peu décroché par moments. J’ouvre tellement grands les yeux qu’elle cherche à se justifier, à expliquer, mais ce n’est pas le décrochage qui me sidère, c’est humain de décrocher : ce qui me sidère, c’est que le « vomi » comme elle l’appelle fasse partie du processus ; c’est de laisser volontairement le flot de paroles se déverser sans chercher à le rediriger dans une direction qui permette d’avancer. Je le savais confusément pourtant : il faut que ça sorte, et ensuite. Je suis sidérée pourtant, me demande combien de fois, combien de temps j’ai perdu à parler-vomir.
Le stage se poursuit : Y. a troqué son jogging contre un short pour que je puisse voir ses genoux et le corriger ; les deux J. ont répété mon exercice tongue twister de petit saut sur leur pause déjeuner (des jetés-temps levés en descendant avec assemblé en remontant et vice-versa, c’est un peu comme s’entraîner à dire piano et panier très vite en alternance) ; à un moment, la Russe si sérieuse sourit.

Vendredi 14 février
Recopier des extraits, rendre les livres, en reprendre d’autres.
En ce dernier jour de stage, il y a la fatigue accumulée, mais aussi une aisance de fin de semaine qui m’autorise à lancer les corrections en temps réel. Les prénoms me viennent plus facilement, je commence à comprendre l’organisation corporelle des uns et des autres, les points à surveiller : les omoplates trop resserrées d’I., M. qui penche sur le côté, les genoux verrouillés de Y… Le vendredi soir et la défaillance des corps aidant (ou n’aidant pas), ils sont moins nombreux aussi ; je profite des barres désencombrées pour corriger un peu plus ceux sur qui je me suis le moins attardée.
À la fin du dernier cours intermédiaire, je reçois éberluée des cadeaux qui se mangent, qui se tartinent sur les mains, d’autres aussi qui n’ont pas de sachet ni de valeur marchande : témoignages d’enthousiasme, de reconnaissance. Quand je raconte ça au boyfriend, il s’exclame que, tout de même, ces Lillois… Je n’ai pas ce réflexe, du tout, je suis radine des petites attentions marchandes, il faudra y remédier quand je vois le grand plaisir qu’elles procurent.
Dernier cours avec les supérieurs, dernier essai pour réussir toutes ensembles l’exercice tongue twister des petits sauts. Ça devrait marcher, je les encourage, surtout que les deux qui ont le plus de mal ne sont pas là ce soir. « C’est méchant » constate sans méchanceté une élève. Elle a raison, je ne sais pas ce qui m’a pris, d’où est sortie cette précision inopportune — d’autant que j’aurais mis autant voire plus de temps que les deux absentes pour intégrer l’exercice s’il avait été conçu par quelqu’un d’autre que moi. Je ne pensais pas à mal, je ne pensais plus à vrai dire, quinzième heure de la semaine, quatrième semaine avec un unique jour off hebdomadaire.
Dernier cours avec les supérieurs, enfin je vois une autre expression à [prénom-composé] que le masque avec lequel elle danse et se meut et ne parle pas, grand cygne muet jusqu’à ce soir.
Étonnée qu’une élève ne connaisse pas les posés tours que je prenais comme base pour expliquer le posé tour développé d’un nouvel enchaînement, elle me rappelle que ça ne fait qu’un an et demie. Je croyais que ça ne faisait qu’un an et demie qu’elle avait commencé les pointes (je trouvais ça étonnant vu son niveau, mais pourquoi pas), alors que ça ne faisait qu’un an et demie qu’elle avait commencé la danse. Hyper bien placée, les coordinations, la posture, la mémorisation, tout impecc’, même un début de pointes : je suis sciée.
À 22h, on s’improvise un public en se montrant classiques-contemporains ce qu’on a travaillé cette semaine. Certains sont discrètement circonspects, d’autres surpris mais enthousiastes d’accéder à ce qui se tramait sans qu’ils y pensent dans la salle d’à côté. J’explique que nous avons une Nikiya russe et cinq-six Nikiya Opéra-de-Paris, dont certaines un peu russifiées sur la fin ; des bouclettes libres et enjouées concluent que c’est « intéressant d’avoir les deux versions ». Quoique bref, l’échange offre une clôture à la semaine. Grâce à lui et au chit-chat avec le prof de contemporain ensuite, comme les soirs précédents, j’évite l’effet soufflet retombé, et de toutes façons il est l’heure d’aller se coucher.

Samedi 15 février
Je crée un groupe WhatsApp avec les élèves du niveau intermédiaire pour partager une vidéo souvenir. En réponse, des messages adorables que je garde précieusement pour les jours de doute. « Chopin + Hugo Marchand + nous = le bonheur absolu ! » résout la dame élégante. Je me dois de préciser que, non, Hugo Marchand n’était pas avec nous, cantonné à l’écran, mais oui, la dynamique de groupe était incroyable.
Dans la pièce éclaircie par un brin de rangement avant mon départ pour Paris, je m’oins les mains de la crème offerte, ongles coupés, petites peaux repoussées ou ôtées. Le moment de suspension ne dure pas. Face au paysage qui disparaît de la vitre du train, je me fais la réflexion que j’inverserais volontiers mon quotidien seule et le temps long à deux pour retrouver chaque jour la chaleur d’un foyer partagé et m’octroyer des temps créatifs ininterrompus en solo.
Dans le métro, la petite queue rouge d’un béret foncé fait ressembler le vieux monsieur en dessous à une grosse cerise. Une bouche rouge, très précisément rouge au-dessus d’une écharpe jaune, détourne le regard quand je commets l’erreur réflexe d’adoucir l’eye-contact involontaire par un sourire. C’est ce que l’on fait à Lille. J’ai oublié un instant qu’à Paris les regards sont des rayons lasers qui saturent la rame comme un musée sous haute protection ; il convient de se mouvoir avec la dextérité d’un escroc de haute voltige pour les éviter. Si deux lasers se rencontrent, c’est l’alerte : on est dévisagé (ou pire, surpris en train de dévisager) ; mieux vaut alors mettre un vent et dérober son visage plutôt que de rendre le sien à autrui en établissant un contact muet.
Je craignais d’avoir si bien basculé en mode solo qu’il allait être difficile de me rouvrir, mais la lecture de Julia Kerninon fait transition, lire l’envie avide la ravive en sourdine, debout dans le métro je le pressens et ensuite, oui, mon corps se rouvre, désire, accueille. Lendemain de Saint-Valentin, nous fêtons nos quatre ans ensemble.

Dimanche 16 février
Refaire l’amour et baiser, faire les deux et décréter le brunch à la place du petit-déjeuner, croissant pur beurre pour lui, ordinaire pour moi, les extrémités repliées comme les pinces d’un crabe timide (ce n’est pas que je n’aime et n’aime pas les croissants, tantôt l’un, tantôt l’autre ; je suis seulement team croissant ordinaire, voilà des années de brouillard levées).
Le garçon et le héron. Cela ne va nulle part, l’incursion dans le fantastique ne résout ni ne bouleverse rien de la situation initiale, ce n’est pas une métaphore, un cheminement initiatique, tout revient à l’identique, sans métamorphose : est-ce une somme pour fan exégète ou l’aveu du secret qu’il n’y en a pas, jamais, qu’il s’agit juste de vivre et de rêver ? Déçue de l’animé, je suis déçue que le boyfriend me l’ait montré : pourquoi y passer deux heures alors que ça ne va nulle part ? Pour les belles choses, dit-il. Pour en discuter.
Mini panique à l’heure dépassée de se coucher : je n’ai rien fait de la journée — rien accompli, ni même rien fait qui me fasse plaisir. Je n’ai rien fait non plus pour mériter ses mains autour de mon visage, ses caresses apaisantes, tout va bien, tu le sais, son amour qui apaise le reste (je chérie seulement cette chance).

Lundi 17 février
La dentiste est une ancienne pote du boyfriend, qui ne me connait pas. Elle raccompagne à l’accueil un homme dont la boucle d’oreille dorée détonne dans ces beaux quartiers haussmanniens. Il a le look des potes du boyfriend et ça ne loupe pas, elle lui tape la bise pour lui dire au revoir.
« Je sens que vous n’allez pas être une bonne cliente, » plaisante la dentiste alors que je lui énumère quelques antécédents qui remontent à l’adolescence. « Vraiment, vous n’allez pas être une bonne cliente, » confirme-t-elle en constatant qu’il n’y a pas grand-chose à faire dans ma bouche, un peu de détartrage et basta. Allez, prochain contrôle annuel dans quatre ans (je m’améliore, la dernière fois j’ai laissé passer dix ans).
La dernière fois que j’ai mis les pieds dans le coin, Pleyel était encore une salle de musique classique, je crois. J’ai en mémoire la boulangerie dans laquelle j’achetais de quoi me caler à l’entracte ; elle existe toujours, toujours vieillotte. Les triangles coco ont en revanche disparus (est-ce que je n’importe pas le souvenir de ceux d’avant Bastille, rue de la Roquette ?) ; je me fais le nouvel aiguisé de mes dents sur une brioche tressée à la cannelle. Des bannières indiquant la salle Pleyel flottent plus loin pas si loin, mais le territoire si proche me semble désormais trop lointain, une terra non grata qui appartient au passé, dans laquelle il serait contre-nature contre-temps de pénétrer. Je rejoins la place de l’Étoile par l’avenue de Wagram, à un rayon d’écart de l’avenue Hoche tant empruntée. Ce Paris haussmannien me semble maintenant si minéral, si indifférent.