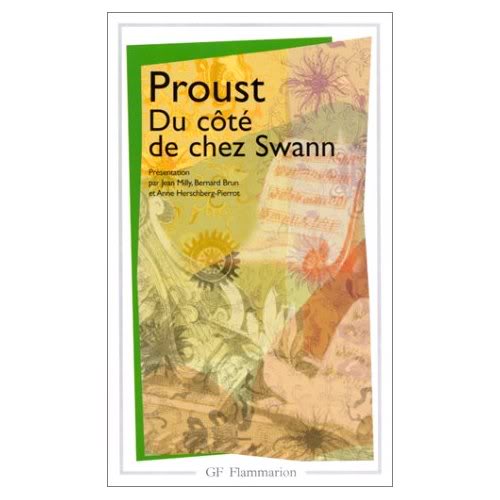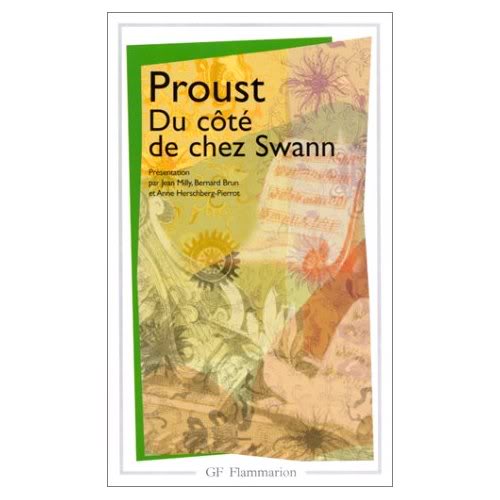
Il ne faut pas vouloir s’attaquer à Proust comme à un pavé échoué sur la plage dans sa migration vers l’île prépa. Lire à grande vitesse, c’est s’exposer à décrocher avant même d’avoir adhérer. Il faut au contraire s’y immerger et de même que nos mouvements sous l’eau semblent freinés et adoucis comme en apesanteur, la lenteur du rythme de lecture amène la rapidité dans la progression.
Qu’en ai-je pensé ? Je partais avec un gros a priori qui n’était pas pour servir l’auteur, à savoir que ce pavé n’était qu’un amas de longues phrases aussi ennuyeuses qu’Emma Bovary pouvait l’être. A la recherche du temps perdu ? Ne cherchez pas je l’ai trouvé, c’est de passer tant de jours sur ce roman. Ce genre d’idées qui sont aussi pensées que les rappels de mise un jour scandés par l’ordinateur.
Ai-je aimé alors ? Je n’en sais trop rien. L’histoire n’est pas passionnante en soi. Le narrateur me paraît même un peu geignard au début. Le style, s’il déborde de subordonnées n’est pas mélodieux en lui-même. Non, l’intérêt que j’y ai trouvé (sans prendre à ce que ce soit le seul valable) réside ailleurs. Dans la perception du réel. [Pas d’overdose de Merleau-Ponty, pas d’inquiétude – un certain intérêt –ok, beaucoup plus que pour Kant]. Proust a une façon tout à lui d’aborder le monde. Il ne cherche jamais à en être un observateur spectateur. L’extérieur se déduit de son intériorité, de la résonance qu’il a eue sur lui. Ainsi les descriptions ne sont jamais ennuyeuses puisqu’il n’y a pas de description comme on l’entend d’habitude. Vous ne feriez pas renter un morceau de Balzac sans que cela détonne, par exemple. Si j’osais mélanger allégrement les époques, je dirais qu’on s’approche des tropismes, ces petits riens qui sont à l’origine de changements quasi imperceptibles en nous (Ca c’est ma définition imprécise, pour quelque chose de plus consistant, rendez vous directement auprès de la principale concernée, c’est-à-dire Nathalie Sarraute, l’inventrice de ce néologisme.) L’ensemble est décousu, pas de fil directeur mais une succession de sensations qui s’imbriquent et finissent à coup de digressions et remarques en apparence anodines à esquisser une ambiance, modeler un caractère, recrée une sensation identique chez le lecteur.
J’en arrive à ce qui m’a littéralement (et littérairement) fasciné : les comparaisons. Du côté de chez Swann ressemble pour moi à une gigantesque boîte à images, des métaphores en tous sens qui colorent la vision usée que l’on a du quotidien [Je sais, ça sens Bergson d’ici]. Une saynète ou même un moment deviennent un instant magique suspendu dans le temps. Le genre de chose dont on se dit : « C’est tellement juste. C’est exactement ça. Même si je n’y avais jamais pensé. ». Et la madeleine ne me semble pas le morceau le plus savoureux, loin de là. Proust, je l’ai goûté par morceaux, comme on se régale de miettes en oubliant totalement l’aspect de la part que l’on vient d’engloutir. Et là, j’ai envie de reprendre le volume et d’y colorier les passages qui m’ont interpellés pour pouvoir les retrouver à loisir et m’offrir une parenthèse, comme un bonbon que l’on savoure avant de repartir de chez la tante ou la grand-mère. Oui, c’est décidé, je deviens collectionneuse d’images poétiques et impressions fugaces. Première vitrine, au hasard des pages sur lesquelles je suis retombée :
Tailladé dans la phrase… parce que je me sens comme chez mon arrière-grand-mère quand je hume cela :
« et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et «lever» la fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense «chausson» où, à peine goûtés les aromes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée de couvre-lit à fleurs. » [Combray II ]
« Devant la fenêtre, le balcon était gris. Tout d’un coup, sur sa pierre maussade je ne voyais pas une couleur moins terne, mais je sentais comme un effort vers une couleur moins terne, la pulsation d’un rayon hésitant qui voudrait libérer sa lumière. Un instant après, le balcon était pâle et réfléchissant comme une eau matinale, et mille reflets de la ferronnerie de son treillage étaient venus s’y poser. Un souffle de vent les dispersait, la pierre s’était de nouveau assombrie, mais, comme apprivoisés, ils revenaient; elle recommençait imperceptiblement à blanchir et par un de ces crescendos continus comme ceux qui, en musique, à la fin d’une Ouverture, mènent une seule note jusqu’au fortissimo suprême en la faisant passer rapidement par tous les degrés intermédiaires, je la voyais atteindre à cet or inaltérable et fixe des beaux jours, sur lequel l’ombre découpée de l’appui ouvragé de la balustrade se détachait en noir comme une végétation capricieuse, avec une ténuité dans la délinéation des moindres détails qui semblait trahir une conscience appliquée, une satisfaction d’artiste, et avec un tel relief, un tel velours dans le repos de ses masses sombres et heureuses qu’en vérité ces reflets larges et feuillus qui reposaient sur ce lac de soleil semblaient savoir qu’ils étaient des gages de calme et de bonheur. » [ Troisième partie du roman : Noms de pays : le nom ]
Aller, un dernier pour la route :
« Et il y eut un jour aussi où elle me dit: «Vous savez, vous pouvez m’appeler Gilberte, en tous cas moi, je vous appellerai par votre nom de baptême. C’est trop gênant.» Pourtant elle continua encore un moment à se contenter de me dire «vous» et comme je le lui faisais remarquer, elle sourit, et composant, construisant une phrase comme celles qui dans les grammaires étrangères n’ont d’autre but que de nous faire employer un mot nouveau, elle la termina par mon petit nom. » [idem]
Pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait morts, la lecture entière se trouve ici.