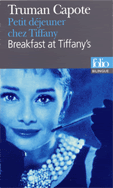… in the waters of the night
What immemorial hand or eye
Could fan thy seamless dichotomy ?

Les costumes sont sombres, les corps eux-mêmes sombrent, mais Tyler Tyler n’est pas un naufrage, n’en déplaise à ceux qui se sont enfouis comme des rats (je déplore néanmoins que soit restée le tuberculeux de service). Pourtant, petite souris, j’ai eu peur moi aussi, lorsque j’ai vu s’étirer la scène où un homme entame lentement une danse traditionnelle japonaise, accompagné sur un mini-piano de poche par une jeune femme occidentale. Puis la scène s’est inversée, avec un danseur contemporain debout et le danseur de kabuki su-odori à l’accompagnement, et le contre-emploi humoristique de l’un et de l’autre (chanson américaine avec un accent à couper au couteau ; danse traditionnelle exécutée en jean, boucle de cow-boy à la ceinture) a détendu l’atmosphère. Danse contemporaine américaine, danse traditionnelle japonaise, le dialogue des cultures était annoncé et leur questionnement mutuel peut commencer.

Yasuko Yokoshi a l’intelligence de ne pas décliner toutes les déclinaisons possibles, en donnant lieu à des associations prévisibles et un peu mécanique. Elle fait danser les contemporains ensemble, puis les traditionalistes à part, bientôt rejoints par les premiers qui se fondent dans l’héritage du passé. Là où ça se gâte, c’est lorsqu’un guitariste arrive et que tout se mélange dans une espèce de porridge country. Dans la surprise d’un même geste répété, en lieu et place de l’éventail, un micro est produit et la danseuse contemporaine de dire des bribes d’une narration lointaine, un enfant enlevé par un mari qui veut le tuer. Le mélange danse-théâtre fonctionne un peu mieux lorsqu’est repris ce qui, à en suivre le programme, doit être une épopée japonaise du XIIe siècle : l’embarcation fait naufrage et l’Empereur est sommé de faire ses adieux à ses ancêtres, à l’Est, pour mourir convenablement, et de tourner ses espoirs de survie vers l’Ouest. Le danseur contemporain est maintenu en déséquilibre par les traditionalistes, il tire vers l’arrière de la scène et ondule comme à la proue du bateau ; le contemporain comme renouveau. Et pourtant, autre déséquilibre, vers l’avant cette fois-ci, arrêté un instant dans sa chute par le poing d’un ancien, héritage indispensable à l’équilibre – un étai(t) solide.

Le principal reproche qu’on peut adresser à ce spectacle, ce n’est pas une quelconque lenteur ( la chorégraphie de Sankai Juku hypnotisait de lenteur), mais un rythme décousu par l’irruption du théâtre et de la voix parlée parmi le chant et les corps en mouvement. Pour le dire autrement : cela ne danse pas assez. Quand cela danse, en revanche, il se passe quelque chose, c’est tout autre chose. Le kabuki su-odori fascine par ses mouvements d’éventails argentés comme de la tôle ondulée, comme des conques de coquillages, promptes aux envolées ou aux disparitions devant le visage, lorsque les danseurs sont de dos, et que la nuque apparaît comme sur une auréole plissée. J’aime la simplicité et la beauté du geste avec lequel la vieille dame relève la bande de tissu qu’elle traîne et fait signe de s’essuyer les yeux. Il n’y a pas de signification à chercher, rien à attendre, juste une tranquillité qui berce et jamais ne nous endort – musique-bruitage de clapotis avec canards intermittents, comme celle que diffuse le réveil de Palpatine, et que j’apprécie ce soir-là pour la même raison que je la déteste le matin (ça me donne envie de les shooter à la carabine). C’est reposant, c’est tranquille, c’est beau.

Plus beau encore, peut-être parce que plus mouvant (et il n’y a pas loin du mouvant à l’émouvant), la danse contemporaine – la danseuse contemporaine, pour être plus exacte car, si son partenaire, Kayvon Pourazar, se glisse bien à l’intérieur de la chorégraphie, elle, Julie Alexander, semble l’inventer spontanément. C’est tout son corps à qui il prend l’envie de se détourner, d’entrer en déséquilibre, de se maintenir ou de se relâcher. Même lorsqu’elle se jette à plat ventre comme un pingouin, c’est beau. C’est dire. Surtout que le passage de serpillère est habituellement ce que j’abhorre dans un certain type de contemporain. Julie Alexander peut se jeter à terre, ce n’est même pas éprouvant, le geste répété a une beauté désespérée, tranquille, il n’y a « plus d’espoir, le sale espoir ».

Large jupe en jean tout d’abord, qui l’installe dans une Amérique désertique, j’imagine en Arizona, sans savoir pourquoi (je soupçonne l’association d’idée Tyler tyler – Liv Tyler- Arizona Dream, que j’ai détesté tout en admirant la beauté de l’actrice qui rejaillit ici sur la danseuse par le simple force du nom) ; elle la troque ensuite contre une robe qui a encore l’ampleur de la tenue des danseurs de kabuki su-odori mais se marie davantage à la retenue dont sont empreints leurs gestes ; robe que l’on imagine bien sur une gouvernante anglaise du XIXe victorien dans une famille puritaine, et qui est défaite, en même temps que les cheveux, remplacée par une pauvre jupe de tulle rose passé et des manches ballon bleues, imitation dégradée de la gouvernante comme de la princesse de bal. Le danser persiste à relever son corps de noyée, à le faire tenir debout en dépit du passé disparu. A la fin, la danseuse traditionnelle revient sur scène, en tenue de ville très sportswear, rejointe par le contemporain au piano miniature : pas besoin de recommencer, «you will see what you just saw », la danse d’hier n’en sera pas plus actuelle ni plus démodée, toujours autre par rapport à une danse contemporaine qui s’en détourne pour ne pas s’immobiliser dans la fascination.