

Catégorie : Souris des villes, souris des champs
Roma, Roma, Romam, Romae, Romae, Roma
Quatrième voyage à Rome, troisième avec Palpatine.
Il a plu. Par intermittence.

La nuit est tombée tôt.

Moi aussi, comme l’orage, avant l’orage, j’ai éclaté, effaçant quelques heures encore de ce voyage. On ne peut pas prendre congé de soi.

La répétition, la dernière fois encore condition sacrée du sens, est devenue redondance – un pèlerinage d’habitude.
La ville s’est refermée dans ses passages bien connus. S’y perdre est de plus en plus difficile à mesure que l’on commence à la connaître. Cela n’a rien à voir avec le fait de s’orienter. Je suis toujours incapable de savoir dans quelle direction me tourner pour aller vers la fontaine de Trévise ou le Panthéon, mais ce sont les mêmes rues dans lesquelles on retombe ; je reconnais et ne vois plus, moins. Les ruelles inconnues se dérobent, et avec elles la flânerie, grignotée par l’errance. Peut-être n’a-t-on pas respecté le délai de jachère urbaine, ce laps de temps nécessaire aux souvenirs pour déformer doucement la ville, et à celle-ci pour se soustraire à ceux-là.

Dans les plats aussi, le plaisir de la répétition s’estompe, comme une obligation et un prélude au plaisir de la découverte, qui s’éloigne en amont, qu’il éloigne en aval. Obsession latente pour les tonnarelli cacio e pepe, tenue à distance et choyée jusqu’au dernier jour ; je les ai eu, ils m’ont eue.
Dans les visites, dans l’apprentissage, dans les menus, à la danse, partout dans la vie se fait sentir la délicate nécessité d’équilibrer découverte et répétition, à l’égal potentiel de plaisir et de désagrément : la nouveauté qui arrive trop vite empêche de jouir de la maîtrise que seule donne la répétition ; la nouveauté qui tarde rend la répétition lassante, et le désir de changement se heurte au confort de l’habitude. (Moi et mon travail.)
S’efforcer.
Manger des glaces par cinq degrés. (Plaisir de la bravade, au moins autant que du goût.)
Il faut marcher, marcher, deux jours, trois jours, pour voir la ville à nouveau se lever, familière et inconnue, découvrir une rue que l’on a empruntée moult fois, mais jamais dans ce sens, et découvrir une nouvelle façade délirante, à se demander comment on a pu la louper ; découvrir et parcourir, autrement. Il faut des conversations qui dévient et des éclaircies, des reflets qui attirent de-ci de-là. Entre la nuit, la pluie, le froid, la fatigue. Fendille cela : le sourire, la beauté.
Plaisir de découverte et de répétition : plaisir de la variation. Le même, mais en différent. Kangoo.

Dimanche, la ville a disparu dans un orage. Palpatine nous a déniché un restaurant parfait pour y assister comme à un spectacle. On assiste rarement à un orage : c’est un tort bien compréhensible ; il faut de la patience pour le traverser, de l’ennui pour s’émerveiller.

Premier acte : toits sépia, ciel gris, menaçant, choix de pâtes à la carte, attente. Deuxième acte : la salle envahie par un groupe de touristes coréens, la sauce orange aux tomates vertes et les amandes effilées, la pluie, les éclairs – au loin, comme si la ville entière tombait dans le réflecteur d’un studio de photographie ; plus près, qui contournent les coupoles et se guettent comme les jets de baleine dans une excursion en haute mer. Palpatine, sur son téléphone, manque celui qui épouse la forme d’une coupole. Troisième acte : l’assiette vide, le froid, le déluge, la ville effacée sous le ciel blanc, le temps long qu’on déroule du bout des doigts sur Twitter ; il n’y a plus rien à voir. Puis la ville reparaît, enfin, sémillante-scintillante, avant d’être avalée à peine une heure plus tard par la nuit.

Avec le jour reflue l’énergie et l’envie de se promener. Rome n’est pas vraiment Rome sans soleil, sans ses enduits ocres et lumineux. Le lendemain, on ne lutte pas, on rentre à l’hôtel – en hâte, presque. Se retirer de la ville, soudain indifférente, et l’autre beaucoup moins. Basta Roma. On somnole et on se réveille de cette somnolence dans le désir l’un de l’autre. On fait l’anagramme. La nuit nous cueille, on l’accueille : il n’y a plus qu’à sortir paisiblement dîner.

Et s’arrêter, de temps en temps, pour rire à son aise, plié en deux, à un trait d’humour qu’on aura oublié peu après. Il est des compagnonnages comme les pâtes : il y a peu de chances de s’en lasser.
La ville sépia




Pré-pro, post-rien : la nostalgie du mouvement

Cela peut paraître prétentieux, mais la prépa a été un plan B. Le plan A, c’était la danse. De la quatrième, où je suis entrée au conservatoire, jusqu’à la Terminale, où il a fallu bifurquer, j’ai été dans l’optique de passer professionnelle.
Pour qui m’a vu danser récemment, cela prête à sourire ; je n’arrive pas à la cheville d’un trente-sixième cygne remplaçant. À l’époque, c’était moins évident. La différence n’était pas encore aussi flagrante entre les aspirants qui réussiraient et les autres, moi. Je savais que je ne jouerais jamais dans la cour des grands, mais j’avais bon espoir de trouver ma place quelque part sur scène, dans une compagnie de second rang. Ma courbe de progression me semblait exponentielle : à mon arrivée en dernière année de cycle élémentaire, je faisais un demi-tour sur demi-pointes et j’avais une idée très vague de ce que recouvrait l’en-dehors ; à la fin de l’année, je faisais deux tours sur pointes sur la scène la plus en pente de France et je validais mon passage en supérieur. L’année suivante, j’obtenais ma médaille d’argent. L’année d’après, l’or, puis mon prix de perfectionnement dans une variation du répertoire. Lorsque les autres travaillaient un pas, je l’apprenais et ce retard a eu l’avantage de me faire aborder la grande technique sans peur : je ne voyais pas de différence fondamentale entre un pas de valse et des fouettés à l’italienne. Dans un cas comme dans l’autre, je ne savais pas faire : on décomposait le pas pour moi, je copiais, j’essayais, je ratais beaucoup et puis ça venait, je ratais à nouveau puis ça revenait, je l’avais, je pouvais commencer à travailler. C’était grisant.
Mes professeurs au conservatoire étaient aussi d’une génération pré-Guillem : le standards techniques n’étaient pas les mêmes. On pouvait espérer (j’ai absorbé cet espoir) faire carrière sans être une très bonne technicienne du moment qu’on était artiste. Et justement, je passais bien en scène : ce truc qui ne s’explique pas, qui fait qu’on existe sur scène et qu’on attire ou non les regards, je l’avais, je le sentais. On me l’a confirmé ; mon professeur, l’un des mes professeurs, en a été surprise la première fois. J’ai vite découvert pourtant que cela ne valait pas grand-chose lors des auditions pour les écoles supérieures – et je ne parle même pas de moi. Vous entrez dans le studio d’échauffement et il y a cette danseuse magnifique, dont vous ne songez même pas à être jalouse : un seul cambré suffit à vous pâmer, elle sera prise, cela ne fait aucun doute, une telle artiste, si jeune, et solide techniquement avec ça. Pour un peu vous ôteriez votre dossard et vous iriez vous asseoir pour la regarder, transformant l’audition en spectacle. Et la gamine n’est pas prise. On lui préfère un robot inexpressif avec deux centimètres de plus dans la rotation de l’en-dehors ou les levers de jambe. Le cas s’est présenté à plusieurs reprises ; j’en ai été scandalisée, et cette tristesse s’ajoutait à celle de mon plus prévisible refus.
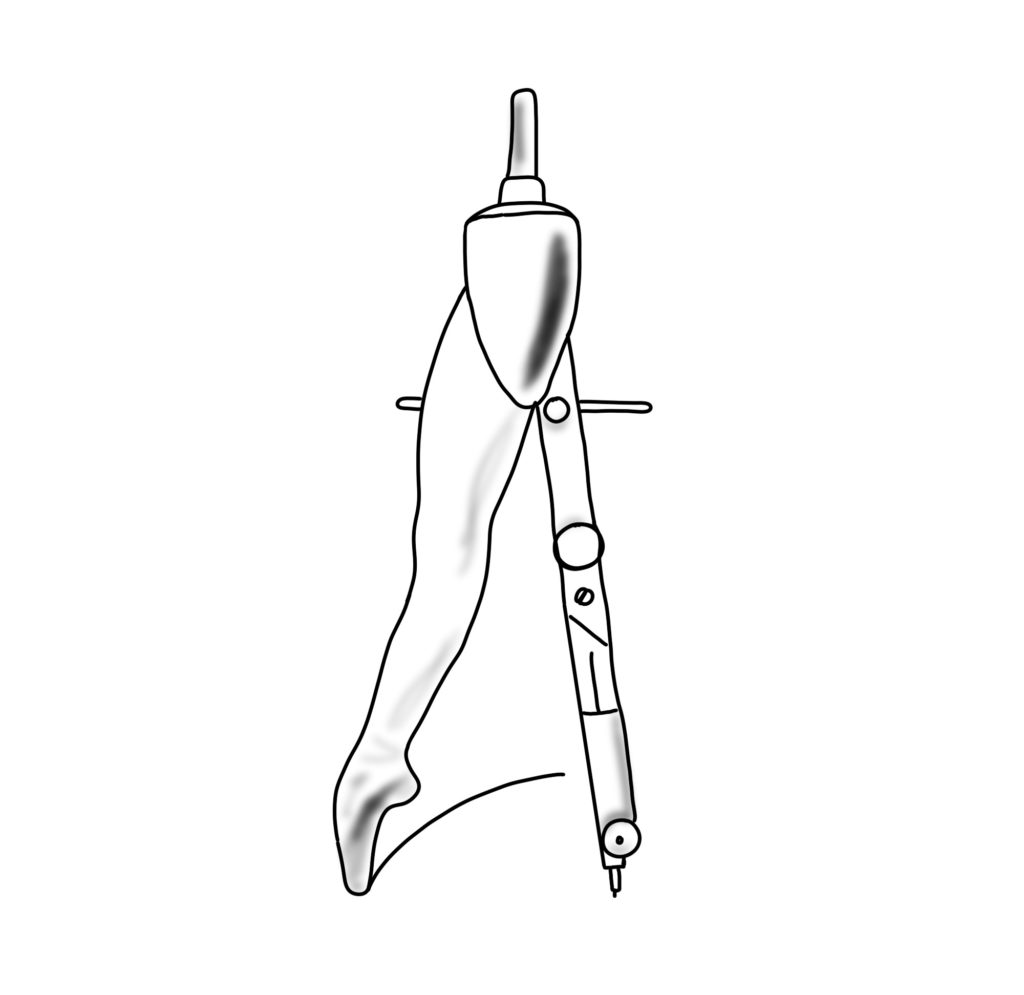
J’ai enchaîné les auditions : CNR de Paris, CNSM de Paris, CNSM de Lyon, école du ballet de Marseille, de Rosella Hightower à Cannes, et rebelotte, plusieurs fois, et Rudra Béjart, et le jeune ballet de Thierry Malandain. L’audition la plus intelligente – et la plus humaine – était celle du CNSM de Lyon. Je l’ai passée deux fois. Elle se déroulait après deux jours de cours et la prof de classique venait parler avec les candidats éliminés. On repartait en pleurant, mais avec des raisons, des corrections et le plaisir d’avoir dansé. Ah, ma grande saucisse ! a-t-elle prononcé, désolée, quand je me suis approchée ; j’aurais grandi trop vite, un corps pas assez maîtrisé. Le sobriquet affectueux dont je me trouvais affublée montrait qu’elle m’avait bien identifiée. J’y trouvais une sorte de consolation, un maigre espoir. C’était dur à entendre, mais honnête, et on entendait là-dedans la bienveillance. Elle avait le courage de dire les choses, comme à cette danseuse hyper douée mais dont la croissance s’était arrêtée très tôt, le courage de dire : tu as déjà le niveau auquel l’école pourrait te mener et tu es trop petite pour n’importe quel corps de ballet classique ; soit tu réussis à te faire engager directement comme soliste, soit tu fais une croix sur ta carrière. La danse, c’est ça quand on n’a pas un corps qui permet de faire des belles phrases sur la volonté, quand on veut, on peut. Parfois on veut et on peut pas. Pas assez. C’est apprendre qu’on a chacun un jeu de possibles limité – assez vaste pour s’inventer plusieurs vies, mais pas forcément celle dont on aurait rêvé.
Je n’ai jamais dépassé le premier cours de sélection, nulle part. Quand on a du potentiel mais qu’on ne cesse d’échouer, la limite entre persévérance et entêtement devient ténue. Ai-je été assez raisonnable pour reconnaître mes limites et m’engager dans une voie qui ne soit pas une impasse manifeste ? Ou ai-je lâché trop tôt* ? Et alors, comment sait-on qu’on a été jusqu’au bout ? À combien d’auditions ratées est-il situé ? À la fin de la Terminale, j’ai envisagé d’aller à la fac ou même pas, et de danser de manière intensive. Et la prépa. D’un côté l’incertitude (et la probabilité de la médiocrité), de l’autre un prestige assez certain. Je me suis dirigée en prépa en me disant que c’était une expérience que je ne pourrais pas retenter après un an de fac, tandis qu’il serait toujours tant après un an ou deux de danser comme une damnée. Mais je ne me le suis même pas vraiment dit, car énoncé aussi clairement, j’aurais su que je faisais une croix sur la danse en tant que carrière : 18 ans, déjà, c’est tard pour n’être nulle part.
Sans compter, de surcroît, sur le vieillissement du corps. À 20 ans, personne ne le remarque en principe ; on a l’impression d’être à peine sorti de la croissance. J’ai pris de plein fouet l’inversion de la courbe. L’effort qui me permettait de progresser est devenu tout juste suffisant pour maintenir mes acquis. La réduction des heures dansées n’a pas aidé ; j’ai rétrogradé de 10 à 2 ou 4 heures d’entraînement par semaine (selon qu’il y avait ou non devoir sur table le samedi matin) et, continuant à pousser mon corps comme si rien n’avait changé, je me suis blessée – une élongation à la limite de la déchirure musculaire, 6 mois d’arrêt après une tentative de continuer à prendre une barre au sol aménagée.
Le choix entre les études et la danse est un choix que j’ai fait sans en avoir pleinement conscience : je repoussais le moment de renoncer et ce non-choix m’a embarquée. Je savais et je ne savais pas. C’est un peu comme de savoir qu’on est lundi, savoir que Gibert est fermé le lundi, mais se frapper le front devant la devanture close après avoir traversé la moitié de la ville (cela m’est arrivé un certain nombre de fois, mais à chaque fois de plus en plus en amont dans le trajet). J’ai fini par comprendre que mon inconscient opère une semblable disjonction entre les propositions lorsque les conclusions sont trop douloureuses ou effrayantes. Quand Mum a été guérie de son cancer, Melendili m’a fait remarquer que mon comportement avait été étrange, comme si elle avait eu un simple rhume. Le cancer est mortel. Ma mère a un cancer. Mais ma mère n’est pas Socrate, elle ne peut pas être mortelle, pas si jeune. Ce que je ne veux pas admettre se déroule dans le brouillard – un mécanisme de protection assez efficace, il faut bien l’avouer, tant qu’il ne va pas jusqu’au déni.
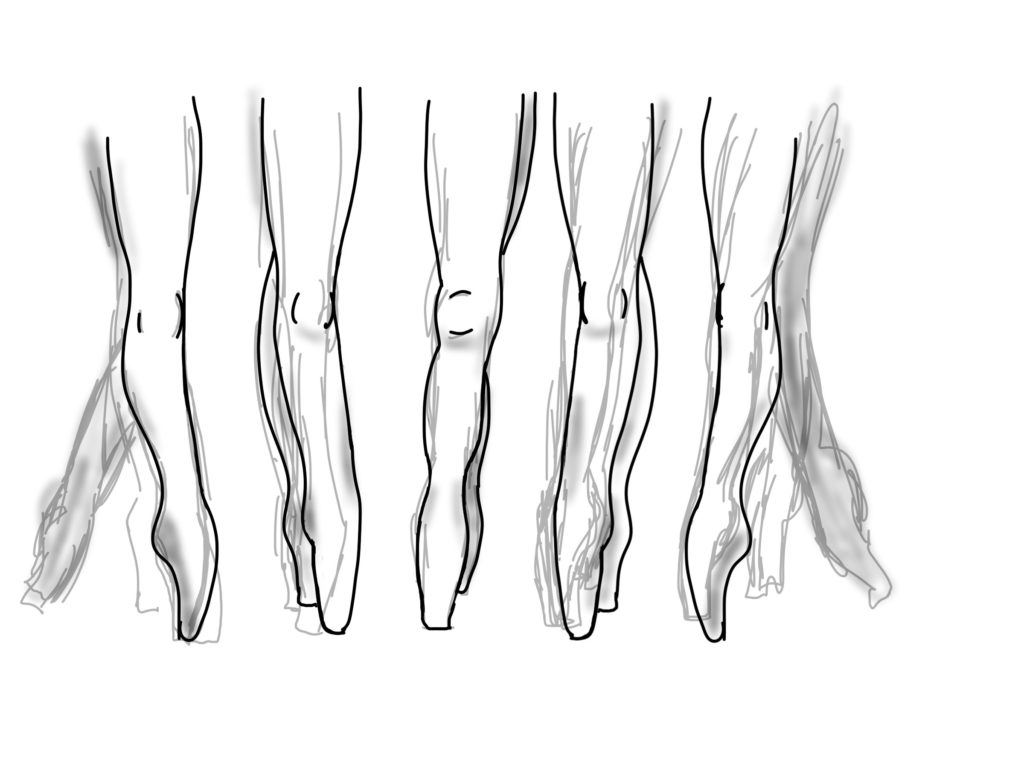
Dans le cas des adieux à la carrière dans la danse, il était d’autant plus facile de s’abuser que je n’abandonnais pas une chose que j’aimais, j’en poursuivais une autre, et pour laquelle j’étais douée : les études. Quoiqu’autruche de compétition, j’ai fini un jour par relever la tête et voilà, c’était fait, je n’étais plus pré-pro, je ne serais pas danseuse professionnelle. Je vous rassure, je n’en ai pas été moins perplexe lorsque ma prof m’a demandé, post-blessure, si je souhaitais en profiter pour reprendre un travail en profondeur ou si j’avais surtout besoin de me défouler en balançant les jambes. Le travail, évidemment ! Je ne comprenais même pas qu’on me pose la question. Et j’ai continué à balancer mes jambes.
Le changement de cours occasionné par mon emménagement à Paris m’a été bénéfique : j’ai quitté les gamines pré-pro que je regardais avec un petit pincement au cœur, et j’ai rejoint une bande d’amateurs de bons niveau, étudiantes, mères de famille, chercheuse en neuroscience, policière, employées de bureau, professeurs de danse, toutes avec des corps différents, des défauts communs et des talents particuliers. Il faudra que je vous parle un jour de S. bien placée, de la Russe qui bondit comme un chat ou de « la sauteuse » qui renverse n’importe quel exercice de petite batterie comme on rembobinerait une cassette… C’est en leur compagnie, à présent, que je me prends un shoot de liberté, 1h30 par semaine, sous la verrière d’Éléphant Paname.
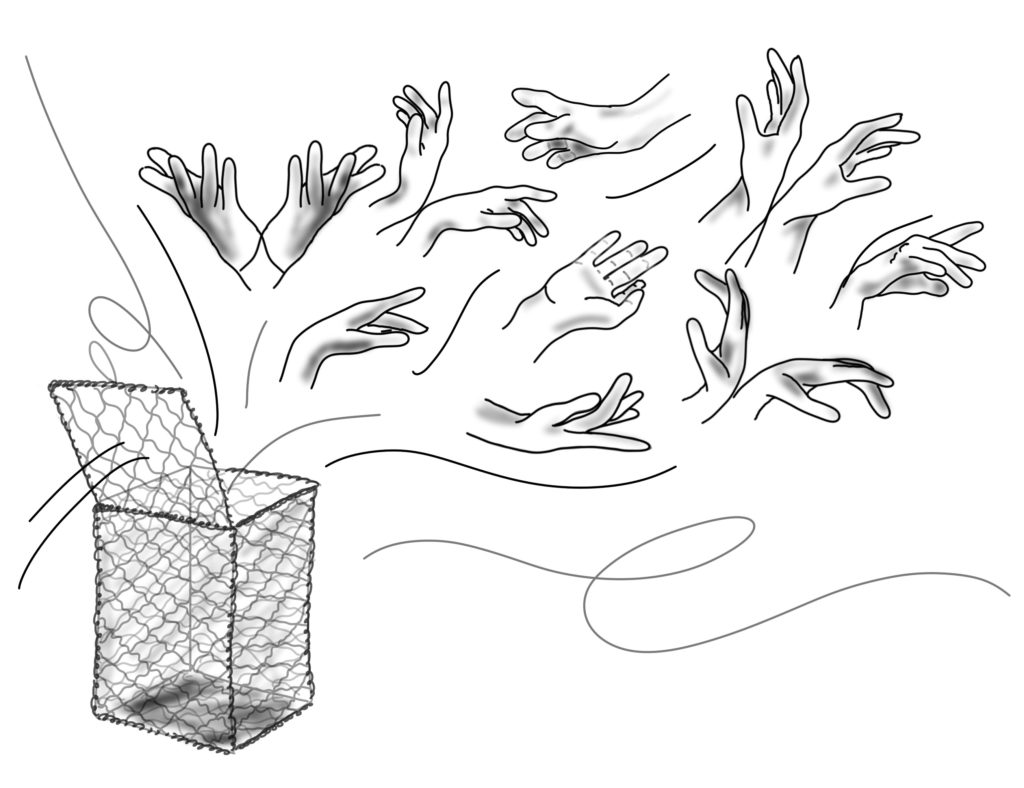
Je n’ai pas de regret, j’ai ce luxe : ma mère m’a permis de tout tenter ; elle m’a accompagné tous les samedis au conservatoire et m’a chaque semaine attendue ; elle m’a emmenée aux auditions, coûteuses en temps et en argent ; elle m’a récupérée à le petite cuillère à chaque fois, et elle a continué de m’encourager alors que le reste de la famille n’était pas très chaud (sans s’y opposer, mon père a fait la grimace car je ne le voyais plus qu’un jour tous les quinze jours, après le cours du samedi après-midi ; et danseuse n’est pas un métier, je cite mes grands-parents). La danse n’est pas un rêve de petite fille de ma mère, je tiens à le préciser : elle raconte d’ailleurs en rigolant qu’elle a arrêté au second cours quand, allongée sur le dos, elle a été incapable de se redresser – une tortue en justaucorps. Son rêve à elle, c’étaient les Beaux-Arts, mais déjà à son époque, mes grands-parents, pourtant férus d’art (une grand-mère pianiste ; un grand-père amateur de peinture moderne) avaient décrété qu’artiste n’était pas un métier. Elle a fait du droit, et a veillé à ce que je n’ai pas de regret. Le seul que je pourrais avoir est de n’avoir pas poursuivi en contemporain, où mes chances auraient été un peu moins minces. Mais je n’avais pas alors la culture chorégraphique que j’ai maintenant et ne pouvais imaginer que les cours pour l’essentiel boring que je tentais parfois pouvaient déboucher sur quelque chose qui me plairait – et encore : il n’est pas non plus exclu que cela soit intrinsèquement un genre que j’aime regarder mais non pratiquer.
Je n’ai pas de regret, donc, mais j’ai de la nostalgie. Contrairement à ce que j’imaginais, je ne me suis pas détournée de la danse quand celle-ci n’a pas voulu de moi (cela aurait été geste enfantin, la preuve d’une amour bien superficielle). Je ne vis pas non plus dans le passé, la danse comme madeleine : chaque semaine, je sue hic et nunc, et c’est mon corps de vingt-neuf ans que je travaille à présent. La nostalgie ne vient pas du passé, mais du présent. Ces derniers temps, ces dernières années, elle s’est taillée une place, discrète, assurée, lançant ses assauts dans les moments de découragement et de lucidité, lorsque je reconnais que je ne suis pas épanouie professionnellement et qu’à cela, je me suis plus ou moins résignée. Sans avoir le courage de changer (pour quoi ?), je ne me résous pas tout à fait à cette résignation et les accès de nostalgie se multiplient, plus ou moins aigus, plus ou moins violents.
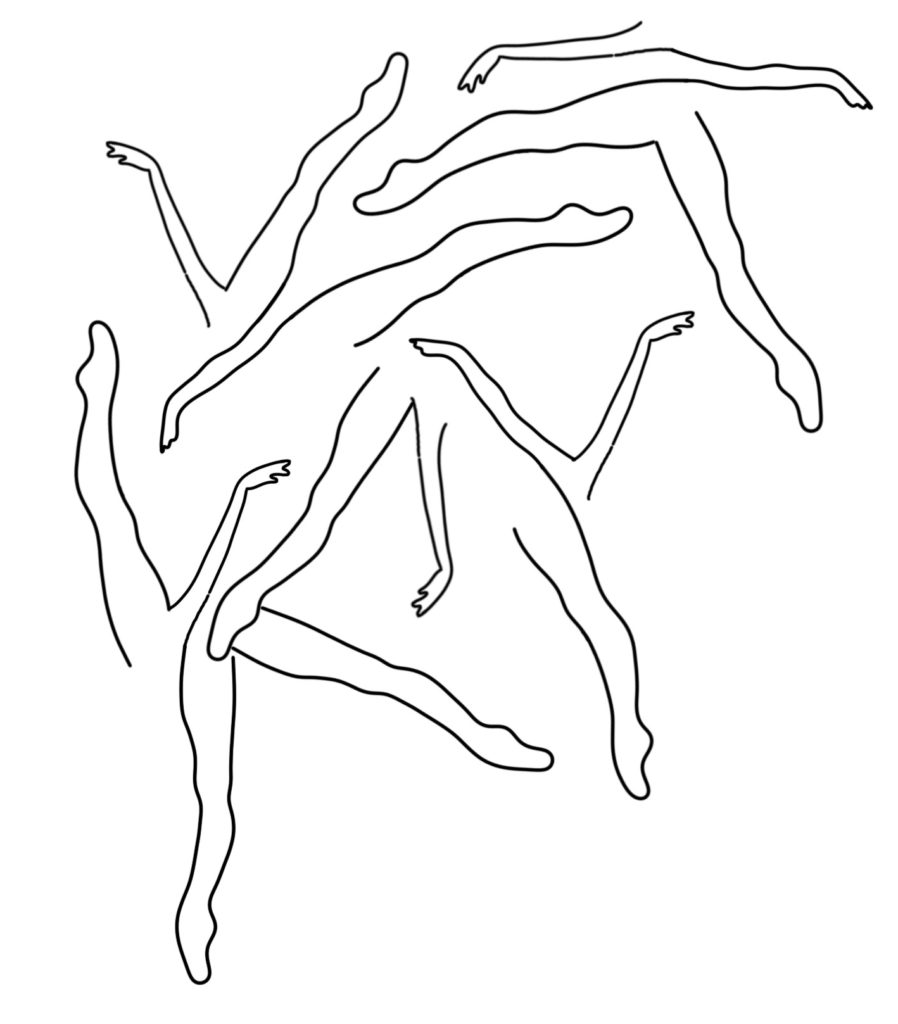
Il y a la nostalgie de la scène, qui fait vivre plus intensément, donne la sensation d’exister pleinement, dans le vide, dans l’absolu créé par les lumières et le trou noir où disparaît le public. Mais, peut-être encore davantage, il y a la nostalgie de ce dans quoi on s’investit, la nostalgie d’avoir une place, une discipline quotidienne : un sens qui ne soit ni seulement but ni seulement prétexte, dans lequel aller et dans lequel exister en chemin. La discipline, c’est le contraire de l’effort entendu comme le sursaut laborieux qu’on s’inflige : c’est l’effort qui n’en est pas un parce qu’on le goûte, parce qu’il ne nécessite plus le courage de commencer. Le goût de l’effort tient dans la poursuite. On aime et on s’y tient, et on s’en aperçoit à peine. Je voudrais à nouveau aimer faire et m’y tenir, mais force est de constater que j’ai perdu le goût de l’effort. De la discipline, je n’ai conservé que son aspect rituel rassurant, dégradé jusqu’aux prémices des TOC.
Je me rends compte rétrospectivement de la chance que j’ai eue, d’avoir une adolescence dansée : la danse m’a structurée ; elle m’a donné un équilibre, m’a tenue loin des vacillements qu’on associe à cet âge-là. C’est maintenant que je vacille, dans une conscience de plus en plus aiguë de cette double difficulté : vivre sans s’oublier dans un but (écueil eschatologique) ; se projeter tout en ayant conscience qu’on le fait pour rien, pour vivre (écueil nihiliste). La danse m’a permis d’avancer entre ces précipices sans regarder mes pieds, sans éprouver de vertige, et c’est de cet équilibre de vie dont j’ai la nostalgie, comme d’autres ont celle de leur enfance. Difficile de savoir sur quel pied danser, difficile de ne pas vouloir rester Peter Pan, et s’envoler. Je ne sais pas, plus, comment tenir les extrêmes, retrouver l’équilibre. Je sais que l’équilibre ne se conserve pas : on ne peut pas vivre dans le passé. Le retrouver, c’est forcément le réinventer. Et je suis jeune encore, mais déjà moins.
Cesser de patiner, vite, vite, et rentrer dans la danse, avant que cela commence à sentir rance, avant que l’amertume** arrive et s’installe. Je la sens poindre, parfois, devant les photos de jeunes prodiges russes sur Instagram, alors que j’ai enfin admis, enfin compris, que ce sont des enfants, ce ne sont que des enfants, je n’étais qu’une enfant, on grandit, et on regarde soudain avec bienveillance, avec émotion, presque, ces corps qui se transforment sous nos yeux, qui clignotent d’enfant à femme et de femme à enfant d’une photo à l’autre. Je ne veux pas être amère, je veux être amatrice, amateur, à la barre et vogue matelot.
Vouloir devenir danseuse professionnelle, après tout, n’était pas un but en soi : c’était une manière de continuer à danser, l’assurance de continuer à vivre intensément. Peut-être n’ai-je pas tant la nostalgie de la danse que de celle que j’étais, et peut-être moins de celle que j’étais que de celle que je n’étais pas et que je devenais, celle qui arrivait à se transformer – nostalgique du mouvement.
J’ai eu envie de raconter-affronter-contempler la tristesse et la beauté de la nostalgie qui m’a prise à la lecture de Leçons de danse, leçons de vie, de Wayne Byars. Malgré un enrobage « développement personnel » et un ton parfois grandiloquent (je sais, je sais, l’hôpital, la charité…), c’est souvent juste et cela a remué pas mal de choses. En écrivant ce post, les souvenirs se sont pressés au portillon, des souvenirs heureux que j’ai pour beaucoup écartés car je voulais explorer autre chose, un hier qui n’existe qu’aujourd’hui, dans la continuité de ce qu’il a échoué à être et de ce qu’il est devenu. Je ferai probablement d’autres chroniquettes plus légères pour le plaisir de rouvrir la malle au trésor (c’est ainsi que m’apparaît mon vécu ces derniers temps, dans une profondeur insoupçonnée : comme un personnage de roman bien travaillé, je commence à prendre de l’épaisseur ).
* Je n’ai pas assez persévéré. C’est parfois ce que je me dis quand je vois des profils comme celui-ci : Hilda (belle découverte bloguesque du jour). Mais la contingence, la vie, les choix. Il n’y en a pas toujours des bons ou des mauvais.
** L’amertume. J’ai appris à la reconnaître dans la durée sur le blog de Thierry Crouzet, auteur numérique qui souffre de ne pas être assez reconnu, tout en ayant conscience de la vanité à vouloir l’être. D’un post à l’autre, il ne s’en dépêtre pas, on le sent qui lutte. Tantôt le plaisir gagne, tantôt la vanité de celui-ci. C’est poignant, et c’est probablement pour cela que je continue à le lire – ou comme miroir-repoussoir, pour me rappeler que je ne veux cesser d’aspirer à la joie.
Lumière en biseau à Chenonceau

Chenonceau : château que le fantasme onomastique place quelque part entre le chevreuil et le rondeau, sur une note discrète de renoncement.




