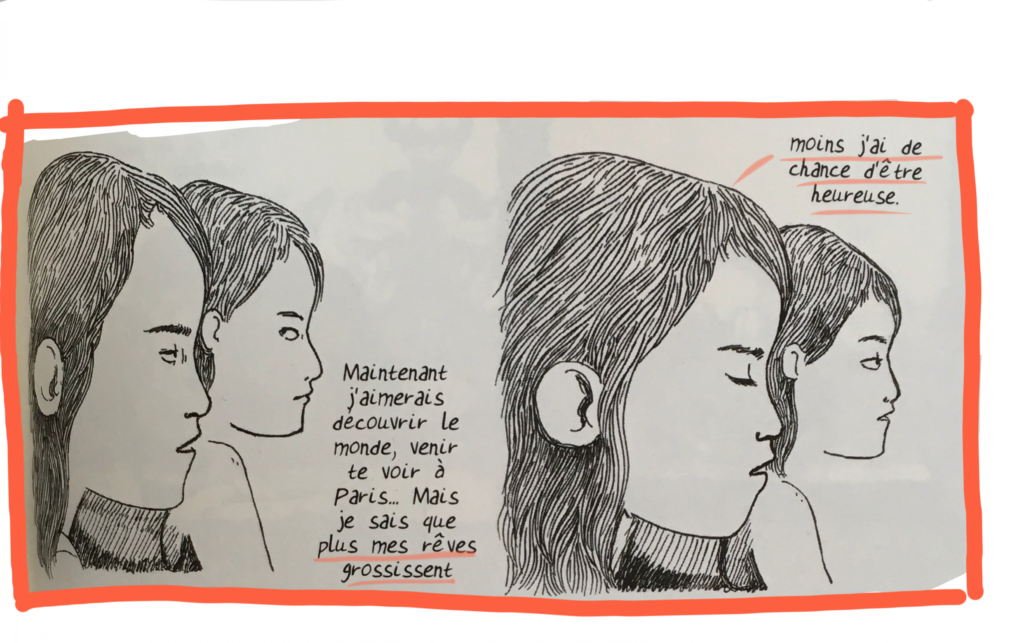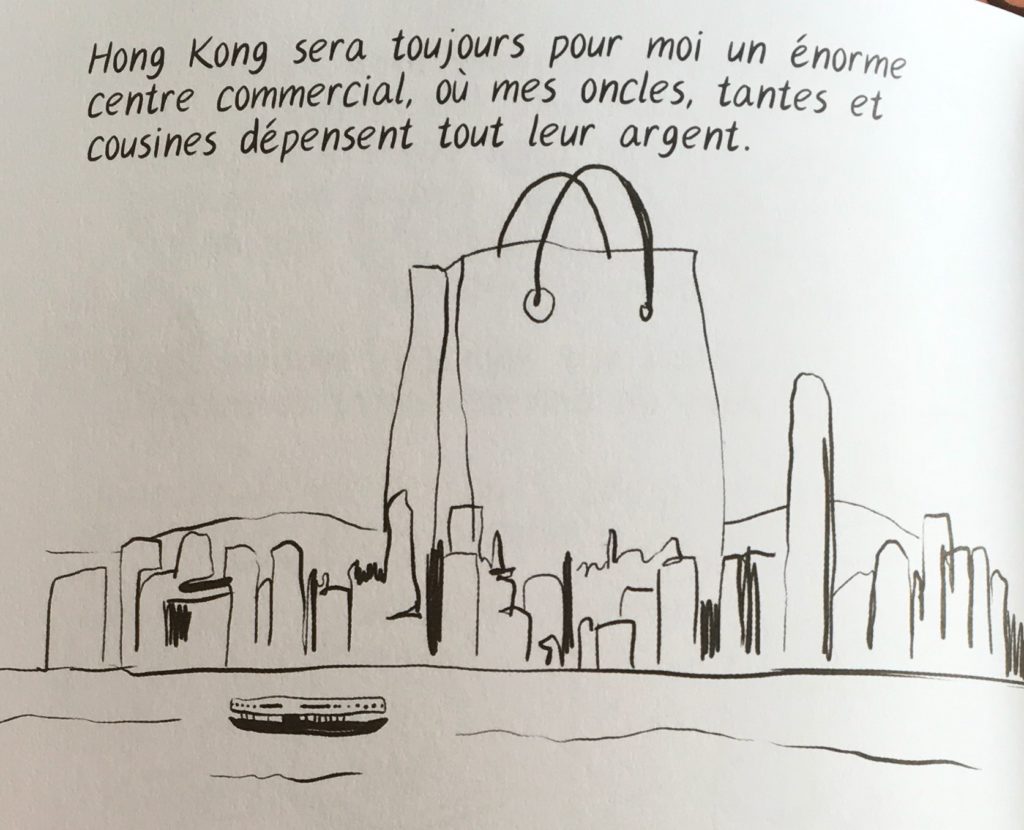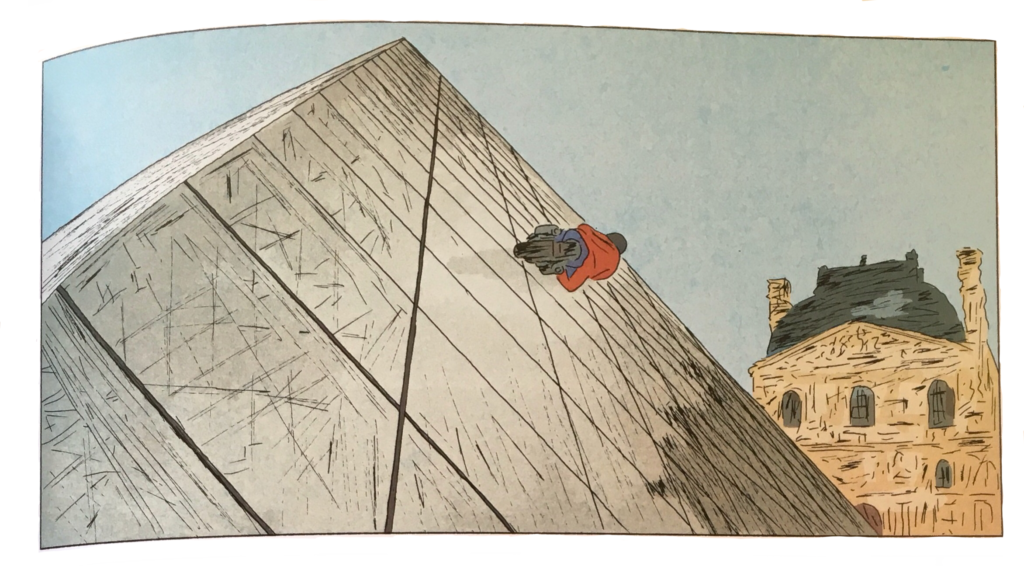Dans son ombre, de Marie-Anne Mohanna
Il vaut mieux éviter de tirer des traits à la règle dans des dessins à main levée ; cette règle lue je ne sais où m’est revenue en mémoire en ouvrant ce court roman graphique, dont on ne sait au juste s’il est touchant ou maladroit. Il tourne court, et l’on ne saura finalement pas grand-chose de comment l’on se construit lorsqu’on est un enfant illégitime, désiré mais caché par un père qui ne vous voit que dans les interstices de son autre vie, avec une autre femme et un autre enfant qui ne soupçonnent pas votre existence.

L’Immeuble d’en face, tome 2, de Vanyda
Suite de ces Scènes de ménage dessinées. J’ai beau être plus âgée d’une dizaine d’années, c’est à l’étudiante en minijupe et collants rayés que je m’identifie le plus, notamment dans ses phases d’indécisions et d’ajustements émotionnels, à vouloir l’attention-affection de l’autre sans nécessairement avoir l’énergie de s’insérer dans sa vie déjà bien remplie.
(La femme plus âgée qui collectionne les points sur les soupes m’a fait me souvenir soudain qu’enfant, avec ma mère, nous consommions, découpions, scotchions pour le bingo des marques. J’avais oublié cette improbable pratique capitaliste-ludique.)

Petit traité d’écologie sauvage, d’Alessandro Pignocchi
Probablement un machin militant déprimant, me suis-je dit en attrapant cet album, que j’ai quand même ajouté à ma cueillette à cause de ses dessins à l’aquarelle et de sa couverture improbable façon Un indien dans la ville. J’ai été saisie de perplexité aux premières historiettes, bien loin de la bonne conscience écologiste à laquelle je m’attendais ; à la limite, la question écologique telle qu’elle se pose aujourd’hui en politique est tournée en ridicule : pourrait-on vraiment se permettre de rêver à un ministre qui décide d’aller à ses réunions internationales en vélo parce que son chauffeur vient d’écraser un hérisson ? L’hypersensibilité envers la nature est bien trop éloignée de notre monde pour ne pas susciter le rire. Et pourtant…
Je sens qu’il y a anguille sous roche sans parvenir immédiatement à comprendre où et comment. C’est comme de se réveiller en pleine nuit dans un endroit dont on n’est pas familier et, projetant par défaut sa chambre habituel, trouver un mur du côté où l’on descend habituellement du lit. L’ironie, la vraie. Je n’avais pas été si désorientée depuis ma découverte (prudente et parcellaire) de Sade et, avant lui, ma toute première exposition à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert au collège. Il faut le temps de comprendre dans quel sens cela fonctionne, et alors tout se retourne comme un gant, en plein délice et désarroi de pensée.
La postface de l’auteur confirme ce que l’on devine peu à peu : son approche déborde la question écologique, ou plutôt qu’elle la considère d’un point de vue anthropologique ; toutes les saynètes consistent à adopter le point de vue d’une tribu Jivaros dans notre monde moderne occidental. Le résultat est très drôle, parce qu’absurde. Mais l’absurdité brouille les frontières et bientôt, dans l’accumulation des historiettes et la perception de leur cohérence interne, on se demande ce qui est le plus absurde, de ce monde plaqué sur le nôtre ou du nôtre soudain entraperçu de l’extérieur. Le décentrement est drôle, mais aussi dérangeant, et interpelle au final bien davantage qu’une tribune militante.
La postface est également passionnante en ce qu’elle montre que notre concept de nature pose en tant que tel problème : il n’y a de nature que pour un homme moderne qui pense la société indépendamment de son environnement. Je retrouve à un niveau plus global la réflexion que je me faisais sur le paysage : on ne peut pas habiter un paysage ; il n’y a de paysage qu’observé, mis à distance, et toujours il se dérobe. Le paysage est un substrat de cette nature, qui ne s’envisage que depuis la culture, tout contre, en antagonisme. L’enjeu écologique, dans cette perspective, implique carrément de changer de paradigme civilisationnel (autant dire qu’on est mal barré).

Goupil ou face, de Lou Lubie
La dessinatrice-narratrice matérialise sa cyclothymie sous les traits d’un renard : dans les phases d’euphorie, la couleur de son pelage contamine tout (orange power !) ; dans les phases dépressives, l’ombre portée par l’angoisse transforme le renard en loup noir. Cette métaphore, génialement filée, donne au roman graphique sa palette bichrome… procédé dont usait également La Différence invisible pour parler de l’autisme. Mais là où cette bande-dessinée-ci insistait sur l’incommensurabilité de l’expérience (tu ne peux pas comprendre), celle-là au contraire fait feu de tout bois pour nous donner la pleine mesure de la maladie (tu vas voir, on va imaginer), n’hésitant pas à utiliser des graphiques pour montrer l’amplitude des variations d’humeur chez une personne « normale » par rapport à une personne atteinte de ce trouble bipolaire qu’est la cyclothymie.
Diagrammes humoristiques, cases éclatées, métaphores à la pelle… Goupil ou face est d’une inventivité graphique folle, que n’égale que son humour – humour forcené par lequel la narratrice-dessinatrice reprend le contrôle sur sa vie et fuit le statut de victime. Le résultat, c’est que tout en nous donnant des clés de compréhension documentées, Goupil ou face n’a rien de la bande-dessinée didactique qui use du dessin pour enrober un savoir barbant ; au contraire, c’est de bout en bout le récit d’une expérience personnelle, à laquelle on nous donne les moyens de nous identifier. On comprend, dans une fusion totale entre connaissance et empathie, et on rit, beaucoup. Mention spéciale pour le petit Psykokwak au coeur brisé lorsque la narratrice claque la porte à une ribambelle de psychiatres, psychologues et psychanalystes en décrétant qu’elle ne veut plus entendre parler d’aucun psy-quelque chose.

Tu pourrais me remercier, de Maria Stoian
Cet album rassemble des témoignages à la première personne de femmes et d’hommes victimes d’agressions sexuelles de tous types. La dessinatrice donne à chacun sa singularité en changeant de trait et de palette, mais l’accumulation dessine un continuum, qui permet de mieux comprendre, peut-être, les réactions aux agressions. C’est une chose de se faire expliquer les mécanismes biologiques qui expliquent souvent la sidération des victimes ; c’en est une autre encore de comprendre comment elle s’articule, par exemple, au sentiment de trahison lorsque l’agresseur est connu. Bref, rien de neuf, rien de gai, mais une bande-dessinée qui aide à se mettre dans la peau de.

La Cosmologie du futur, d’Alessandro Pignocchi
Enthousiasmée par Le Petit traité d’écologie sauvage, je me suis jetée sur La Cosmologie du futur… et ai été fort déçu : cela sent le réchauffé ; hormis pour un ou deux dessins, le rire comme le trait est forcé. J’ai d’abord pensé que le plaisir de la découverte s’était émoussé, mais lorsque j’ai fait lire des extraits du premier volume à Palpatine (et de proche en proche, presque l’intégralité), je riais par-dessus son épaule, jusqu’à provoquer l’amusement de la dame en face de nous dans le métro.
La postface m’a plus intéressée que la bande-dessinée elle-même, notamment dans cette hypothèse que la négation du réchauffement climatique aux États-Unis serait un moyen commode de ne pas prendre en charge les inégalités sociales que la dégradation du climat ne va faire qu’accroître. Mais déjà j’entends Palpatine, qui sur un tout autre sujet faisait une objection pertinente : inutile de penser un complot là où la bêtise est une explication suffisante.

L’Immeuble d’en face, tome 3, de Vanyda
Un jour Melendili m’a dit qu’elle appréciait Mad men pour ses relations qui n’ont pas de nom. Cela m’a marquée ; j’y ai repensé en pointillés depuis. La dernière fois, c’était à la lecture des Solidarités mystérieuses de Pascal Quignard, où des personnages étaient liés en deçà et par delà les liens socialement identifiables tels qu’époux, amants ou amis. Cette fois-ci, c’est avec le dernier tome de L’Immeuble d’en face.
Sans prévenir son copain, Claire part chercher refuge chez un étudiant étranger (et pour ainsi dire inconnu) rencontré lors d’une soirée. À l’angle des cases muettes, elle recroquevillée sur le canapé, lui perçu en contre-plongée, on sent un doute quant à une attirance éventuelle. Il y a quelque chose entre eux. Et pourtant, s’il ne se passe rien (de sexuel), on sait, on sent que ce n’est pas par respect pour la morale monogame. Cela a quelque chose à voir avec la facilité qu’il y a à se confier à un inconnu, face auquel il n’y a pas d’enjeu de séduction ni même d’image, préalable, que l’on souhaiterait modifier ou au contraire ne pas altérer. Il faut qu’il n’y ait aucun rapport amoureux entre eux pour qu’il y ait autre chose, une intimité souterraine, franche et subite. De cette intimité, de ce genre d’écoute, il est facile de tomber amoureux, et c’est peut-être pour cela qu’on a tant de mal à dissocier l’un de l’autre, intimité et relation amoureuse. Pourtant, il y a une beauté particulière à ces intimités sans nom, parenthèses sociales qui pourront ou non être recouvertes du nom d’amitié, demeurant en deçà au-delà – des possibles qu’il faut se garder d’accomplir pour les conserver comme possibles, et alléger une vie qu’il serait autrement étouffant de vivre comme destin, déjà tracé.
Je veux dire que je pense qu’il arrive parfois qu’il se passe quelque chose de spécial entre deux personnes. Je respecte ça.
J’aime décidément beaucoup l’oeuvre de Vanyda, y compris cette trilogie dont je ne comprenais pas, au début, la préface hyper élogieuse qui en était faite. Il a fallu beaucoup de scènes anodines pour que, sans qu’on s’en aperçoive, surgissent ces relations sans nom au détour d’une écharpe reniflée ou de clés oubliées…





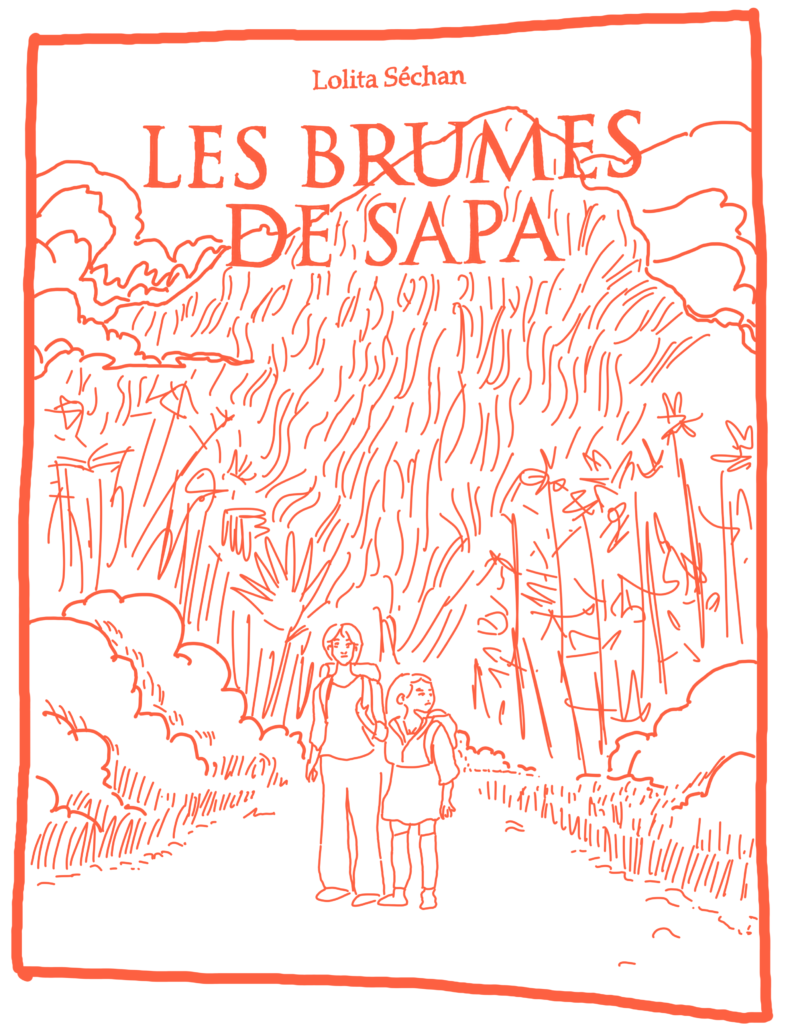
![[…] de quel droit fige-t-on quelqu'un ?](https://grignotages.com/wp-content/uploads/2018/10/8CC57081-3B50-47C2-B2EA-A3C5902514CB-1024x687.png)