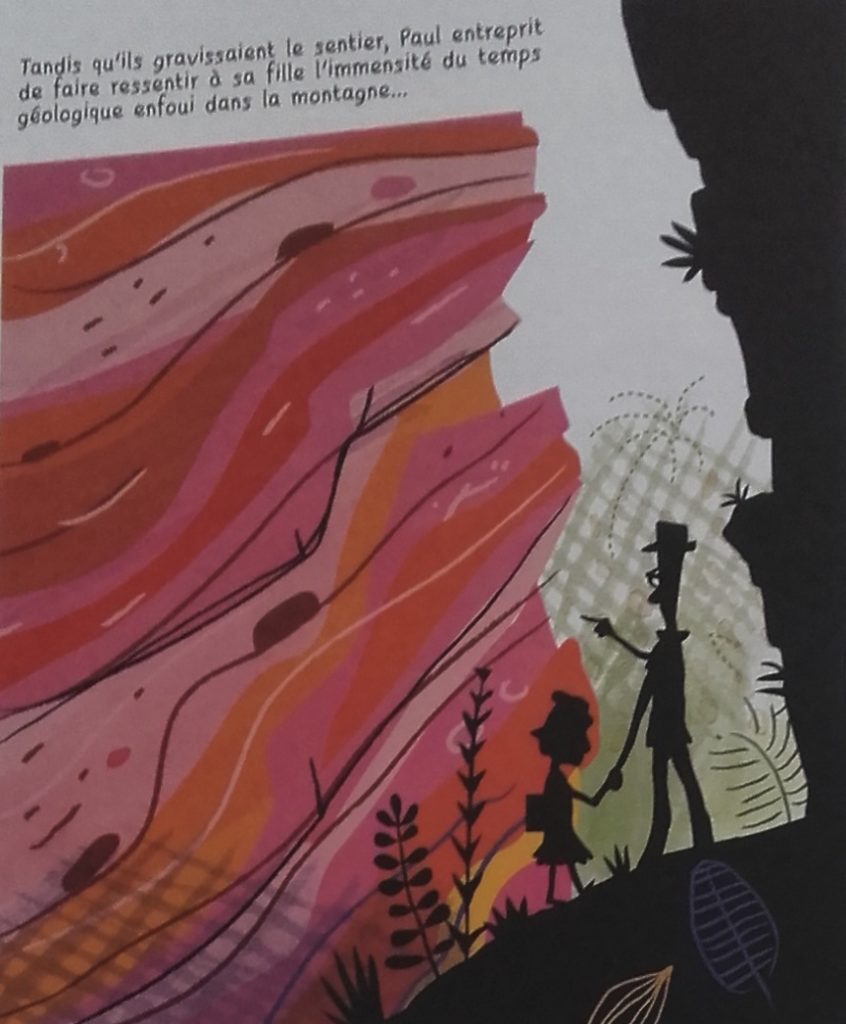Un chœur immense, de l’orgue, du latin en veux-tu en voilà : tous les éléments liturgiques d’une messe sont là. Mais guitares électriques, batterie et micro de comédie musicale : c’est aussi ça, la messe de Bernstein, qui déborde ainsi le registre annoncé. Peu à peu, on comprend qu’il s’agit moins d’une messe modernisée façon comédie musicale que d’une comédie musicale concertante sur la messe ; une interrogation sur la pratique dans sa forme même.
Un pasteur-récitant est là pour nous guider à travers cette grand-messe, preacher-crooner qui ramène régulièrement à la prière, tandis que les ouailles ne cessent de s’en écarter, assénant à la religion ses quatre vérités sans jamais cesser de se déhancher. Il s’agit moins d’épingler la tartuferie des croyants que d’interroger les aberrations et les scandales du dogme et de la vie, la confession qui choque comme une autorisation express à pécher, l’absence de Dieu dans la souffrance, les questions sans réponse… préoccupations de croyants révoltés plus que d’athées implacables. Chaque protestation, qui donne l’occasion d’admirer le chanteur qui la porte, est accueillie par une même conclusion : let’s pray. On comprend seulement à la fin, lorsqu’on entend soudain dans la voix faillible du preacher-crooner non pas quelque chose de moindre, d’éraillé, mais la fragilité de l’âge, de la vie, que ce n’est pas une tentative de fermer les caquets, mais une manière de rassembler les forces qui manquent et les espoirs qui flanchent — pour communier, sinon avec Dieu, du moins avec la communauté de ses infidèles, i.e. nous, spectateurs. On frissonne, on swingue, on s’étonne ; on s’en prend au moins autant plein la tronche que la religion, enveloppé dans le chant sonorisé, et moi, au tout dernier rang de la Philharmonie, second balcon face aux baffles, je kiffe : la beauté d’une messe sans son prêchi-prêcha.
Gloire soit rendue à l’Orchestre de Paris, et prions pour que ce soit régulièrement redonné.