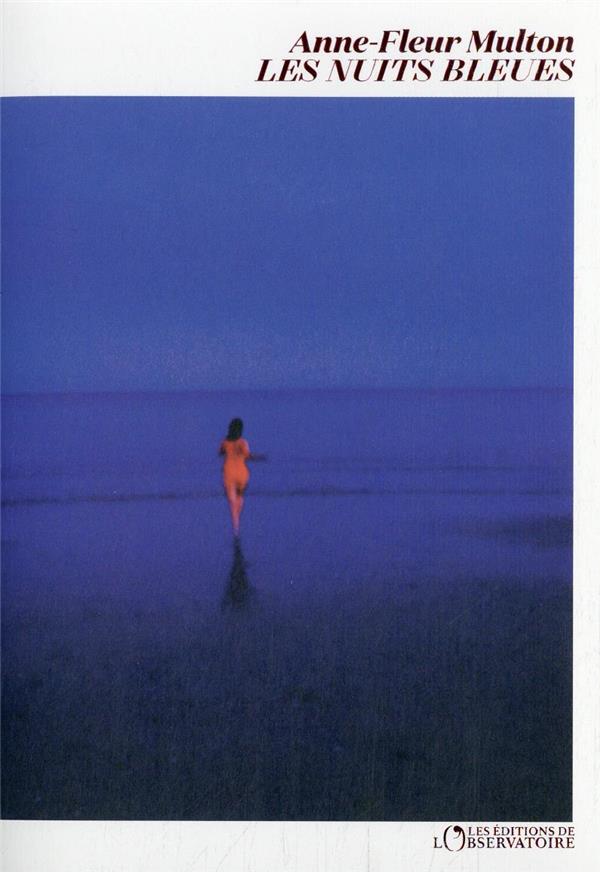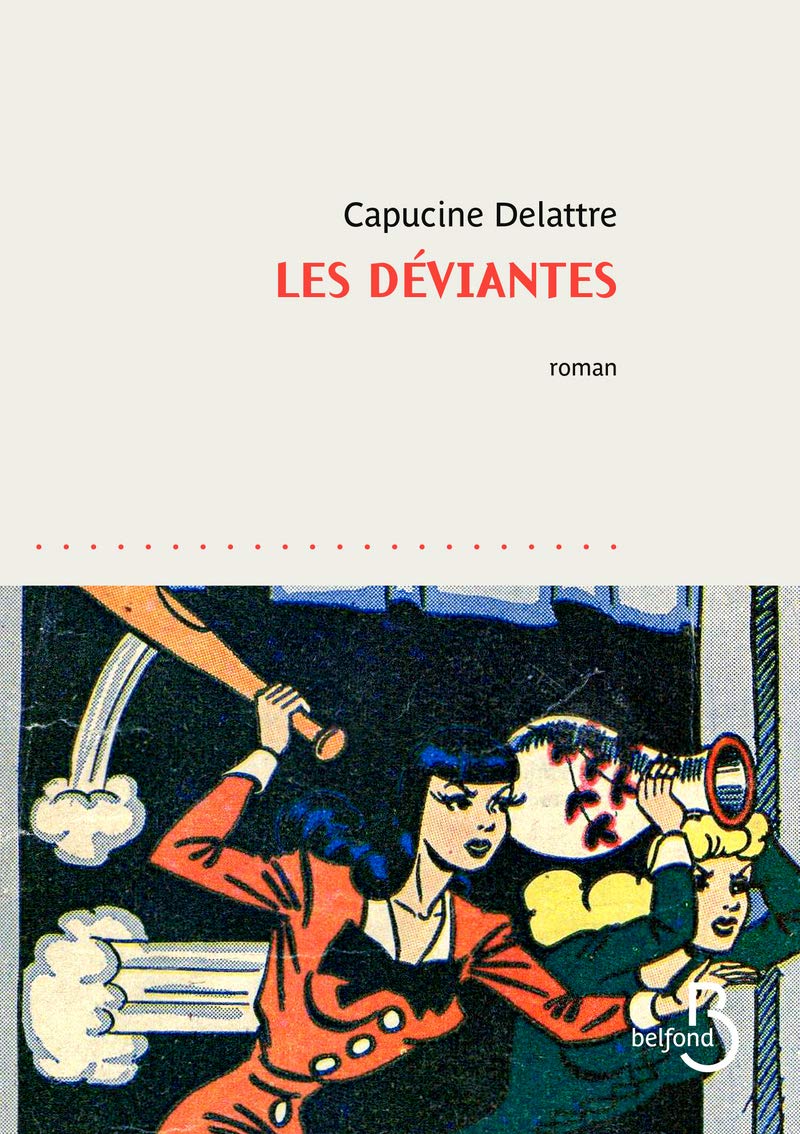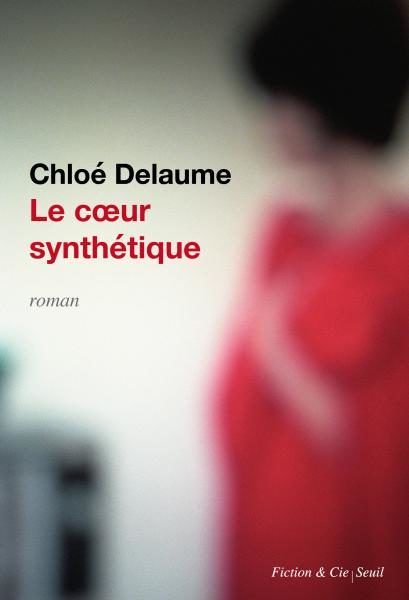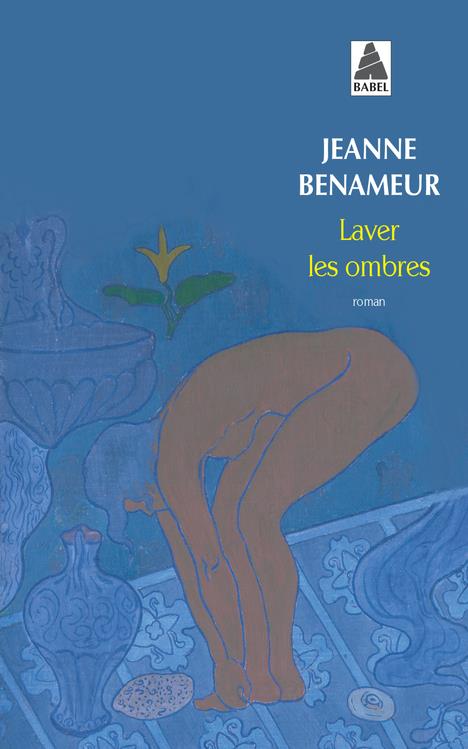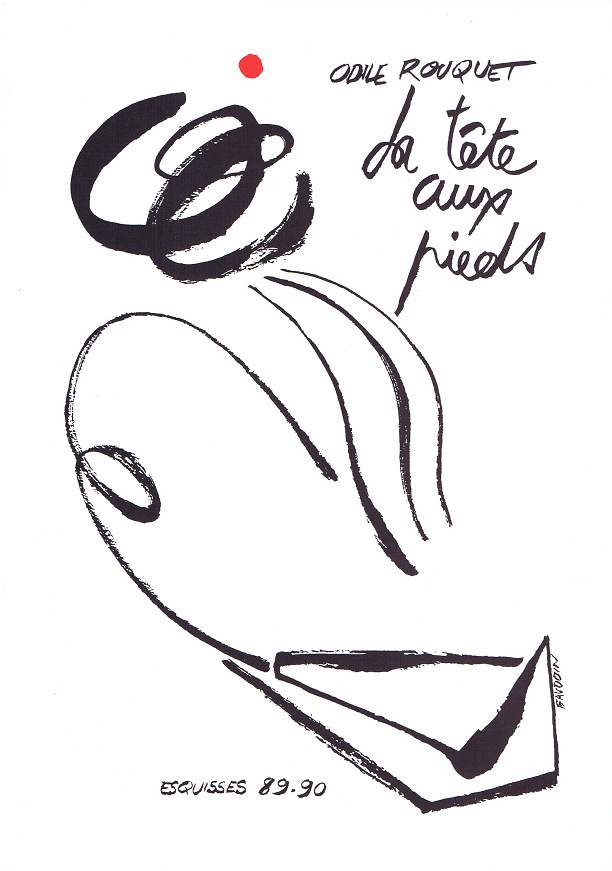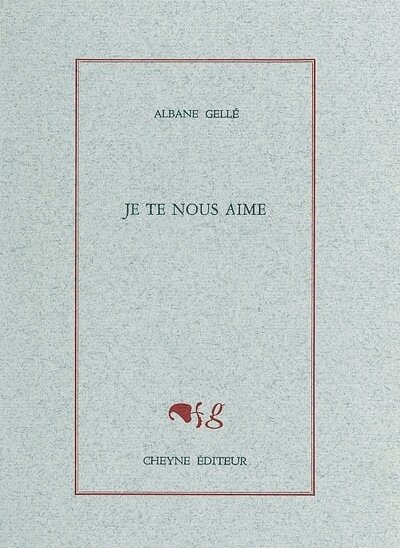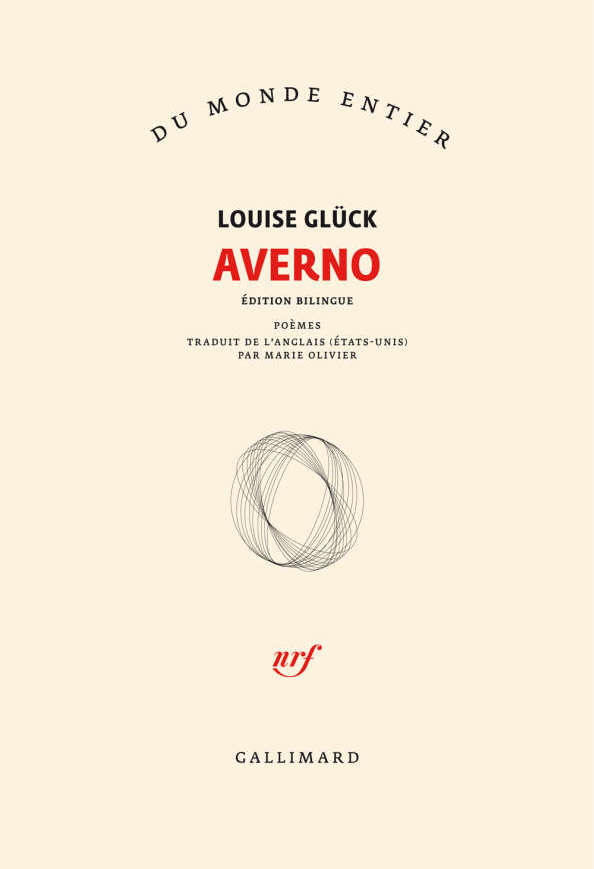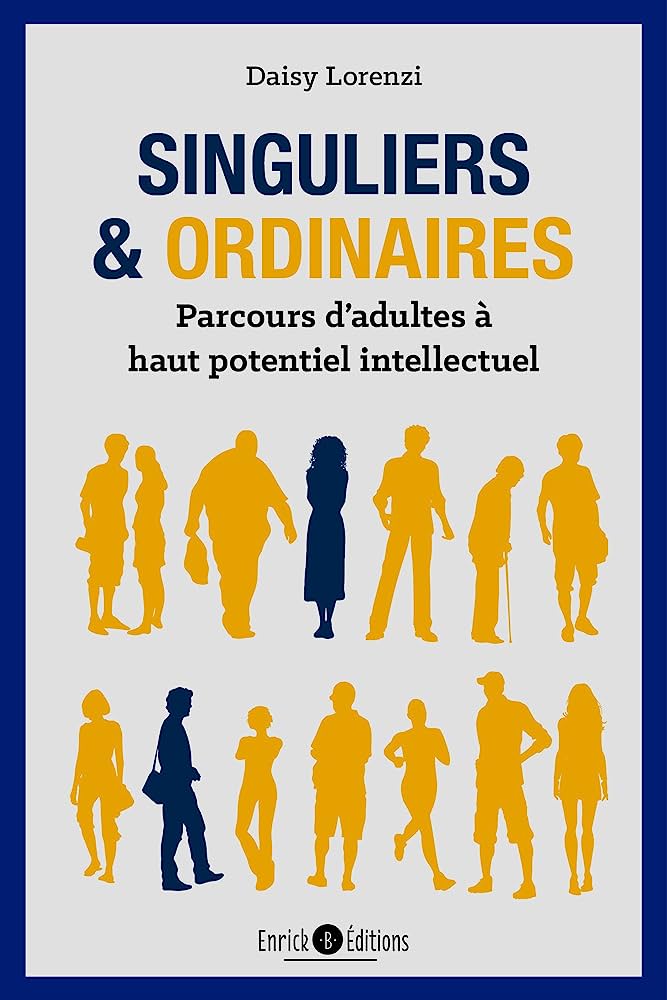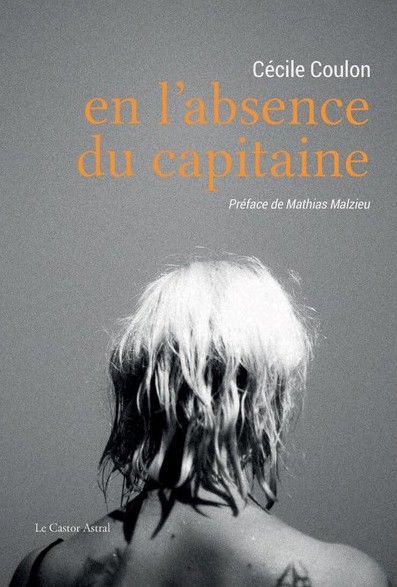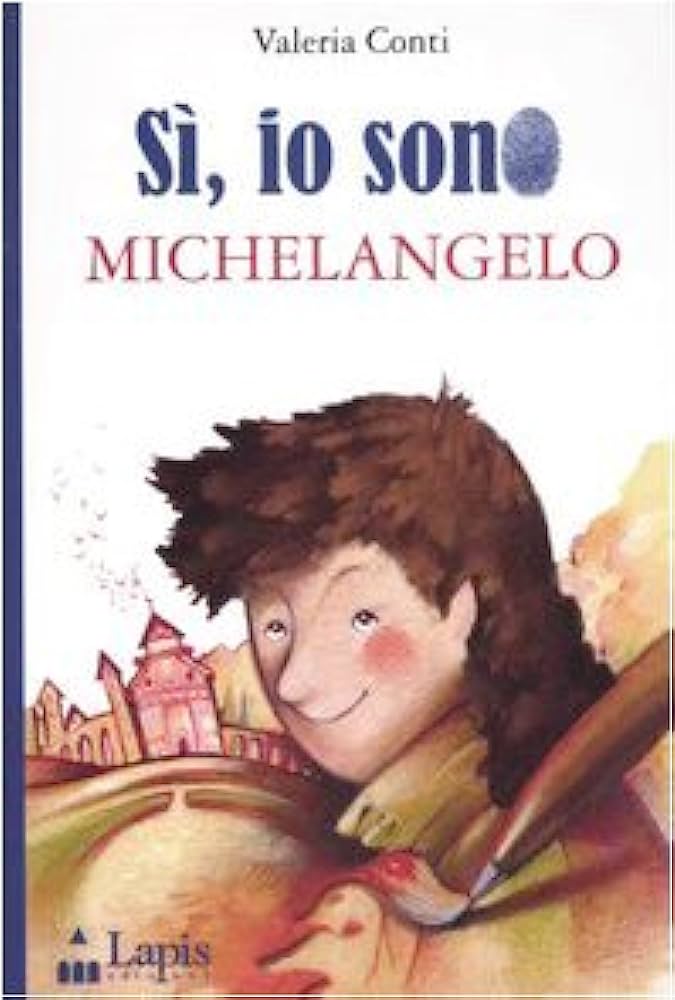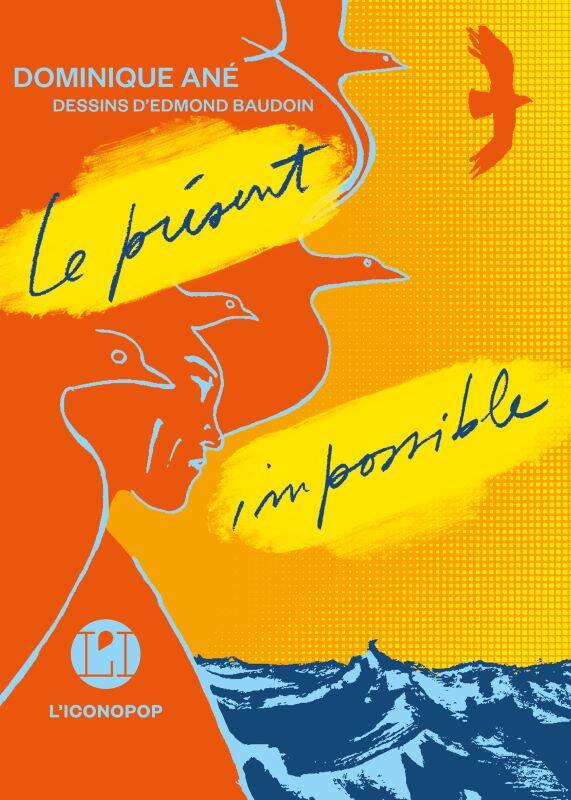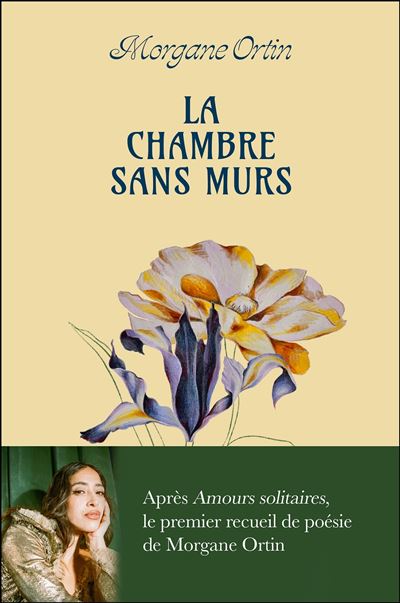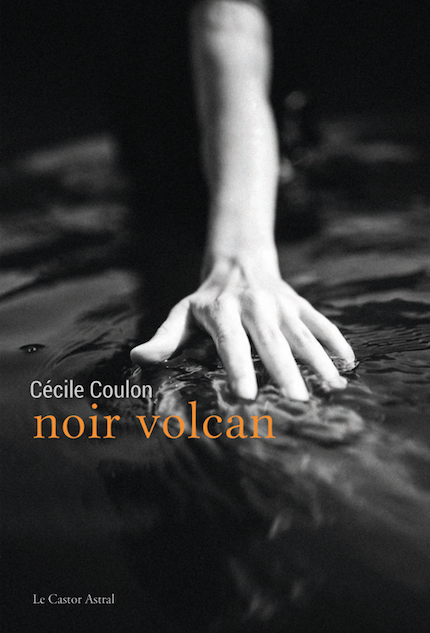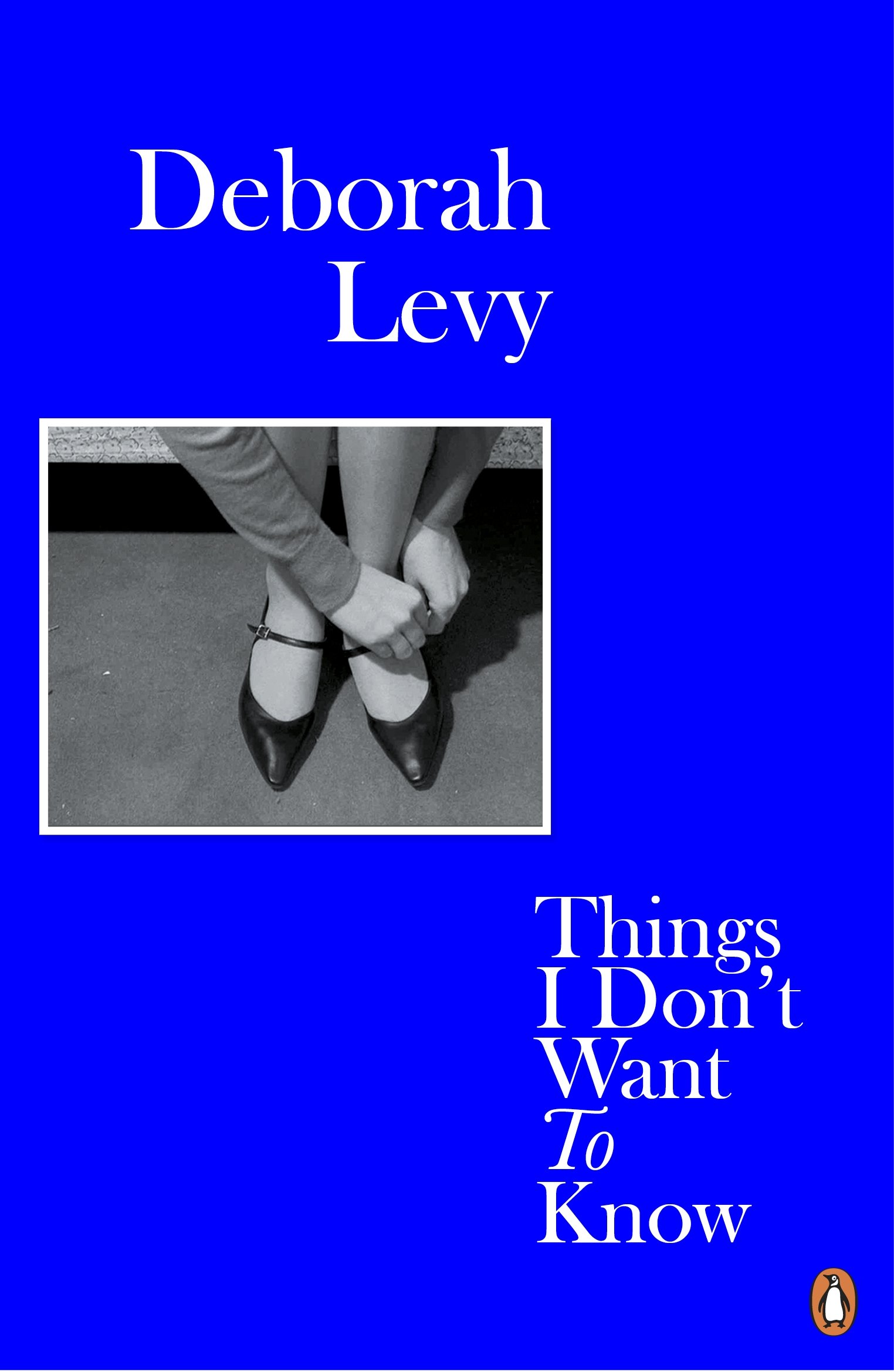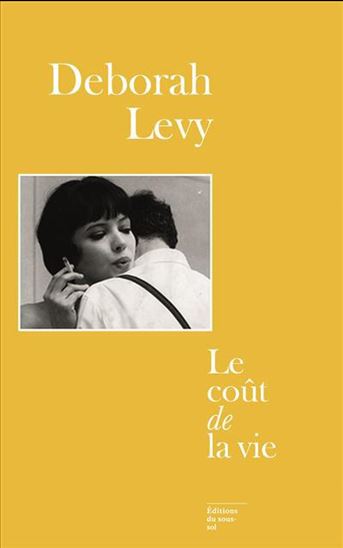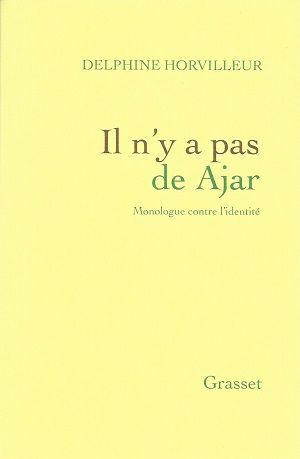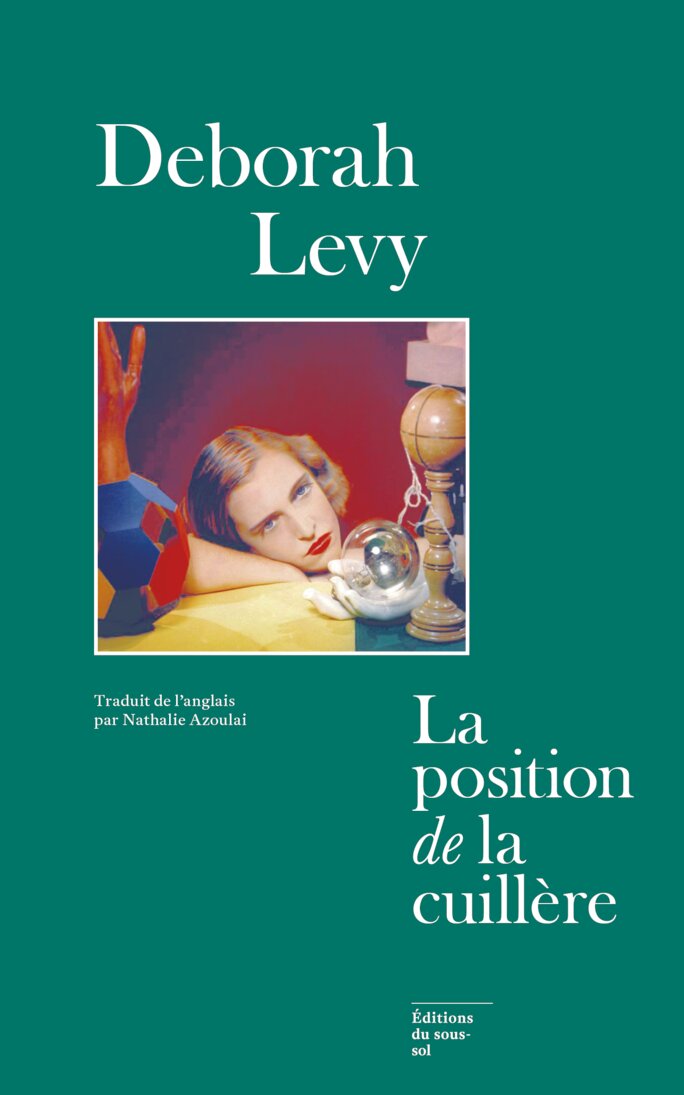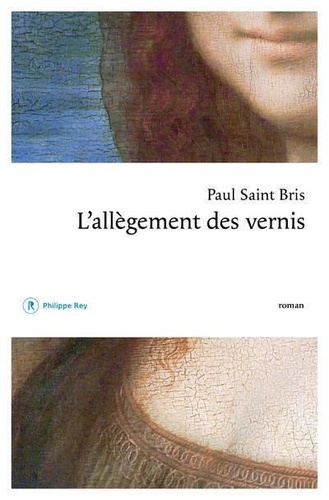La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.
La Danseuse de Patrick Modiano sent davantage la naphtaline que la colophane. On attend qu’une histoire se dégage de la mémoire du narrateur comme un fossile patiemment épousseté, mais on attend en vain et on assiste à l’inverse à un ensevelissement méthodique, souvenir après souvenir, revisités pour être définitivement perdus. Chaque court chapitre se donne ainsi comme un plan qui émerge d’une auréole sombre et palpite ou grésille un instant jusqu’au fondu au noir suivant. C’est une aquarelle patiemment travaillée au glacis, obscurcie de transparence, couche après couche. Le mystère ne se lève pas, ils se crée : à force de ressasser des tranches de vie vaguement anecdotiques, vaguement bohèmes, on se persuade avec toute la force de la nostalgie qu’il y avait une raison de tourner autour du sujet que l’on crée. En ne donnant pas de nom à la danseuse, qui reste « la danseuse », en retardant ou en se refusant à élucider les liens entre les personnages, en répétant le nom de certains lieux, Patrick Modiano tente de donner à son récit quelque chose du conte, mais n’est pas Alessandro Baricco qui veut. Le rideau ne se lève ni ne tombe jamais vraiment sur ce récit feutré comme une loge tendue de velours sombre, écrin confortable mais vide de tout bijou.
Étiquette : roman
Lectures 2023
Janvier : Les Nuits bleues, d’Anne-Fleur Multon 💙 / Le Pigeon, de Patrick Süskind / Rendez-vous sur tes barres flexibles, de Wilfried Piollet / The Book of moods, de Lauren Martin (un doute : l’ai-je fini ?) / Février : Les Déviantes, de Capucine Delattre / Le Cœur synthétique, de Chloé Delaume / Mars : Laver les ombres, de Jeanne Benameur 💙 / La Mort du roi Tsongor, de Laurent Gaudé / La Tête aux pieds, d’Odile Rouquet / Un jour mes princes sont venus, de Jeanne Benameur / Je te nous aime, d’Albane Gellé / Les Mains libres, de Jeanne Benameur 🤍 / Averno, de Louise Glück / Avril : Être à sa place, de Claire Marin / La Petite Fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel / Mai : L’Avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovic 🖤 / Vivre avec nos morts, de Delphine Horvilleur / Ça t’apprendra à vivre, de Jeanne Benameur / Singuliers et ordinaires, de Daisy Lorenzi / Éloge des fins heureuses, de Coline Pierré 💛 / En l’absence du Capitaine, de Cécile Coulon 🖤 / Juin : Sì, io sono Michelangelo, de Valeria Conti / Un parfum d’herbe coupée, de Nicolas Delesalle / Juillet : La chair est triste hélas, d’Ovidie / Point cardinal, de Léonor De Récondo / Le présent impossible, de Dominique And / La chambre sans murs, de Morgane Ortin / Noir volcan, de Cécile Coulon / Août : Aventure des barres flexibles, de Wilfride Piollet / Things I don’t want to know, de Deborah Levy / Les Débuts, de Claire Marin / Poétiques et politiques des répertoires, Les Danses d’après, d’Isabelle Launay 💛 (non fini) / Septembre : Éduquer à la motivation, de Jacques André / Octobre : Qui a tué mon père ? d’Édouard Louis / Le Coût de la vie, de Deborah Levy / Remèdes à la mélancolie, d’Eva Bester / Le Jeune Homme, d’Annie Ernaux / La Leçon de musique, de Pascal Quignard / Novembre : Il n’y a pas de Ajar, de Delphine Horvilleur / La Position de la cuillère, de Deborah Levy / Un monde plus sale que moi, de Capucine Delattre / Décembre : L’Allègement des vernis, de Paul Saint Bris 💙 / La Librairie sur la colline, d’Alba Donati / Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce, de Lola Lafon = 42 livres
42 livres lus dont
23 ouvrages de fiction (essentiellement des romans)
12 essais
6 recueil de poésie
![]()
Les auteurs — toutes des autrices, en réalité — dont j’ai lu plusieurs livres cette année :
- Capucine Delattre : Les Déviantes, dont j’ai du recopier un dixième sous forme de citations, et Un monde plus sale que moi qui explore les zones glauques (plus encore que grises) du consentement — le genre de lecture qui pègue (je n’arrive pas trop à savoir si je m’y suis vautrée ou engluée).
- Jeanne Benameur, ma rencontre de l’année : Laver les ombres, Un jour mes princes sont venus, Les Mains libres et Ça t’apprendra à vivre. Je recommanderais de commencer par Laver les ombres si vous êtes sensible à la danse, et sinon par Les Mains libres, que j’ai trouvé très émouvant.
- Cécile Coulon : En l’absence du capitaine, Noir volcan.
- Wilfride Piollet, pour qui analyse et poésie vont de paire quand il s’agit de danse : Rendez-vous sur tes barres flexibles, Aventure des barres flexibles.
- Claire Marin, que je suis depuis Rupture(s) : Être à sa place m’a davantage stimulée que Les Débuts.
- Delphine Horvilleur : Vivre avec nos morts, Il n’y a pas d’Ajar.
- Deborah Levy : j’ai lu les premiers paragraphes de Ce que je ne veux pas savoir debout à la médiathèque, et j’ai désespérément voulu savoir pourquoi l’autrice pleurait à chaque fois qu’elle empruntait un escalator en montée ; quoique ne pleurant ni en montée ni en descente, ça me semblait une situation à laquelle je pouvais tout à fait m’identifier. Presque certaine d’avoir un coup de cœur, j’ai voulu me réserver la primeur de la VO. J’ai donc acheté Things I don’t want to know à Londres… et je n’ai pas eu de coup de cœur. La bifurcation m’a déroutée : comment de l’escalator se retrouvait-on en Afrique du Sud, du journal adulte propulsé dans un récit d’enfance ? Pas assez emballée pour remettre 10 £ dans le volet suivant, mais néanmoins curieuse de la suite, j’ai emprunté
Le Coût de la vie en VF à la médiathèque. Rebelote : certains passages sont très plaisants, drôles ou émouvants, je suis volontiers l’autrice, mais force est de constater qu’elle ne me mène nulle part. On sent que l’anecdote est là pour être dépassée, pour faire sens, mais lequel donc ? C’est un peu décevant. Au point où j’en étais, j’ai attrapé la suite à la médiathèque, mais ce n’était pas du tout la suite : La Position de la cuillère est un recueil de courts essais préalablement publiés dans diverses revues — au moins, l’éclectisme ne prétend pas à autre chose que lui-même. Reste que j’ai un peu du mal à comprendre la hype qui entoure cette autrice / trilogie.
![]()
Deux romans marquants :
- L’Avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovic. Je serais bien en peine de vous faire une critique de ce roman d’une intensité complètement dingue. Le mieux est encore que vous le lisiez.
- L’Allègement des vernis de Paul Saint Bris, où il est question d’art et de tout ce dont il est question quand on parle d’art et qu’il n’est pas question d’art : d’ego, d’amour, d’habitude, de restauration, de politique, de communication… Beyoncé, le Da Vinci Code, la restitution de La Joconde réclamée par l’Italie, MeToo… tout ce qui a pu traverser le Louvre y passe, avec un mélange tout à fait étonnant de satire (les cabinets de conseil en prennent pour leur grade dans les stratégies de communication sur la restauration de La Joconde) et de poésie (Homéro, agent d’entretien esthète, danse parmi les statues à bord de son autolaveuse). Difficile de croire qu’il s’agit d’un premier roman tant c’est réussi et maîtrisé. Je l’ai offert à Mum pour Noël, qui m’a confirmé l’avoir trouvé succulent.
![]()
Bilan du challenge lecture
12 mois, 12 livres, recommandés par 12 personnes : un challenge qui m’a d’abord bien motivée en provoquant le hasard, puis m’a lassée en l’excluant, la liste de (pré)textes se muant en obligation. Reste que c’était chouette, un temps, de surmonter mes réticences à suivre les recommandations.

- 1 très jolie découverte : Les Nuits bleues, d’Anne-Fleur Multon.
- 1 très belle rencontre : Jeanne Benameur, dont la sensibilité m’a rappelée celle de Claude Pujade-Renaud. J’ai lu trois autres romans à la suite de Laver les ombres, et je compte bien continuer à emprunter un à un tous ceux qui les jouxtent sur l’étagère.
- 2 découvertes qui ont entraîné au moins une autre lecture : Delphine Horvilleur & Jeanne Benameur, donc.
- 3 auteurs que je connaissais déjà : Patrick Süskind, Claire Marin et Édouard Louis.
- 1 auteur vers lequel je lorgnais, mais que je ne m’étais pas résolue à aborder à cause de la noirceur de ses thèmes : Laurent Gaudé. Merci à la personne qui a proposé La Mort du roi Tsongor de m’avoir permis de ne pas passer à côté.
- 3 abandons : 1 parce que pas le courage de me lancer dans un pavé que je n’ai pas choisi (j’avais demandé des livres courts, qui ne vampirisent pas tout mon temps de lecture), 2 autres parce qu’ils ont été retirés du catalogue de la médiathèque avant que je puisse les lire.
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce
Curieux roman de Lola Lafon que ce Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce. Ça commence en huis-clos médical façon Maylis de Kerangal (Réparer les vivants), sous forme d’un journal adressé à une absente, puis le récit embraye sur la reconstruction de soi après un viol, et ça part en vrille-échappée belle sur fond d’une dystopie qui semble étrangement actuelle (une Élection dont la majuscule laisse supposer qu’il n’y en aura pas d’autre avant un moment, de la xénophobie d’État qui désigne des Autres, des Événements en protestation, un couvre-feu, des arrestations “préventives”… dans le Paris qu’on connaît, avec son opéra Garnier, son métro, sa Cinémathèque, etc.).
Les relations entre les protagonistes sont floues, aussi, résistent à l’étiquetage prématuré et définitif. La narratrice qui s’adresse à la jeune fille survivant dans le coma à une mort subite se fait passer pour sa sœur auprès du personnel médical. Elle l’appelle Émile, au lieu d’Émilienne. Elles passaient leur temps à s’appeler. Je les ai postulées amoureuses. Puis la narration est arrivée aux cercles de parole du mardi soir, et leur amitié est devenue plus plausible, mais pas simple, pas une simple amitié de socialisation heureuse — un lien de survivantes.
Malgré ce lien extrêmement fort, Émile disparait du paysage quand entre en scène La Petite Fille au Bout du Chemin, un jeune fille qui passe son temps à la cinémathèque et conserve toujours sur elle la Notice des médicaments qu’elle se garde bien de prendre. Entre elle et la narratrice se noue un lien fort, étrange, immédiat ; il y a du désir, du désir de vie qui ne s’arrête pas au corps de l’autre, désir de vivre entre les mailles de la société.
À mesure que ce lien se resserre, le reste autour se délite, le récit, la syntaxe parfois, des mots manquent, des mots débordent, des écrits sont insérés (la Petite Fille écrit frénétiquement dans son cahier, dont elle arrache des feuillets), clairement puis de moins en moins, alors que le discours indirect libre contamine la narratrice, alors que les deux Petites Filles se comprennent à demi-phrase, que leur clairvoyance augmente et leur santé mentale décline. La Petite Fille au Bout du Chemin restera la Petite Fille, sans nom propre, de même que la narratrice, qui n’en a que d’emprunt, surnommée “fifille” par Émile et “Voltairine” par la Petite Fille. À certains moments, il m’a fallu faire un effort pour distinguer qui narrait en s’adressant à qui.
La fin, sous forme d’échange épistolaire avec Émile, fait écho au journal du début, que lui adressait la narratrice. Émile, absentée à l’apparition de la Petite Fille, revient quand celle-ci disparaît. Il fallait bien cette amitié d’Émile et de la narratrice, longuement ancrée, pour servir d’écrin au passage éclair (avec fougue, avec foudre) de la Petite Fille. Moi aussi j’ai été frappée, et en suis sortie un peu sonnée.
![]()
Il y a ces citations que j’aurais voulu vous faire lire, perdues, cachées dans les 400 pages de ce curieux moment. Un passage sur le « Quand même » des protestations molles face à l’intolérable, auquel on finit par s’accoutumer. Un sourire qui éclabousse une photo d’Interpol. Une phrase, condensé violent de cette société où le viol reste souvent impuni — je l’ai retrouvée : “Et ça n’a aucune importance pour moi si ça n’en a pas pour elle, les confidences de celui qui, parce qu’il l’a pénétrée, s’arroge le droit de parle de sa « santé mentale ».” Tous les passages où il est question de danse, aussi, de manière si juste.
J’allais oublier, et pourtant j’ai adoré : la narratrice, en plus d’être roumaine, amie précieuse, victime de viol, traductrice, est, était, danseuse classique, et la danse, sans jamais être le sujet du roman, infuse son écriture et la caractérisation de la narratrice. On la suit dans ses souvenirs en Roumanie, à prendre des cours silencieux chez une professeure tombée en disgrâce et espionnée ; on la retrouve adulte, chantonnant l’adage de Giselle en faisant le guet, traduisant sous forme d’enchaînement le caractère subreptice d’une expédition nocturne : glissade, glissade, coupé, jeté, pointes acérées… Sylvie Guillem devient un mot-clé pour essayer de faire retrouver la mémoire à Émile, les séries sont remplacées par le YouTube balletomane, le corps se raidit en souvenir de ce qu’il dansait… Ce qui, chez un auteur novice, fonctionnerait comme des références relèvent chez Lola Lafon de réflexes — c’est véritablement ainsi qu’on pense quand on a infusé dans la danse ; c’est… mon monde !
Un jour Jeanne Benameur est venue
Après Laver les ombres, j’ai voulu lire d’autres romans de Jeanne Benameur. Debout dans les rayonnages de la médiathèque, j’ai lu plusieurs incipits pour déterminer lesquels me donnaient le plus envie de poursuivre. Un bol qui se cassait en deux dès la première page m’a fait immédiatement pensé à cet extrait presque anecdotique de Laver les ombres, vers la fin du roman, après l’acmé de la tempête :
L’ensemble devait bien former un tout, qu’on nommait, qui servait à quelque chose. Maintenant les deux sont inutiles et on peut les considérer séparément, comme si c’était des choses distinctes. On ne peut plus dire le nom.
Brisure commune. En quelques pages, titres, quatrièmes de couverture, j’ai senti apparaître une continuité de thèmes. La filiation et ses héritages psychogénéalogiques. Le geste, dansé ou non. L’abandon. L’intimité. Ce n’est probablement qu’une question d’ordre ; je finirai probablement par tout lire de Jeanne Benameur.
![]()
D’abord Un jour mes princes sont venus. J’ai tout de suite aimé le passage du futur au passé, du singulier au pluriel. Un prince viendra, est venu, puis un autre lui succède, successives projections idéalisées d’un père dont l’héroïne n’a pas fait le deuil (encore une fille qui avait perdu son père). C’est moins intense que le roman par lequel j’ai découvert Jeanne Benameur, mais c’est fin, évidemment. Sans spoiler, ça se termine comme ça :
Merci, mes princes.
Maintenant, un homme peut venir.
![]()
Puis Les Mains vides. Auprès de Madame Lure, qui met du temps à devenir Yvonne, et de Vargas, jeune homme qui vit dans une roulette et ne se sépare pas de sa marionnette Oro, j’ai retrouvé la densité poétique de Laver les ombres. L’envie de tout garder sous forme de citations.
![]()
Les images
Madame Lure rêve sur des brochures de voyage. C’est la première image qu’on a d’elle. Elle ne rêve pas aux destinations proposées ; elle entre dans les images, au contact des peaux, des étoffes et des éléments. Un jour, c’est la ville même qui devient un réservoir d’images, sans même avoir besoin d’en prendre des photographies :
Le jeune homme lui a appris sans le savoir, et désormais elle dérobe, elle aussi. À sa façon. Elle dérobe des images.
[…] Elle marche en cadence le long des rues et elle voit et elle prend. Le d’images lui appartiennent. Toutes. Toutes celles que sa rétine prend.
Cela me donne envie de retrouver cette attention flottante, poétique, des longs trajets urbains à pied, sans heure d’arrivée.
Les images sécrètent des images. En abondance.
Les images n’ont besoin que de caresse pour vivre.
Ils [les arbres] sont là, devant elle, de l’autre côté.
Elle se rend compte qu’elle préfère regarder leur reflet dans l’eau. Monsieur Lure, lui, les préférait dans les livres.
Lire, c’est voir les choses dans l’eau ? Les regarder par leurs reflets ?
![]()
Les mains
J’ai lu sans retenir le titre du roman ; j’ai mis du temps à retrouver la prégnance de la métaphore, plus attentive à la caresse qu’aux mains. Libres. Des mains libres, pas vides. Toujours cette histoire de lâcher prise, d’abandon consenti, qui découvre le contraire d’une crispation.
L’immobilité de ses mains l’avait saisi. Quelque chose dans son absence à tout était alors si concentré, si dense, qu’il en avait été bouleversé.
Cette femme existait comme un caillou sur le sentier.
Une présence rare.
Ses mains à elle ont toujours su prendre, tenir, porter, poser. Elle ne sait pas caresser. Il aurait fallu apprendre. Quelqu’un.
Ses mains essayent.
Caresser. Caresser.
Essuyer, ce n’est pas caresser.
Le chiffon, entre la peau et chaque chose, empêche.
Madame Lure sait que la nuit enveloppe les gens qui ils restent, comme elle, assis, seuls, dans une cuisine. Elle s’en est toujours gardée.
Ce soir, elle laisse faire.
Des morceaux d’elle partent à l’obscur. Elle consent.
[…] Celui qu laisse la nuit l’enveloppera ne compte plus les heures, c’est fini.
Il accepte d’être emporté. Il accepte d’être sans histoire.
C’est fini. Ses mains se sont ouvertes.
Le jour peut venir.
Cela ne changera plus rien.
Elle n’effacera plus la poussière.
Elle ne garde plus.
![]()
Les pleurs
Ce n’étaient pas des larmes de joie. Aujourd’hui, elle sait. C’étaient les larmes de toutes ses peurs retenues.
[Maudite par sa mère, elle mise dehors. Elle n’est qu’une enfant et le logis disparaît.] Son cœur avait fondu dans la muraille. […] Au matin, sa mère l’avait cherchée, appelé. Sa mère avait pleuré.
Elle, ne pleurait plus.
C’était fini.
L’existence de pierre, après ça, le « caillou sur un sentier ».
![]()
L’errance et le lien
Entre eux deux, un lien subtil qui se tisse de rencontre en rencontre.
Une confiance.
Eux deux : la vieille dame sédentaire et le jeune homme du voyage. Encore une de ces relations qui n’ont pas de nom (ni amitié, ni mère-fils de substitution, même si ça aussi).
Une confiance : qui se tisse dans la cuisine de la vieille dame. C’est amusant, mais cette cuisine, pour moi, c’est la cuisine de Mum à Versailles ; j’ai simplement remplacé la fenêtre en PVC par un cadre en bois et stylisé la ferronnerie moderne de la balustrade dans un esprit hausmannien. Vous aussi, votre imagination fait souvent de la récup comme ça ?
C’est toujours celui qui se souvient qui vieillit le plus vite.
Les errants servent à montrer l’errance.
L’errance sert à quoi ?
Est-ce qu’elle ne sert pas juste à prouver au monde qu’aucune route ne mène ?
Les routes n’existent que pour qu’on les parcoure.
Il le sait.
Il l’a vécu.
Assez.
Il le sait à l’hostilité qu’il sent monter autour d’eux. L’hostilité de ceux qui ne bougent pas et les regardent en se demandant Vont-ils rester ? Veulent-ils rester ?
Des errants qui s’arrêtent, cela bouleverse l’ordre des choses.
Il le sait, ils font lever dans les coeurs la mauvaise pâte. Toutes les vieilles peurs. […] Voleur.
[…] Soudain, les objets les plus habituels, ceux qu’on ne regarde plus, prennent une valeur inestimable : celle de pouvoir disparaître.
![]()
La lecture
Madame Lure ne lit pas.
J’ai l’impression de ne pas pouvoir comprendre ça, ne pas lire, de ne pas pouvoir rentrer en empathie avec quelqu’un qui ne lit pas (alors qu’il sait lire). C’est idiot. Le pouvoir de la lecture de m’en faire prendre conscience.
Un silence comme un puits.
Le silence qui vient des livres parce que ceux qui les ont écrits ont accepté de s’y enfoncer. Habiter avec les livres, c’est habiter avec le silence des autres.
Il est d’autres silences.
(Si j’aime lire, c’est pour le silence ?)
Ce jour-là, dans cette pièce, Yvonne perçoit le silence des livres.
Elle y entre comme dans un jardin.
Tout ce qu’elle voit depuis qu’elle est au monde est là, entre les pages.
Elle sait que s’y trouve aussi, dans des pages et des pages qu’elle n’ouvrira jamais, tout ce qu’elle ne verra jamais.
Le monde est vaste.
C’est ici qu’elle le sent.
Tout ce qu’elle n’a pas vu hier, avant-hier et tous les autres jours ; tout ce qu’elle n’a pas su voir et ne verra pas demain ; tout ce qui aura lieu encore bien après qu’elle ne sera plus rien, est là. Sur les pages.
Elle confie son instant, paupières closes, au silence du monde. Et quelqu’un l’écrira. Oui, quelqu’un l’écrira.
C’est une confiance. Qui rejoint. […] Tout ce qu’elle éprouve, quelqu’un, un jour, l’a éprouvé. Parce que c’est comme ça. C’est le monde. Ce que sent lui, un autre aussi l’a senti. Toujours. Quelque part. Peut-être très loin sur les cartes de géographie. Peut-être très loin sur les pages des calendriers. Qu’est-ce que cela peut faire ?
Contraste entre la première lecture du roman…
Yvonne Lure n’essaie pas d’entrer dans l’histoire. Elle relie les mots. Un à un. Juste cela. Les uns à distance respectueuse des autres.
… et la fin.
De sa voix juste, elle va jusqu’au bout. Et toute l’histoire que raconte le livre prend place en elle. Pour la première fois.
Le livre alors redevient un livre, un objet qui se rouvre et se donne, se disperse dans la ville (sur un banc, un rebord de fenêtre, une boîte à livre) ou se jette à l’eau… comme dans Laver les ombres. J’en prends seulement conscience à l’instant où j’écris ce dernier paragraphe : c’est la même image d’une vieille dame qui jette un livre à l’eau !
Laver les ombres
Recommandé par Anna Coluthe dans le cadre du challenge 12 mois, 12 livres suggérés par 12 personnes, Laver les ombres a été davantage qu’une bonne surprise, m’a fait l’effet d’une rencontre, presque. Si l’on était dans un magazine féminin, je résumerais l’affaire par une de leurs équations à double connus :
Alessandro Baricco + Claude Pujade-Renaud = Jeanne Benameur
D’Alessandro Baricco : le mystère, la maîtrise narrative, des destins en maison close, l’Italie, l’horreur tout en délicatesse, des héritages intimes troubles.
De Claude Pujade-Renaud : la justesse du geste, la danse, le désir, l’abandon, le mouvement dans ce qu’il cache et révèle d’intime.
![]()
Laver les ombres, en photographie, signifie mettre en lumière un visage pour en faire le portrait.
![]()
La ville
Elle a besoin d’horizon.
En ville, elle a appris que c’est par le haut qu’il se donne.
Lea soupire fort. Un homme qui passe lui sourit. Elle sourit aussi, comme les enfants, en retour. Le sourire demeure et lui fait du bien. L’homme n’en saura jamais rien. C’est ce qu’elle aime dans la ville.
![]()
Danser, l’espace, le vide
Danser c’est altérer le vide.
Pourquoi inscrire un mouvement dans le rien ? […] […] Elle se sent intruse. Depuis toute petite.
Alors elle danse. Il faut qu’elle trace, avec son corps, les lignes qui permettent d’intégrer l’espace. Seule la beauté du mouvement peut la sauver.
C’est sa façon de trouver place dans la vie.
La concentration totale sur chaque vibration d’archet et une absence tout aussi totale à soi-même. Alors seulement quelque chose a lieu.
[…] À nouveau, peu à peu, elle entre dans l’espace. Elle y a droit. Alors son monde lui appartient. Et elle, elle appartient au monde.
Danser, c’est attirer le vide.
Un péril intime.
Ce péril-là, c’est elle qui le choisit. On n’échappe pas à la seule forme de liberté qu’on s’est donnée soi-même.
(Cette dernière phrase…)
Danser c’est altérer l’espace. Lea le sait.
Rien n’est intact. Jamais.
Aimer, c’est partager l’altération.
Elle partage.
![]()
Le non-désir de maternité
Toutes les femmes de son âge veulent un enfant. Panique à bord. Les quarantièmes rugissants… elle se moque mais elle se regarde depuis quelque temps comme on retourne une poche vide. Ce désir-là, elle ne l’a pas. Elle ne l’a jamais eu.
![]()
Le refoulé
Elle n’a pas de clef pour fermer sa porte. Rien dans sa bouche pour articuler un refus. […] Elle connaît maintenant la guerre par la peau.
Leur sueur, leur odeur, le toucher de leurs doigts ont fait d’elle un palimpseste vivant de la guerre. Ils ne savent pas qu’ils inscrivent chacun leur histoire sur elle, en elle.
Tatouée, à l’intérieur.
[…] Pour les viols, les tortures, il ne paient pas.
Pour elle, oui. Et très cher.
Pour être libre, il faut apprendre. Elle n’a pas appris.
Épouser, pour lui, c’était tout remettre en ordre.
Il avait dit Je te l’avais promis, quand la guerre serait finie.
Mais elle, elle était morte entre-temps et il n’avait rien vu.
Une à une, elle déchire les pages de son vieux livre d’amour, les laisse tomber dans l’eau. […] Et là-bas, à Naples, personne ne lui a jamais demandé de mots d’amour. Elle les connaît par cœur pourtant, ne les a jamais osés.
Il faut bien que les mots d’amour se disent un jour. Même si personne ne vous prend dans ses bras pour les entendre.
[…] Elle ignorait qu’elle avait tant et tant de phrases inscrites, à l’intérieur d’elle. Sous la peau.
Des passages entiers. Comme des blocs de falaise usée qui s’écroulent.
![]()
Le corps du désir
L’odeur de Bruno, le poids de ses épaules dans ses mains, son ventre chaud, toujours chaud. Bruno, c’est son océan.
Si un jour il s’écarte d’elle alors il n’y aura plus rien pour relier son corps au monde et elle sera devenue une île. Inabordable.
Les caresses de Jean-Baptiste n’en finissaient pas de l’émerveiller. Elle découvrait qu’elle avait un ventre, des seins, une bouche. Mais la joie la plus profonde, c’était son regard sur elle.
Il lui donnait son poids sur terre.
![]()
Le corps de la danse
[S’abandonner] Avec le mouvement de la danse, elle traque exactement l’inverse. La conscience dans chaque muscle, aiguë, que le cerveau appelle.
Rassembler tout l’être dans le corps, le tenir, le tenir.
Tant que Lea mettait toute sa passion dans la danse, elle était à l’abri. Romilda le savait d’instinct.
Elle va poser pour lui.
[…] Maintenant elle est nue et ce n’est pas pour faire l’amour.
[…] Ce qui est terrible c’est d’être nue, sous le regard de Bruno, sans les gestes de l’amour.
[…] Il ne comprend rien. La nudité, pour un spectacle, c’est pensé, c’est décidé. Il y a une justesse. C’est un choix. Et sur scène c’est elle qui conduit le regard du spectateur. Elle est libre.
Il ne comprend pas ?
Ici elle n’est pas libre.
[…] Elle est encore plus nue d’entendre nommer ses épaules qu’il faut relâcher, son ventre. Il dit Laisse, ça va se faire tout seul.
Il faudrait hurler Non rien ne doit se faire tout seul. Je ne veux pas. Ce n’est plus moi. Moi je ne peux pas lâcher mon corps une seconde tu entends ?
![]()
Aimer : tentatives
Elle n’aura plus jamais assez de toute sa vie pour l’aimer.
On croit qu’il suffit d’aimer pour faire corps avec le reste. C’est faux.
Dans la lumière rasante de cette fin de journée, il apprend qu’il aime et que cela ne suffit pas.
Est-ce qu’aimer, ce n’est pas vouloir rejoindre, sans relâche ?
Aimer c’est juste accorder la lumière à la solitude.
Et c’est immense.
![]()
Apprendre à trébucher.
Intégrer le faux pas.
En faire sa danse.
Apprendre la marche imparfaite de tous ceux qui ont dans le corps un poids qui se déplace et les entraîne. Sans qu’ils y puissent rien.
Et danser avec ça.
Tous. Des semblables. Qui tentent de rétablir l’équilibre. À chaque pas. Entravés, empêtrés dans les vies et les histoires qui s’agrippent, déséquilibrent.
![]()

Il reste encore de la place pour 3 voire 4 suggestions, car l’un des ouvrages a été retiré du catalogue de la médiathèque (c’est l’un de mes deux critères : lecture courte, disponible à Roubaix).