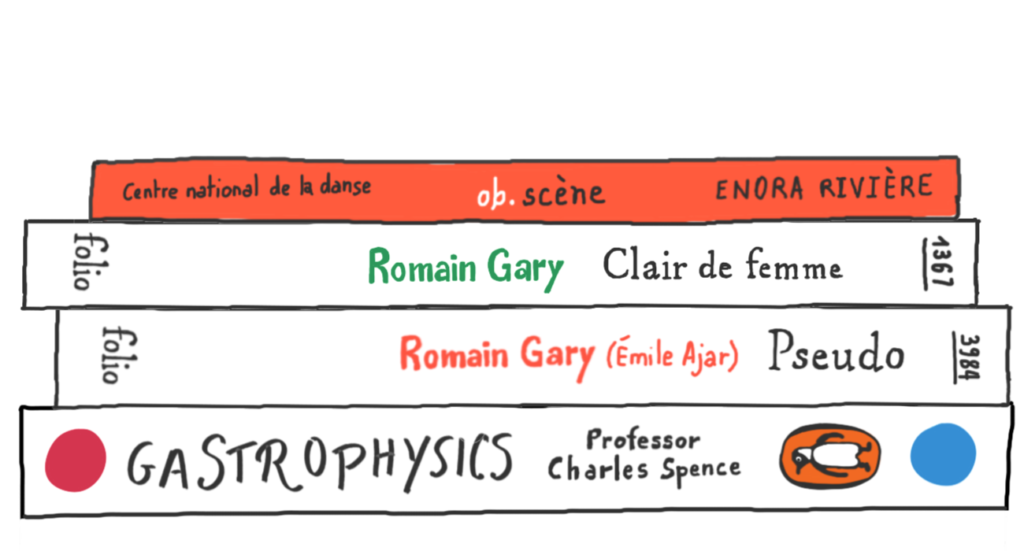
Les livres s’entassent à l’horizontale au-dessus de mes petites bibliothèques, en attendant d’être chroniquettés et d’obtenir ainsi le droit à l’oubli, rangés à la verticale aux côtés de leurs congénères. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus, il y a plusieurs mois, plusieurs années pour certains ; aussi ai-je résolu de les prendre par petits tas pifométriques pour vous en dire ce qui m’en reste. L’oubli devrait rendre l’exercice intéressant : ce qui n’était pas mémorable devrait passer à la trappe, et j’ose espérer que les souvenirs, décantés, s’énonceront avec davantage de concision (edit : up to a certain point).
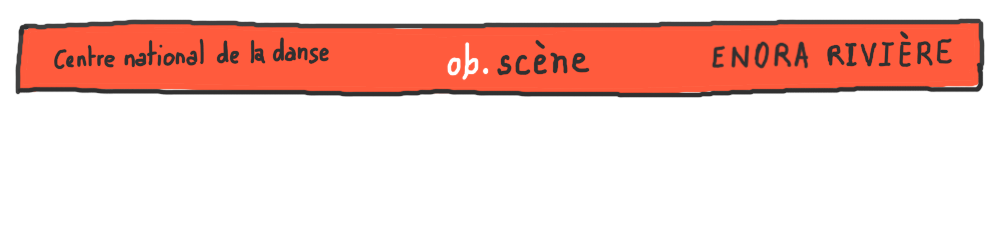
Ce petit livre d’Enora Rivière m’a longtemps fait de l’oeil. Je le prenais et le reposais à la FNAC : je me doutais que j’apprécierais, sans savoir si je saurais assez l’apprécier (toujours l’idée que plus tard, plus concentrée, je lirai mieux). Je repoussais : j’avais toujours déjà à lire, et 10 € pour un si petit livre, tout de même. Cela me faisait une idée de cadeau à dégainer facilement, j’attendais l’occasion. Puis un jour, j’ai passé une commande de DVD ou de matériel sur Amazon, et il me fallait soit payer les frais de ports, soit ajouter un livre : je me suis fait ce petit cadeau.
Cadeau par sa couleur et son titre, mélange de jeu de mot et d’étymologie qui me ravit : ob.scène, ce qui se présente devant la scène et y fait écran. Dans mon esprit : ce qui serait obscène si cela n’était pas sur scène, mis en scène et ainsi partageable. Quelque chose d’intime. Il y a de ça dans ce petit livre d’Enora Rivière, de la justesse. À partir de sa propre expérience et d’entretiens avec des danseurs, l’auteur raconte la vie de danseur, de l’intérieur, ce qui passe par la tête et ce que l’on ressent, tout ce qui se vit, par le mouvement.
C’est beau et juste comme je l’anticipais. Décevant aussi : non pas tant parce que les danseurs sont des danseurs contemporains, mais parce qu’ils sont danseurs, au pluriel, à se partager un je indéfini. On sent d’un paragraphe à un autre que l’on n’a plus à faire à la même personne, à la même expérience (ne serait-ce que par le glissement entre féminin et masculin) sans pour autant pouvoir discerner des consciences distinctes. La polyphonie s’effondre en amalgame : trop de personnes et il n’y a plus personne ; la parole, si juste à l’échelle du paragraphe, se désincarne au fil des pages – un comble quand il est question de danse, de corps.
Il faudrait pouvoir lire ce livre en résistant à la tentation de la totalité, de manière fragmentaire – ou y lire l’aspiration de la danse à l’idéal (un idéal désincarné que je pensais essentiellement lié à la danse classique, que l’on retrouve ici par la danse contemporaine).
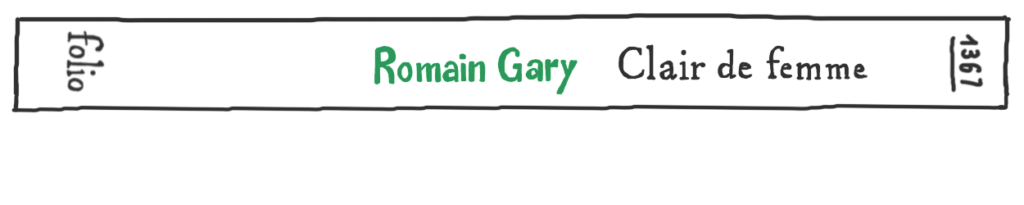
Pendant des années, Romain Gary ne m’a pas attirée – doux euphémisme. Puis j’ai vu l’adaptation de La Promesse de l’aube au cinéma, et je me suis dit, quand même, essayons. Bonne pioche que Clair de femme : le côté histrionique de l’auteur est excusé par son narrateur, que l’on suit d’incidents en errances sur un laps de temps assez court, mais qui n’en finit pas, tandis que sa femme, atteinte d’une maladie incurable, se laisse la nuit pour se donner la mort. On serait fou à moins de chagrin.
La bizarrerie et la beauté de ce court roman vient de la recommandation et requête de sa femme : qu’il trouve une autre femme à aimer, à travers laquelle l’aimer et l’oublier ; une femme qu’il devra aimer dans sa singularité, pour que son amour puisse survivre. Cette offre généreuse est en même temps dérangeante, effaçant la singularité d’une femme derrière le besoin générique d’aimer et d’être aimer. C’est un cadeau et un fardeau, pour lui comme pour elle, la nouvelle femme qu’il rencontre et qui le devance de peu dans son travail de deuil. Mort et vie en symétrie.
Dans la nuit même de la fin, s’ouvre un espace intime, dont on sent, à désir et à regret, qu’il pourra déboucher sur un nouvel amour. Ce passage de relai, incongru d’advenir si tôt, volontairement, constitue peut-être l’adieu le plus déchirant qui soit.
Pour quelques belles citations, je vous renvois à mon thread Twitter.
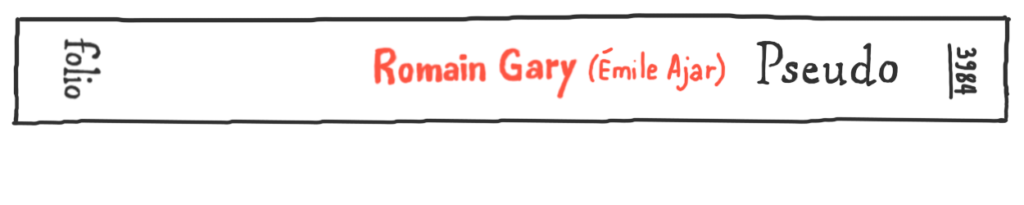
J’ai continué sur ma lancée avec Pseudo. Moins bonne pioche. La schizophrénie du narrateur mime le dédoublement de l’auteur avec son double pseudonymique, et joue de la confusion entre maladie psychiatrique et exercice de style littéraire. C’est brillant par moments, avec des éclairs de folle lucidité (dépressive ?), mais globalement épuisant (le maniaque du maniaco-dépressif). Je me suis forcée à finir, mais cela a fini par me taper sur le système…
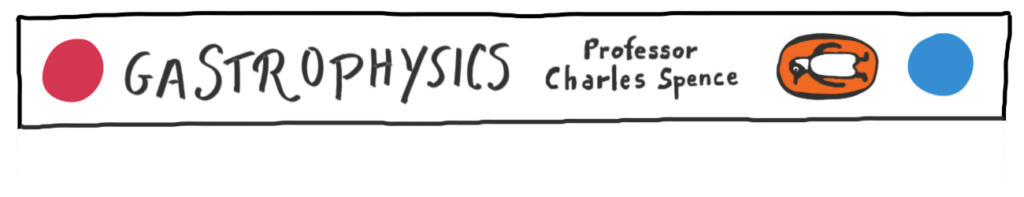
L’idée d’une food science m’enchantait, mais force est de reconnaître que la couverture est bien meilleure que le texte qu’elle renferme. L’éditeur a trouvé un bon graphiste mais n’a pas fait son boulot sur le texte, inutilement bavard et émaillé de redites : après avoir exposé quelques notions intéressantes (non sans une erreur !), l’auteur se vautre avec délice dans la description des expériences new age de restaurants étoilés. Cent cinquante pages de moins, et cela aurait pu être amusant ; en l’état, c’est seulement lassant. Sur le double de pages que compte le bouquin, je retiens trois éléments :
- la confusion des saveurs (par les papilles) et de l’odeur (par le nez) dans la constitution du goût, ce truc évident mais assez étrange qui peut me faire dire que le gel douche au citron a le goût des bonbons Krema alors que je n’ai évidemment jamais avalé ledit gel douche ;
- plus globalement, la synesthésie dans la dégustation, avec une drôle d’expérience : des gens ont été invités à manger des chips, avec ou sans la diffusion d’une bande-sonore crousti-croquante. Toutes provenaient des mêmes paquets, mais les chips croquées en même temps que la bande sonore étaient jugées plus fraîches que les autres par les participants (cela ne m’étonne guère : un de mes grands plaisirs lorsque je mange de la mousse au chocolat, c’est d’écouter le bruit de la cuillère passant dans ce bain moussant cacaoté) ;
- la stratégie sonore de certains restaurants : la musique classique, associée à une idée de luxe, augmente la qualité perçue du repas ; tandis que certaines chaînes font exprès de diffuser de la musique rythmée à fond les ballons pour encourager le roulement des consommateurs, qui consciemment ou non n’ont guère envie de rester exposés au bruit trop longtemps.
J’aurais imaginé et aimé davantage de ces éléments d’économie comportementale – un Dan Ariely appliqué au champ de la nourriture. Bref, un livre à réécrire.


