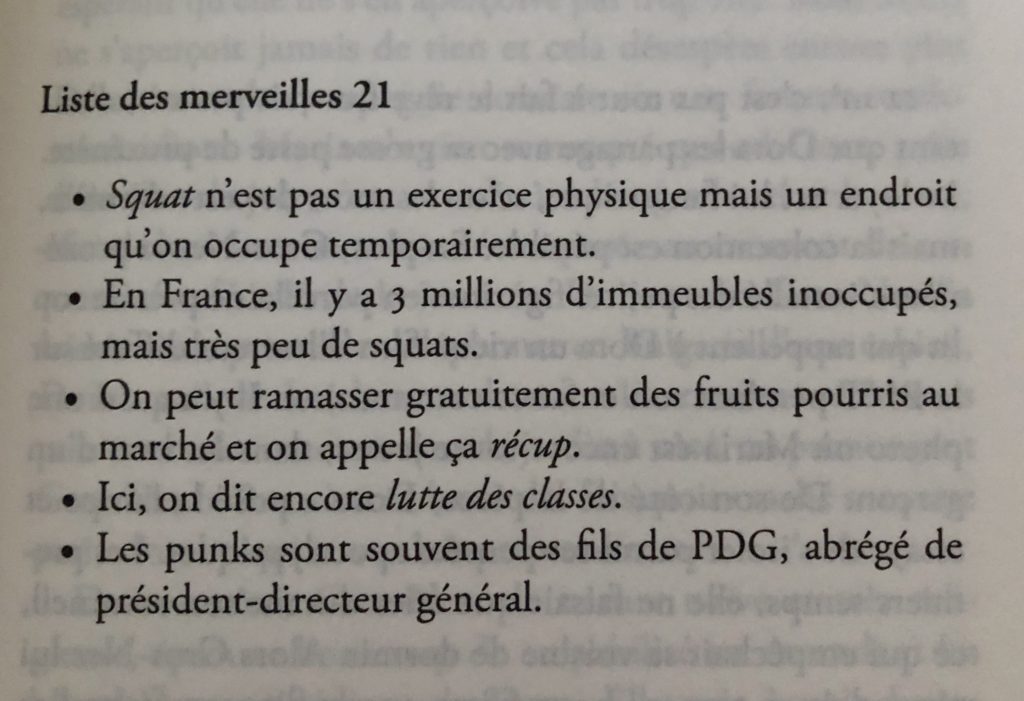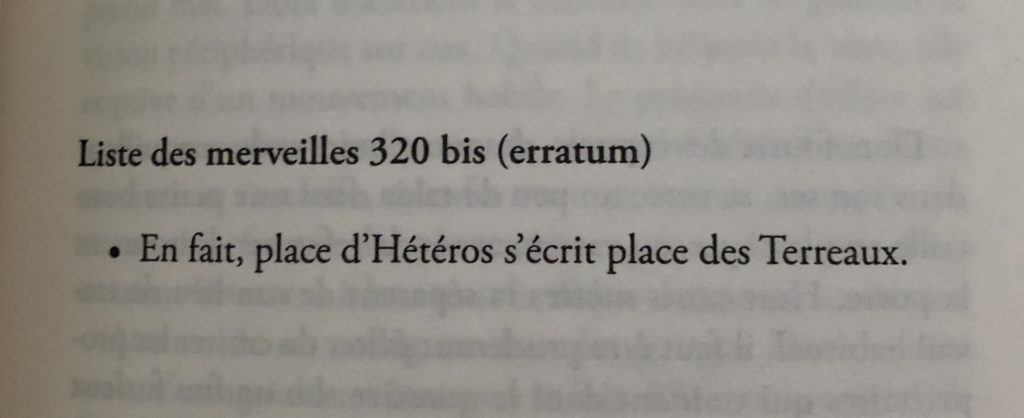Le cours se dissout dans les souvenirs de notre formatrice et se transforme en récit de son enfance et sa carrière à Cuba. Elle nous raconte les lieux incroyables dans lesquels ils jouaient, les maisons de riches familles ayant fui la dictature communiste, des milliardaires nous dit-elle sans qu’on sache dans quelle monnaie elle compte, qui avaient tout laissé comme ça, les meubles, les bibliothèques pleines… L’une de ces maisons était une réplique d’Autant en emporte le vent. Ils jouaient là-dedans, et sur les terrains de golf, improvisaient au bord de la rivière avec les étudiants musiciens — elle mime un violoncelle —, dansaient sur les toits de l’école nationale d’art.
Il est question de bâtiments-boyaux, qui vus du dessus représentent l’anatomie des intestins. Je ne saisis pas bien s’il s’agit d’architecture réelle ou rêvée parce qu’elle nous raconte la construction d’un bâtiment qui n’aurait pas abouti, trop proche de la rivière, sur des terres inondables, mais il est question d’un studio où l’on prend la barre sur une coursive en hauteur avant de descendre pour le milieu, et ça me semble plus futuriste que les prisons panoptiques retournées à l’état de ruines.
Elle habitait trop loin pour retourner chez elle le week-end, alors elle restait là, à La Havane, avec d’autres élèves venus de toutes les régions de l’île, danseurs, musiciens, peintres… c’était une école d’art, pas une école de danse ou de musique. Tout était gratuit, on leur préparait le petit-déjeuner, tout était payé, jusqu’aux pinces qu’elle avait dans les cheveux — elle cherche une pince plate autour de son chignon banane comme si c’était une preuve, regardez. Mais à la moindre bêtise, c’était dehors — ses mains se rencontrent et l’une part loin, prend la porte, avant que les deux se lèvent : c’était comme ça. Il y en avait dix, trente qui attendaient de prendre sa place. C’était comme à l’Opéra, mais en moins guindé, moins contraint, pas de révérence à chaque adulte croisé, tous artistes mêlés.
Elle a vécu des choses incroyables, elle a eu de la chance et elle l’a payé cher, aussi. Ou pas cher, elle se reprend, elle préfère voir les choses positives, mais elle a payé son refus de devenir jeune communiste. On le lui a proposé comme un honneur, elle était la meilleure de son groupe, et face à des gens alignés comme un tribunal de l’Inquisition (comme dans Le Nom de la rose, mais non, je ne l’ai pas vu) elle a dit non, non merci. La suite, j’ai du mal à comprendre : elle n’a pas voulu trahir, tous les autres, ceux qui sont rentrés aux jeunesses communistes ont trahi par la suite, elle ne voulait pas risquer par une bêtise de les trahir, qu’on puisse à travers elle reprocher quelque chose au régime. Je ne saisis pas si c’est un positionnement étrange ou une ligne de défense pour continuer à lire des livres qui provoquent des attention chuchotés quand elle en parle, et à rencontrer tous les artistes qui passent à sa portée. Elle refuse de se laisser formater par quiconque. Puis il y a ce mirador du haut duquel un jeune homme s’est jeté ; sa lettre d’adieu révélait qu’il était homosexuel. Elle a la main au cœur, à la gorge, les yeux au mirador en racontant ça.
On lui a fait payer son refus des jeunesses communistes. Envoyée dans une compagnie de second rang alors qu’Alicia Alonso l’avait pressentie depuis deux ans pour intégrer la compagnie, elle retourne se plaindre, au ministère ou je ne sais où, elle est plus maligne, elle intrigue, promet que si elle n’intègre pas la compagnie nationale, elle arrête la danse. Son interlocuteur s’offusque, que la meilleure de son groupe arrête la danse, cela ne se peut, il appelle, intrigue (tout est intrigue alors), se débrouille pour lui faire intégrer la compagnie nationale. À chaque tournée à l’étranger par la suite, elle est suivie, surveillée — d’autant qu’elle fréquente des étrangers et que son mari travaille à l’Université : quand on pense, on est toujours suspect de penser autrement. Cette surveillance lui donne encore des frissons dans le dos ; c’était comme le KGB. Comme les Soviétiques, ils craignaient des défections, mais elle ne l’a jamais fait, on sent qu’elle y met un point d’honneur, à cette loyauté ambivalente, elle n’a jamais trahi. Même lorsque, repérée par le maître de ballet de Béjart, contrat dûment signé, on lui interdit de le rejoindre. D’autres la consolent, elle se console en se le rappelant : à Bruxelles, elle n’aurait dansé que du Béjart, là elle dansait tout, le Lac, Giselle, Béjart, tout, elle a tout dansé.
Comment cette femme s’est-elle retrouvée à Roubaix ?
 Lire deux romans du même auteur d’affilée ou presque, c’est prolonger le plaisir de l’immersion dans son univers, mais aussi prendre le risque de voir les mécanismes stylistiques empiéter sur la narration. Le comique de répétition s’enraye dans la production de périphrases homériques héroï-comiques (la directrice de l’école à la jupe immense parsemée de diverses fleurs des champs, le secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare et président du conseil de l’État de la République populaire de Bulgarie, le camarade Todor Jivkov ou encore le chien de l’héroïne, l’indestructible bâtard Joki) et autres figures de style voyantes (c’est le moment de caser « épanorthose »).
Lire deux romans du même auteur d’affilée ou presque, c’est prolonger le plaisir de l’immersion dans son univers, mais aussi prendre le risque de voir les mécanismes stylistiques empiéter sur la narration. Le comique de répétition s’enraye dans la production de périphrases homériques héroï-comiques (la directrice de l’école à la jupe immense parsemée de diverses fleurs des champs, le secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare et président du conseil de l’État de la République populaire de Bulgarie, le camarade Todor Jivkov ou encore le chien de l’héroïne, l’indestructible bâtard Joki) et autres figures de style voyantes (c’est le moment de caser « épanorthose »).
 Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.
Troisième lecture d’affilée écrite à la deuxième personne, tu ne trouves pas ça étrange ? Cette fois-ci, Hyam Zaytoun s’adresse à son mari présent-absent : un arrêt cardiaque et trente minutes de massage paniqué ont débouché sur un coma et probablement un cerveau endommagé. À partir de là, Vigile se fait récit d’amour et de détresse : c’est la parole continue dont l’absent se trouve enveloppé pour rester présent, rapportant et redoublant les paroles prononcées à son chevet, à l’hôpital, sans savoir s’il peut les entendre.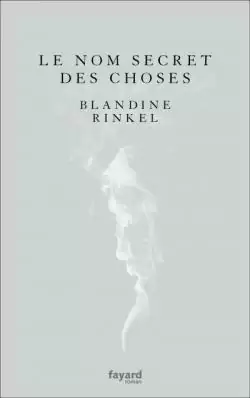 Bruits de Paris orchestrés dans l’incipit, modulations imperceptibles mais signifiantes dans la voix… Blandine Rinkel possède un sens de l’observation sonore qui m’a plus d’une fois surprise au cours de ma lecture. Je me suis fait la remarque que ce sont des choses qu’aurait pu relever le boyfriend ; ça m’étonne à chaque fois parce que ça échappe à ma sensibilité, beaucoup plus visuelle, olfactive et tactile.
Bruits de Paris orchestrés dans l’incipit, modulations imperceptibles mais signifiantes dans la voix… Blandine Rinkel possède un sens de l’observation sonore qui m’a plus d’une fois surprise au cours de ma lecture. Je me suis fait la remarque que ce sont des choses qu’aurait pu relever le boyfriend ; ça m’étonne à chaque fois parce que ça échappe à ma sensibilité, beaucoup plus visuelle, olfactive et tactile. L’Odyssée des filles de l’Est commence par une scène d’attente à la préfecture, où il est question de grenouille, de poisson et de gargouille. Je ne pensais pas qu’une scène d’attente à la préfecture pouvait être drôle ; Elitza Gueorguieva me prouve que si. Le délire méta en moins, j’ai un peu eu l’impression de retrouver le ton de Nina Yargekov dans Double nationalité :
L’Odyssée des filles de l’Est commence par une scène d’attente à la préfecture, où il est question de grenouille, de poisson et de gargouille. Je ne pensais pas qu’une scène d’attente à la préfecture pouvait être drôle ; Elitza Gueorguieva me prouve que si. Le délire méta en moins, j’ai un peu eu l’impression de retrouver le ton de Nina Yargekov dans Double nationalité :