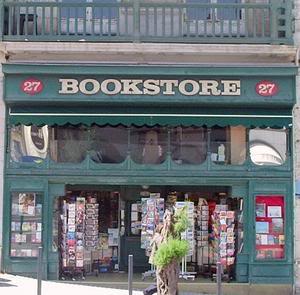B/ Ce que je crois qu’est le livre
Où je ne résiste pas à la pulsion du fichage
II L’hypothèse répressive (le I est plutôt une introduction avec feu d’artifice de questions, donc je laisse de côté)
1) L’incitation aux discours
Tout d’abord, il faut réfuter la thèse adverse, et comme la thèse adverse n’est pas constituée mais est de l’ordre du préjugé bien entendu dans lequel nous baignons allégrement, il convient de l’établir, de prendre en compte ses arguments, pour dans un deuxième temps comprendre en quoi cette vision des choses n’est pas juste et pourquoi elle s’est néanmoins installée. Il s’agit en fait moins réfuter ce qui n’est pas une thèse que comprendre le fonctionnement de l’idéologie. Autant dire que cet itinéraire retors prend un certain temps. C’est la mise en question de l’hypothèse répressive selon laquelle la répression du sexe aurait commencé à être visible à partir du XVII° et se serait poursuivie crescendo jusqu’à la fin du XIX°, avec une inflexion (et non disparition) au XX°. Foucault ne s’attache pas à montrer le degré de fausseté d’une telle conception, mais va mettre en relief certains éléments qui en suggèrent une autre (jusqu’à ce que, ayant atteint un tel degré d’élaboration, elle phagocyte le première thèse et en montre non la vérité ou fausseté mais le fonctionnement, la traitant non pour ce qui est dit, mais comme discours ayant un contexte bien déterminé et des effets précis) : au XVII° (et rendue visible au siècle suivant) est apparue une prolifération des discours sur le sexe, qui ne servent ni ne sont les effets négatifs de la répression mais constituent un nouveau dispositif de pouvoir. En affirmant cette « explosion discursive », Foucault ne méconnaît pas l’appauvrissement forcé des discours alors produits ; la « codification de toute une rhétorique de l’allusion et de la métaphore » participe de ce phénomène d’expansion, et à la limite, la langue se châtierait pour pouvoir en parler.
La première forme que prend l’injonction à parler du sexe est celle de la confession catholique. « L’aveu de la chair ne cesse de croître », de l’acte lui-même, mais aussi de plus en plus des pensées et des désirs qui l’accompagnent, si bien que c’est moins l’obligation d’avouer les infractions aux lois du sexe, qui importe, que « la tâche , quasi infinie, de dire, de se dire à soi-même et de dire à un autre tout ce qui peut concerner le jeu des plaisirs », de « faire de son désir, de tout désir, discours ». Cette « mise en discours du sexe » élaborée avec la pratique de la confession (pour le maîtriser) se retrouve là où on l’attendrait le moins : dans la littérature scandaleuse du XVIII°, où le récit du plaisir majore celui-ci. Si les effets attendus sont différents dans un cas que dans l’autre, il n’en demeure pas moins que la parole est censée avoir un effet sur ce qu’elle ne semble que rapporter, qu’on en attend « des effets multiples de déplacement, d’intensification, de réorientation, de modification sur le désir lui-même. »
Cette « grande injonction polymorphe » à parler du sexe se retrouve au XVIII° dans des domaines aussi variés que :
–l’économie : l’apparition d’un souci de la « population » distincte du « peuple », en tant qu’elle est également main d’œuvre et donc liée à la richesse du pays, implique la prise en compte des taux de natalité, de l’âge du mariage, des effets du célibat et autre donnée chiffrée du même ordre, qui donne envie de déchirer ses fiches d’histoire
–la pédagogie : soucis et recommandations des médecins et des professeurs aux familles (environnement surveillé, avec dortoir non mixtes par exemple)
–la médecine et la psychiatrie qui cherchent dans le sexe la boîte de Pandore des maladies mentales ou divers perversions.
–la justice
Multiplication quantitative mais surtout qualitative de ce qui n’est donc pas un mais des discours sur le sexe. La question se pose alors de savoir pourquoi persiste le thème selon lequel le sexe est hors discours. Et là, c’est l’instant du coup de baguette magique du philosophe. Lapin blanc : et si cela ne faisait pas justement « partie de l’injonction par laquelle on suscite le discours ? ». Disparition de la colombe (vous n’aurez désormais plus la paix) : « Ce qui est propre aux sociétés modernes, ce n’est pas qu’elles aient voué le sexe à rester dans l’ombre, c’est qu’elles se soient vouées à en parler toujours, en le faisant valoir comme le secret. »
2) L’implantation perverse
Jusqu’à la fin du XVIII°, le licite et l’illicite en matière de sexe sont définis par la religion et la loi civile, et centrés sur les relations matrimoniales. Il y avait les relations dans le mariage et ‘le reste’ où l’inceste voisine joyeusement avec l’adultère et la sodomie (j’adore les listes de Foucault) et où le « contre-nature » n’est perçu que comme une vision extrême du « contre la loi ». C’est au XIX° siècle, celui de l’hystérie classificatrice, que l’on opère la distinction entre les deux. Tan
dis que le couple légitime « tend à fonctionner comme une norme, plus rigoureuse peut-être, mais plus silencieuse », on se tourne vers le hors-norme, et « un monde de la perversion se dessine ». Ce n’est pas qu’il apparaisse à ce moment ou devienne toléré (y’a du boulot), mais c’est qu’on lui donne la parole, ou plus exactement qu’on la lui arrache, s’il est vrai que se multiplient du même coup les instances de contrôles et les mécanismes de surveillance mis en place par la pédagogie et la thérapeutique.
L’important n’est pas pour Foucault le degré de répression, mais le fait que la fonction du pouvoir qui s’exerce là n’est pas celle de l’interdit (qui serait couplé avec la mise sous silence et non l’enquête maniaque et bavarde du phénomène interdit), mais davantage une prise de contrôle :
–par l’aménagement de « lignes de pénétration ». Dans le domaine de la pédagogie, par exemple, le « vice » de l’enfant est moins un ennemi qu’un support qui assure une prise sur l’espace familial à tout un régime médico-sexuel.
–par l’ « incorporation des perversions » aux individus qui en manifestent les signes et qui deviennent ainsi en quelque sorte une espèce à part, identifiable et donc plus aisée à écarter. Par exemple, « L’homosexualité est apparue comme une des figures de la sexualité lorsqu’elle a été rabattue de la pratique de la sodomie sur une sorte d’androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. »
–en attisant les désirs ‘anormaux’ qu’il semble chercher à éteindre : le plaisir d’exercer un pouvoir « qui questionne, surveille, guette, épie, fouille, palpe » créé et relance « un plaisir qui s’allume d’avoir à échapper à ce pouvoir, à le fuir, à le tromper ».
Il s’ensuit que ce serait moins les individus aux comportements sexuels a-normaux qui seraient pervers (adj) que le mécanisme lui-même par lequel on les constitue comme pervers (nom) : « la société moderne est perverse, non point en dépit de son puritanisme ou comme par le contrecoup de son hypocrisie ; elle est perverse réellement et directement ».
L’explosion des discours sur le sexe ne seraient donc pas l’effet d’un esprit de contradiction en réponse à la répression, mais la manifestation de l’imbrication (selon un dispositif qui n’est pas celui de la loi) du plaisir et du pouvoir qui ne se retournent pas l’un contre l’autre : « ils se poursuivent, se chevauchent et se relancent. » Plaisir pervers à dénoncer la perversion du plaisir.
III Scientia sexualis
Le fait que le discours sur le sexe ait été repris par et réélaboré en tant que science n’est pas anodin dans la mesure où cette science échoue à comprendre entièrement le fonctionnement du sexe et va se focaliser particulièrement sur la dimension pathologique. Ainsi la biologie de la reproduction, qui ne pose pas spécialement de problème, est doublée par une médecine du sexe qui se développe à l’écart et dont le degré de scientificité est assez fantaisiste, prise qu’elle est entre crédulité et aveuglement : « une telle dénivellation serait bien le signe qu’il s’agissait en ce genre de discours, non point de dire la vérité mais d’empêcher qu’elle se dise. » Et pourtant, « ne pas vouloir reconnaître, c’est encore une péripétie de la volonté de vérité », et, se proclamant science, cette médecine contribue à constituer le sexe comme un enjeu de vérité.
La science n’est pas le seul moyen par lequel se peuvent obtenir des discours de vérité sur le sexe : de nombreuses sociétés se sont dotées d’une ars erotica (habituel pédantisme qui consiste à mettre les expressions en latin – mais bon, comme ça relève du fichage, je n’y touche pas – et puis sait-on jamais, il y a peut-être une référence que je n’ai pas). Où la vérité est extraite du plaisir lui-même, pris en compte par rapport à lui-même et non par rapport à une quelconque utilité. S’il y a silence, c’est qu’il y a secret ; il ne s’agit pas pour autant d’infamie, plutôt du mystère qui entoure le rite d’initiation.
Dans notre civilisation, pas d’art érotique mais une scientia sexualis qui fonctionne à l’opposé du secret, par l’aveu. Foucault retrace l’histoire de ce procédé qui s’est intégré à nous au point de nous paraître naturel : « Nous sommes devenus, depuis lors, une société singulièrement avouante ». Au point que l’on n’a plus le moins du monde l’impression que l’aveu est extorqué : il affranchit et s’il ne sort pas, c’est qu’une contrainte pèse sur lui. Singulière inversion, quand on y pense et qui explique, selon Foucault le grand cas que l’on fait de la censure, interdiction de dire et de penser (en négatif donc, ce qui contraint au silence, et non ce qui extorque une parole). L’aveu assurerait l’assujettissement des hommes : sujets de leur aveu à la première personne et sujets de celui qui leur tire les vers du nez.
Le sexe a été matière privilégié d’aveu, et comme tout aveu, il s’inscrit par sa forme dans une relation de pouvoir, puisque « l’instance qui requiert l’aveu, l’impose, l’apprécie et intervient pour juger, punir, pardonner, consoler, réconcilier ». L’instance de domination est du côté de celui qui écoute et se tait, et le discours de vérité « prend effet, non pas dans celui qui le reçoit, mais dans celui auquel on l’arrache. »
Cette technique de production de vérité par l’aveu a produit de grandes archives des plaisirs, qui se sont effacées à mesure qu’elles se constituaient, jusqu’à ce qu’interviennent la médecine et la psychiatrie qui ont fait fonctionner les rituels de l’aveu dans les schémas de la régularité scientifique :
–par une codification clinique du faire-parler (la formulation me paraît aussi charlatanesque que la nature pseudo-scientifique des observations, m’enfin)
–par le postulat d’une causalité générale et diffuse, l’envers théorique d’une exigence technique : faire fonctionner l’aveu dans les cadres de la scientificité (voyez le résultat). Pour pouvoir tout interroger, il faut présupposer que le sexe peut être cause de tout et de n’importe quoi – le danger justifiant l’inquisition.
–Par le principe d’une latence intrinsèque à la sexualité (là, vous commencez à suer, et ne savez pas si c’est le soleil ou le mal de crâne qui approche). L’aveu se déplace : « il tend à ne
plus porter seulement sur ce que le sujet voudrait bien cacher ; mais, sur ce qui lui est caché à lui-même », le fonctionnement du sexe demeurant obscur.
–Par la méthode de l’interprétation. La vérité de l’aveu, non plus preuve mais signe, ne réside plus dans le seul sujet avouant, mais est doublée par l’interprétation de l’interlocuteur.
Et là, page 91, on arrive à une approche de ce que peut être la sexualité : vérité du sexe et de ses plaisirs, au point de croisement d’une technique d’aveu et d’une discursivité scientifique. On reçoit confirmation de ce qu’on avait deviné, « l’histoire de la sexualité doit se faire d’abord du point de vue d’une histoire des discours ». Ouf, il était temps. Enfin : « Avançons l’hypothèse générale du travail ». Page 92.
Au XVIII° la société bourgeoise a donc entrepris de formuler la vérité réglée du sexe, « comme si elle suspectait en lui un secret capital », en en faisant le point de fragilité de l’individu. En effet, si on demande la vérité sur le sexe (et puisqu’il a besoin d’être déchiffré, on se réserve le droit de dire nous-mêmes cette vérité), c’est qu’on lui demande « de nous dire notre vérité ». Et voilà qu’on se retrouve défini par notre sexe de façon bien plus englobante que la case F ou M à cocher sur les paperasses administratives. Ce qui est tout de même commode, c’est que la vérité du sexe a besoin d’être interprétée pour dire la vérité sur celui qui l’interprète : le processus comporte assez de retournements pour paraître objectif, et permet néanmoins de biaiser un peu le résultat (comme tous les tests pseudo-psychologiques qui foisonnent un peu partout) ou du moins de se définir soi-même. « La causalité dans le sujet, l’inconscient du sujet, […],le savoir en lui de ce qu’il ne sait pas lui-même, tout cela a trouvé à se déployer dans le discours du sexe. Non point, cependant, en raison de quelque propriété naturelle inhérente au sexe lui-même, mais en fonction des tactiques de pouvoir qui sont immanentes à ce discours. »
En reprenant (tiré de la partie suivante, car la reprise est presque toujours plus éclairante – à condition d’avoir été tiré de l’obscurité par le raisonnement qui nous paraît du coup moins clair), « sous la grande série des oppositions binaires (corps-âme, chair-esprit, instinct-raison, pulsions-conscience) qui semblaient renvoyer le sexe à une pure mécanique sans raison, l’Occident est parvenu […] à nous faire passer presque tout entier –nous, notre corps, notre âme, notre individualité, notre histoire- sous le signe d’une logique de la concupiscence et du désir. »
Et là, nouveau coup de baguette accompagnée de la rituelle formule magique qu’est la question rhétorique : la scientia sexualis ne fonctionnerait-elle pas comme une ars erotica, s’il est vrai que l’on prend du plaisir à la vérité sur le plaisir ? à moins que les plaisirs ne soient que les sous-produits d’une science sexuelle. Dans un cas comme dans l’autre, exit la thèse de la répression : c’est le retournement qui permet de préparer le grand écart vers l’étude des mécanismes du pouvoir. Car la question ne sera pas de savoir pourquoi le sexe est secret, mais pourquoi cette grande chasse à la vérité du sexe.
IV Le dispositif de sexualité
1)Enjeu (en selle pour la conquête du pouvoir)
En fait, que le sexe n’est pas réprimé n’est pas une assertion nouvelle, nous précise Foucault. Alors quoi, pourquoi nous en avoir rebattu les oreilles ? Vous ne trouvez pas ? ce n’était pas pour les bonnes raisons (les philosophes s’affrontent à coup de meilleures raisons qui ne sont pas toujours bonnes, un peu comme deux enfants qui renchériraient à coup de « parce que » de plus en plus sonores). Que l’on imagine le désir comme étant réprimé par le pouvoir ou comme étant constitué par la loi et le manque qu’elle instaure, la représentation du pouvoir est la même, tournant autour de ces traits principaux :
–La relation négative. « Le pouvoir ne « peut » rien sur le sexe et les plaisirs, sauf à leur dire non »
–L’instance de la règle. La prise de pouvoir sur le sexe se fait par le langage sous le mode « juridico-discursif » : la loi l’articule autour du licite et de l’illicite.
–Le cycle de l’interdit qui joue sur deux inexistences et fait en sorte que le sexe renonce à lui-même sous peine d’être supprimé (suicide-toi ou c’est moi qui t’égorge, en gros – on se croirait presque dans un péplum gorgé d’honneur latin)
–La logique de la censure, qui prend trois formes : « affirmer que ça n’est pas permis, empêcher que ça soit dit, nier que ça existe » (et on finit en réécrivant les archives de journaux) qui s’articulent ainsi : « de ce qui est interdit, on ne doit pas parler jusqu’à ce qu’il soit annulé dans le réel ; ce qui est inexistant n’a droit à aucune manifestation, même dans l’ordre de la parole qui énonce son inexistence ».
–L’unité du dispositif, ayant une forme juridique à tous les niveaux
Si l’on accepte cette représentation du pouvoir, c’est qu’elle nous le rend tolérable, en ce qu’elle permet de penser que nous conservons une part intacte de notre liberté – puisque le pouvoir ne fait que limiter. Cette perception historique ne permet pas de penser les « nouveaux procédés de pouvoir qui fonctionnent non pas au droit mais à la technique, non pas à la loi mais à la normalisation, non pas au châtiment mais au contrôle ».
Rien ne sert donc de s’escrimer sur la nature du désir si l’on ne sort pas d’une conception juridique du pouvoir. Le sujet initial devient alors exemple, « qu’on ne peut pas manquer de considérer comme privilégié, puisque là, mieux que partout ailleurs, le pouvoir semblait fonctionner comme interdit ». Si on montre que tel n’est pas le cas, c’est gagné. On se retrouve alors avec une quatrième partie sur ce qu’est le pouvoir. On aurait pourtant du se méfier en croisant la phrase qui suit et qui sous couvert de garantir plus pleinement son argument, s’éloigne du sujet : « N’imaginons pas, du reste, que cette représentation soit propre à ceux qui posent le problème des rapports du pouvoir au sexe ». Avouez, vous l’imaginiez. Merci bien, l’auteur vous en est gré.
En vous faisant croire que vous pourriez trouver quelques anecdotes hard, Foucault vous entraîne dans un raisonnement ardu ; le sexe devient prét
exte, et l’auteur de Surveiller et punir retrouve sa marotte. Il est entré dans le lieu du divertissement pour vous convertir à sa thèse du pouvoir. Vous n’y pouvez mais, vous êtes embarqués.
2)Méthode (visiblement Descartes en a traumatisé quelques-uns)
Par pouvoir, Foucault n’entend pas « le Pouvoir », tel que les institutions d’un Etat le forment, mais la multiplicité des rapports de force d’autant plus excitants pour le philosophe qu’ils ne cessent de se reconfigurer (je ne vous raconte pas le nombre d’appositions dans ces pages, on sent qu’il s’éclate). « Omniprésence du pouvoir : non point parce qu’il aurait le privilège de tout regrouper sous son invincible unité, mais parce qu’il se produit à chaque instant, en tout point, ou plutôt dans toute relation d’un point à un autre ». Et the pouvoir, n’est rien que l’enchaînement qui prend appui sur chacune de ces relations de pouvoir mobiles et cherche en retour à les fixer.
La question de savoir pourquoi le pouvoir aurait besoin d’instituer un savoir du sexe tombe en même temps que the pouvoir. Il s’agit de voir quels sont les rapports de force à l’œuvre dans tel ou tel discours sur le sexe.
Et là, pas de baguette magique, mais après en avoir tant parlé, Foucault se fait plaisir avec quatre règles (la trinité cartésienne en somme) qu’il se propose de suivre – pas même comme règles mais impératifs de prudence. Je vois épargne la répétition générale, à part ce morceau d’improvisation :
Les discours sur le sexe ne sont pas forcément l’expression du pouvoir (the pouvoir), ils sont eux-mêmes pouvoirs (et donc pas nécessairement du côté de the pouvoir non plus). Surtout, avec un peu de recyclage (c’est tendance), un même discours peut aller dans des sens contraires. Exemple de la sodomie, d’abord entourée d’un silence qui a permis une extrême sévérité dans la répression et une tolérance assez large : l’apparition de discours faisant passer l’homosexuel d’adjectif à nom (une espèce) a permis une forte avancée des contrôles sociaux, mais également la constitution d’un discours en retour par les principaux intéressés, qui utilisent les mêmes termes pour parler d’eux. (On retrouve ici le problème que pour réfuter une chose, il faut la nommer – d’où risque de glissement. C’est ce qu’on avait vu en histoire sur la montée de l’antisémitisme autour de l’affaire Dreyfus, et qui fonctionne pour tout racisme).
3) Domaine
A partir du XVIII° se définissent quatre grands ensembles stratégiques :
– Hystérisation du corps de la femme, intégralement saturé de sexualité par sa mise en communication organique avec le corps social (poule pondeuse pour la patrie), l’espace familial et la vie des enfants : « la Mère, avec son image en négatif qui est la « femme nerveuse », constitue la forme la plus visible de cette hystérisation.
– Pédagogisation du sexe de l’enfant (word souligne, je me disait bien aussi que ça devait être un mot forgé), « en deça du sexe et déjà en lui » : prise en charge de « ce germe sexuel précieux et périlleux » (puisqu’il faut bien faire le coq gaullois d’une part, et qu’on pensait que l’onanisme avait des effets stérilisateurs ou déclencheur de tout en tas de maladies sympathiques).
– Socialisation des conduites procréatrices, économique (incitation ou frein par des mesures fiscales par exemple), politique (problèmes démographiques), médicale (valeur pathogène du sexe)
– Psychiatrisation du plaisir pervers
Il s’agirait moins d’une lutte contre la sexualité ou d’un effort pour en prendre le contrôle, que de sa production même. La sexualité ne serait pas une réalité d’en dessous sur laquelle on tâcherait d’exercer des prises, mais un réseau de surface où s’enchaîneraient l’ensemble des phénomènes et des discours. Comme ça, c’est un brin abstrait, mais ça devient plus intéressant juste après.
Les relations de sexe ont donné lieu dans toutes les sociétés à des dispositifs d’alliance (mariage, transmission des noms et des biens). Au XVIII° les sociétés occidentales ont inventé un dispositif de sexualité qui s’est greffé sur ce dispositif d’alliance et a contribué à en réduire l’importance. Tandis que le dispositif d’alliance a pour objectif de reproduire le jeu des relations sociales (temps fort de la « reproduction »), de maintenir la loi qui les régit, et qu’il entretient des liens privilégiés avec le droit, le dispositif de sexualité engendre une extension des domaines et des formes du pouvoir, est lié à des dispositifs récents de pouvoir et n’est pas ordonné à la reproduction puisqu’il a été lié dès l’origine à une intensification des corps.
Au carrefour des deux dispositifs, la famille : « elle transporte la loi et la dimension du juridique dans le dispositif de sexualité ; et elle transporte l’économie du plaisir et l’intensité des sensations dans le régime de l’alliance. »
« Cet épinglage du dispositif d’alliance et du dispositif de sexualité » permettrait de comprendre que la famille soit devenue un lieu d’affects obligé. Il se peut bien que l’interdit de l’inceste soit indispensable dans une société au dispositif d’alliance ; il l’est d’autant plus dans une société comprenant également le dispositif de sexualité. L’inceste occuperait là une place centrale, sans cesse sollicité et refusé : requis pour que la famille soit un « foyer d’incitation permanente de la sexualité » et interdit pour autant que la famille joue comme dispositif d’alliance. L’interdit de l’inceste revêtirait alors la fonction « de se défendre, non point contre un désir incestueux, mais contre l’extension et les implications de ce dispositif de sexualité qu’on avait mis en place mais dont l’inconvénient […] était d’ignorer les lois et les formes juridiques de l’alliance. » Il garantit que le dispositif de sexualité n’échapperait pas à celui de l’alliance en le recodant dans les formes du droit – et la sexualité paraît avoir été de tous temps placée sous le signe de la loi et du droit.
Le dispositif de sexualité, qui s’était développé dans les marges de la famille, va alors peu à peu s’y recentrer ; si bien que la famille « semble diffuser une sexualité qu’en fait elle réfléchit et diffracte. » Et lorsque les psychanalystes vont vouloir séparer les malades de leur famille pour détacher du système d’alliance le domaine de la sexualité et le traiter directement, ils retrouvent « au cœur même de cette sexualité, comme principe de sa formation et chiffre de son intelligibilité, la loi de l’alliance. » (qu’on songe seulement au complexe d’Oedipe). Alors que le dispositif de sexualité a pris naissance en s’appuyant sur le dispositif d’alliance et en investissant le cadre de la famille, un renversement s’opère, et c’est aujourd’hui lui
qui tend à soutenir le dispositif d’alliance.
4) Périodisation
Chronologie de l’invention des techniques (de pouvoir du dispositif de sexualité) : vers le milieu du XVI°, développement des procédures de direction et d’examen de conscience ; au début du XIX°, apparition des technologies médicales du sexe : relative autonomisation du sexe par rapport au corps avec la création d’une médecine des perversions et la multiplication des programmes d’eugénisme. On plaçait en effet le sexe « en position de ‘responsabilité biologique’ par rapport à l’espèce », à cause de ses propres maladies comme des celles qu’ils pouvaient transmettre ou créer aux générations futures, la perversion étant liée à l’hérédité par le biais de l’idée de « dégénérescence ». La psychanalyse s’est posée en rupture avec cette assimilation en détachant le projet de technique médicale des corrélations avec l’hérédité (avec Freud, on peut être un brin misogyne, mais plus raciste)
A partir du XIX° donc, le sexe devient ‘affaire d’Etat’, il s’ordonne « à l’institution médicale, à l’exigence de normalité, et plutôt qu’à la question de la mort et du châtiment éternel, au problème de la vie et de la maladie. »
Chronologie de diffusion et d’application de ces techniques
Elle ne s’est pas faite du bas vers le haut de la société, comme le laisserait penser l’hypothèse répressive (tenir en main la force de travail), mais, notamment en raison de la subtilité de certains procédés (examen de conscience scrupuleux par exemple), a d’abord été appliquée dans les classes économiques privilégiés et politiquement dirigeantes. La famille comme instance de contrôle et point de saturation sexuelle, c’est la famille bourgeoise ou aristocratique. Les couches populaires, également prises dans le dispositif d’alliance, ont longtemps échappé au dispositif de la sexualité, qui ne s’est implanté que peu à peu relativement à des problèmes de natalité (on découvre que ceux qui sont proches de la nature pratiquent également les techniques visant à éviter la reproduction lapine), de régulation du prolétariat urbain, et de protection de la société et de la ‘race’.
Dans la mise en place du dispositif de sexualité, il faut « soupçonner l’autoaffirmation d’une classe, plutôt que l’asservissement d’une autre ». La problématisation de la santé et l’intensification des corps est pour la bourgeoisie moyen de « maximaliser la vie ». La bourgeoisie s’est employée « à se donner une sexualité et à se constituer à partir d’elle un corps spécifique, un corps « de classe » avec une santé une hygiène, une descendance, une race ». Histoire de dire qu’ils n’ont pas gardé les cochons ensemble (voire n’en ont jamais vu).
On a là la transposition « des procédés utilisés par la noblesse pour marquer et maintenir sa distinction de caste », seulement là où le sang indiquait l’importance accordée à l’ancienneté des ascendances (valeur de l’alliance), la bourgeoisie se tourne du côté de sa descendance, avec comme indice le souci de son organisme. Il s’agit d’une nouvelle forme de racisme social, qui n’est plus conservatrice (conserver pure la fraction de sang noble) mais dynamique (s’accroître en une expansion indéfinie de vie).
Puisque c’est par la sexualité que la bourgeoisie se distinguait, elle a renâclé à la reconnaître aux classes laborieuses. Pour cela, il a fallu des conflits autour de l’espace urbain, des urgences économiques et la mise en place d’instances de contrôle (c’est comme de donner de l’argent aux associations caritatives, on veut être savoir où il va). Le prolétariat a mis du temps à accepter cette sexualité bavarde dans la mesure où elle lui était imposée à des fins d’assujettisement.
Seulement, une fois que tout le monde est logé a la même enseigne niveau sexe, la bourgeoisie doit se montrer assez retorse pour trouver un nouveau signe distinctif. Esprit de contradiction es-tu là ? Très certainement, ce sera la décence et la pruderie la plus ostentatoire. La ligne entre Monsieur Mâdame et le bas peuple « ne sera plus celle qui instaure la sexualité, mais une ligne qui au contraire la barre ». « La théorie de la répression, qui va peu à peu recouvrir tout le dispositif de sexualité et lui donner le sens d’un interdit général, a là son point d’origine. »
Comme la bourgeoisie est assez folle pour le devenir sans l’être au point de le vouloir (devenir folle), elle prend un joker, le fou du sexe (mais roi dans le présent ouvrage), j’ai nommé Freud. La psychanalyse arrive en effet pour lever les effets de l’interdit là où sa rigueur le rendait pathogène, et chez les individus qui sont en position d’avoir recours à elle. Ca refoule, cette stratégie fumante ! De là qu’ « à l’époque où l’inceste est pourchassé comme conduite d’un côté, ed l’autre, la psychanalyse s’emploie à le mettre au jour comme désir ». « Le père, d’un côté, était érigé en objet d’amour obligé ; mais ailleurs, s’il était amant, il était déchu par la loi ».
Cette bourgeoisie retorse a donc opéré un déplacement tactique considérable : le dispositif de sexualité peut être réinterprété en termes de répression généralisée. Et le succès même de la critique envers la répression « est liée au fait qu’elle se déployait toujours dan le dispositif de sexualité, et non pas hors de lui ou contre lui. » Et Foucault d’avancer comme preuve par l’absurde que les comportements sexuels ont bien changé sans que la sonore répression du sexe ait été moins dénoncée. L’hypothèse répressive est donc rétroactive, prise dans la trame même du dispositif de sexualité et ne saurait fournir le principe d’un mouvement pour démanteler la répression.
Je trouve ça dingue ces renversements. Ca me rend dingue. Ce n’est pas que cela vous fasse perdre vos repères, non, c’est que ces repères donnent prise à tout autre chose, ils changent de configuration. Et l’on découvre que ce qu’on pensait aller de soi est en fait historiquement déterminé, un simple point de vue que l’on croyait pourtant inamovible et depuis lequel on avait relu le passé, comme on aurait embrassé une vallée depuis les hauteurs sans soupçonner que depuis la vallée on puisse avoir une toute autre vue, et ne pas même ce soucier des hauteurs. Ce genre de renversement tout à la fois nous montre ce dans quoi l’on est pris, et dans le même temps nous en arrache – par une prise de distance brutale car radicale et immédiate, un zoom out. Parfaitement exprimé par la formule de quatrième de couverture d’un bouquin sur le visage de Raphaël Enthoven qui nous propose d’ « approcher le visage d’un peu plus loin ».
V Droit de mort et pouvoir sur la vie
<
p class="MsoNormal">
(même mouvement que dans la partie précédente : on part du pouvoir pour retomber sur ses pattes le sexe. Chat alors !)
Le droit de vie et de mort qu’avait le père romain sur ses enfants se retrouve chez le souverain, atténué cependant en ce qu’il est limité aux cas où la vie du souverain est menacée. Ce pouvoir se comprend par la négative car il est par nature limitatif : « il ne marque son pouvoir sur la vie que par la mort qu’il est en mesure d’exiger ». C’est « en fait le droit de faire mourir ou de laisser vivre ». Pas un droit pleinement positif, donc.
Cela se transforme à l’époque classique avec l’apparition d’un « pouvoir destiné à produire des forces, à les faire croître et à les ordonner ». Pouvoir direct sur la vie tandis que la mort « qui si fondait sur le droit du souverain de se défendre ou de demander qu’on le défende, va apparaître comme le simple envers du droit pour le corps social d’assurer sa vie, de la maintenir ou de la développer. »
« On pourrait dire qu’au vieux droit de faire mourir ou de laisser vivre s’est substitué un pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort. » Le pouvoir établit ses prises sur la vie, et la mort en marque la limite ( de la vie mais aussi du pouvoir, alors que ce dernier avait auparavant prise par la menace de mort). « C’est la prise en charge de la vie, plus que la menace de meurtre, qui donne au pouvoir son accès jusqu’au corps. »
Ce pouvoir s’est développé depuis le sous deux formes, investissant au XVII° le corps comme machine et au XVIII° le corps-espèce, support des processus biologiques. A ce « bio-pouvoir » (merci de ne pas visualiser un maïs géant armé d’une kalachnikov), il a fallu « des méthodes de pouvoir susceptibles de majorer les forces, les aptitudes, la vie en général sans pour autant les rendre plus difficiles à assujettir. » On a alors l’entrée de la vie dans l’histoire en tant que champ des techniques politiques (jusque là les seuls rapports étaient de l’ordre d’une pression du biologique sur l’histoire à travers les épidémies et famines).
Une des conséquences du bio-pouvoir est l’importance croissante prise par la norme au détriment de la loi, dans la mesure où la loi fonctionne, au moins symboliquement, en référence à la menace absolue (de mort) tandis que la norme peut endosser une fonction régulatrice. La loi ne s’efface pas entièrement au profit de la norme, mais celle-là tend à fonctionner toujours davantage comme celle-ci, qui en retour s’approprie les formulations du droit (« droit » à la vie, à la santé, au bonheur etc.). « Une société normalisatrice est l’effet historique d’une technologie de pouvoir centrée sur la vie. »
Etant accès à la fois à la vie du corps et à la vie de l’espèce, « le sexe devient une cible centrale pour un pouvoir qui s’organise autour de la gestion de la vie plutôt que de la menace de la mort. » Il permet à la fois d’analyser et de dresser l’individualité.
Alors que dans les sociétés d’alliance, le sang est une réalité à fonction symbolique, dans les sociétés « à sexualité », « celle-ci n’est pas marque ou symbole, elle est objet et cible. » Les deux dispositifs ont connu des interférences dont deux notables :
–la thématique du sang a été appelée à vivifier et soutenir le pouvoir du dispositif de sexualité, donnant naissance à un racisme étatique qui culmine avec le nazisme
–l’effort pour réinscrire la sexualité dans l’ordre de la loi a été fait par le freudisme, en convoquant autour du désir tout l’ordre ancien du pouvoir.
C’est fin, c’est intelligent, mais… n’aurait-on pas perdu de vue le sujet ? Foucault pare à l’objection que « c’est parler de la sexualité comme si le sexe n’existait pas. » Je commençais à me demander s’il fallait que j’arrête de lire au soleil, parce que de ce « sexe » qui parsème le livre (et ma note du coup, je sens que je vais avoir des surprises dans les mots-clefs), je commençais à ne plus voir que le x, comme l’inconnue d’une équation à peine posée, ou plutôt étalée tout au long du texte (Quoique conséquent avec la cristallisation du mystère humain sur le sexe – x, le grand inconnu). Sexe, texte, ça finissait par devenir la même chose (en plein dans la nébuleux de la « sexualité », ce réseau de discours). Comme l’incompréhension (de même que le bovarysme) est une maladie textuellement transmissible, Foucault finit par nous venir en aide (enfin, pourrait-on dire ; mais Pascal vous rétorquerait que la dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage est de savoir celle qu’il faut mettre la première).
Le « sexe » ne serait pas la réalité au-dessus de laquelle on proférerait des discours, mais une idée historiquement formée à l’intérieur du dispositif de sexualité. Le flou définitionnel en est l’indice, puisque le sexe peut aussi bien être :
–ce qui est commun à l’homme et à la femme (m/f)
–ce qui appartient par excellence à l’homme et ferait défaut à la femme (membre viril)
–ce qui constitue à lui seul le corps de la femme (qu’on songe à l’expression de « le beau sexe », « le sexe faible » – mais alors cela devrait également s’appliquer à l’homme, avec en pendant (si j’ose dire) le « sexe fort »).
C’est le dispositif de sexualité qui met en place l’idée de « sexe », le situant au croisement de la fonction et de l’instinct, de l’absence et de la présence (ex, dans la sexualité des enfants, il est anatomiquement présent, mais absent relativement à sa finalité reproductrice).
La notion de « sexe » a permis de regrouper « des éléments anatomiques, des fonctions biologiques, des conduites, des sensations, des plaisirs » et de faire un principe de cette unité fictive, qui a reçu de son voisinage avec la science une garantie de quasi-scientificité. Ainsi constituée, elle permet d’inverser la représentation du pouvoir et de faire apparaître la sexualité comme une instance autonome que le pouvoir cherche à réprimer, et non dans sa relative essentielle et positive au pouvoir. L’idée du « sexe » permet d’esquiver ce qui fait le pouvoir (à entendre comme verbe sous peine de devoir le doubler en « pouvoir du pouvoir »). Cela a suscité un des principes de fonctionnement les plus essentiels au dispositif de sexualité : le désir du sexe, de l’articuler en discours. « C’est cette désirabilité qui nous fait croire que nous affirmons contre tout pouvoir les droits de notre sexe, alors qu’elle nous attache en fait au dispositif de sexualité ». « Ironie de ce dispositif : il nous fait croire qu’il y va de notre ‘libération’. »
Comment en sort-on alors ? – car c’est toujours la question que
l’on se pose alors ; personne ne veut être le dindon de la farce, surtout lorsqu’il sait à quelle sauce il va être mangé. Il faudrait s’affranchir de l’instance du sexe, et non chercher à le libérer puisque ce discours l’enferme toujours dans la sphère du pouvoir (et là, je ne peux pas m’empêcher de penser à tous ces magasines féminins qui affichent en grande police « sexe » sur la couverture, en croyant délicieusement à la provocation).
Petite intuition douteuse (quoique nébuleuse) : Foucault ne participerait-il pas aussi à l’entretient du « sexe-désir » ? Ou le récupère-t-il pour le convertir en critique lucide ? A prendre le contre-pied de l’hypothèse répressive, il finirait bien par prendre son pied. Il pourrait bien y avoir du plaisir à décortiquer de façon critique le processus de plaisir pervers à parler des plaisirs.
« contre le dispositif de sexualité, le point d’appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe-désir, mais les corps et les plaisirs. »
La ferme et tous au plumard !
(une chanson douce pour s’endormir, tout de même : Je veux, d’Alex Beaupain )