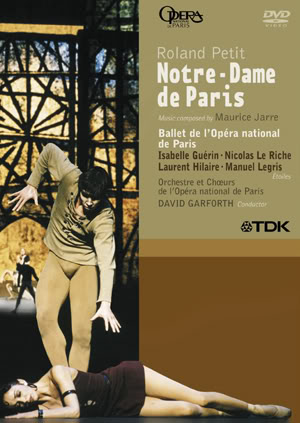Quatre août, quatre yeux glauques aperçoivent le 5 affiché sur le réveil, sous des paupières qui, sans allumettes pour tuteur, ont du mal à ne pas se refermer. Quarante-cinq minutes plus tard, Palpatine, nos valises et moi partons à l’aéroport, en traînant la fin d’un paquet de petits pains au lait comme un doudou lapin par l’oreille. On les a tartinés de confiture d’abricot la veille au soir, anticipant sans le savoir le motif de la Marille. L’abricot n’est pas tout à fait à l’Autriche ce que la myrtille est aux Etats-Unis, mais il n’empêche qu’on en trouve une fine couche dans une de ses pâtisseries les plus célèbres. La Sachertorte, dégustée comme il se doit dans son salon d’origine, est beaucoup plus légère que je n’en avais le souvenir.

Même avec la Schlag à côté dans l’assiette et au-dessus du chocolat chaud. Pour la peine, j’ai pris un Apfelstrudel en plus. Je me serais bien lancée dans une étude comparative de ce gâteau aux pommes dans tous les salons de thé de la capitale, n’était cette déconvenue de taille : l’absence de cannelle, déjà constatée la veille chez Demel. L’espèce de frangipane dont était fourré celui de chez Sacher m’a définitivement coupée dans mon élan.

Cela est terrible, j’en conviens, mais ne perdez pas espoir, le chocolat viennois reste une valeur sûre. A condition de bien prononcer le ‘h’ et le ‘e’ de « heiße Schokolade » sous peine de se retrouver déconfits, comme cela nous est arrivé à la Gloriette, avec un chocolat glacé, « Eisschokolade ». Notre erreur a profité à une serveuse qui s’est mise à la paille, dos au comptoir ; le serveur a été compréhensif, et nous a servi la version plus adaptée à la température rafraîchie, avec un petit cours de prononciation. Comme j’y entends à peu près autant de différence qu’entre « brin » et « brun », j’ai opté par la suite pour un « hot chocolate » non équivoque. Ou même plus, d’ailleurs, parce que je me suis rabattue sur les grosses glaces italiennes de la Swhwedenplatz, la place suisse étant en toute bonne logique dépourvue de chocolat et bordée d’Italiens, glaces et pizzas. De toutes manières, le meilleur chocolat de Vienne était sans conteste celui de chez Demel, même s’il n’y a que sa chantilly viennoise qui le sauve de la comparaison avec celui de chez Dalloyau.


La cuisine est peut-être mon talon d’Achille chauvin, allez savoir. J’ai bien dédaigné de goûter la Schnitzel, l’escalope panée me semblant de peu d’intérêt. La Wurst plaisait davantage à la grande saucisse que je suis, mais comme elle effrayait démesurément mon coéquipier, je n’en ai mangé qu’au petit-déjeuner, et sans curry encore. Encore heureux, dirait Palpatine, qui ne comprend pas que des beans puissent remplacer les tartines dans l’assiette matinale (pourtant, avec les œufs brouillés et les pommes de terre paillasson qui les ont complété à Londres, c’était un régal). Je ne suis peut-être pas aventurière lorsqu’il s’agit de s’enfoncer dans le nowhere d’une banlieue (je suis une petite bourgeoise en vacances, j’assume), mais je mets les pieds et les mains dans le plat. Ce qui ne m’empêche nullement de reconnaître que le restaurant japonais où nous a conduit mon envie d’ « orgie de sushis » (Miss Red, en texto dans le texte) était une tuerie. Nous y sommes retournés pour parfaire le massacre de poissons ; tot, rot, gut.