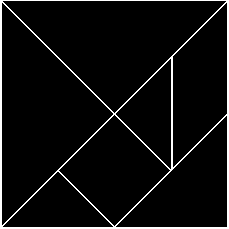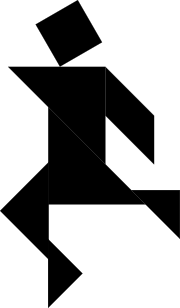Après une semi-éternité pour retrouver les vidéos présentées ou des équivalents, voici le compte-rendu de la conférence de Sonia Schoonejans au théâtre de la Ville. À l’exception du premier paragraphe, tous les liens renvoient à des vidéos : faites péter les onglets et entrez dans la danse !
Identité, altérité, complémentarité
Une caractéristique essentielle de la danse est que le corps est présent. Son hic et nunc, qui fait partie de sa beauté, la différencie de l’image cinématographique, reproductible à loisir (tous en chœur : Walter Benjamin !). Mais danse et cinéma ont aussi nombre points communs, à commencer par le souci du rythme (du montage) et du mouvement (de la caméra), et chacun des deux arts a emprunté à l’autre.
Pour le cinéma, la danse s’offre comme alternative au texte, qu’il s’agisse de faire passer une émotion ou de prendre le relai de la narration (en incarnant la musique dans les comédies musicales, notamment). Pour la danse, le film est à la fois un outil pour conserver sa mémoire (cf. Pina de Wim Wenders) et accroître sa popularité (cf. les comédies musicales – et l’initiative récente des lives au cinéma, j’aurais envie d’ajouter). Filmée, la danse prend une nouvelle dimension s’il est vrai que « grâce au gros plan, c’est l’espace qui s’élargit ; grâce au ralenti, c’est le mouvement qui prend de nouvelles dimensions1 » (j’ai tout de suite pensé à ce clip de Polina Semionova). En retour, certains chorégraphes ont adopté des méthodes propres au montage : il y a chez Pina Bausch un travail qui ressemble au découpage cinématographique et Maguy Marin utilise des noirs entre ses tableaux (je vais croire Sonia sur parole parce que d’après JoPrincesse, ce n’était pas beau à voir).
Partant de cette mini-analyse introductive, Sonia Schoonejans nous a brossé un petit historique des relations entre les deux arts, en une heure trente et quelques extraits vidéos.
Les débuts du cinéma
Les pionniers du cinéma avaient en commun une passion pour le mouvement. Loïe Fuller et ses imitatrices ont été parmi les premiers sujets filmés par Edison et les frères Lumière – il faut dire que les danses serpentines rendent plutôt pas mal à l’écran. Cet attrait du mouvement a conduit à la constitution d’archives pour les danses traditionnelles, dont certaines ont aujourd’hui disparu. On compte dans le lot le premier documentaire sur la danse classique mais ce n’est pas le kiff du cinéma, qui se veut à ses débuts un art de l’image qui danse autant que sa mise en scène. C’est sûr que si on prend l’esthétique du Cake-walk infernal de Méliès (1903) comme référence…
Le cinéma muet et la danse moderne
L’accointance du cinéma et de la danse moderne s’explique aussi par leur apparition concomitante. La Denishawn, l’école de Ruth Saint Denis et Ted Shawn (d’où sont sortis Martha Graham, Charles Weidman, Doris Humphrey, José Limon et Louise Brooks – la danse moderne américaine, quoi), n’est pas bien loin des premiers studios de Hollywood. Le lien s’établit à partir du moment où Griffith en devient l’un des principaux réalisateurs. Ruth Saint Denis exerce un rôle de conseil et la collaboration danse moderne-cinéma devient intense, alors qu’à la même période, l’univers du ballet reste lointain. On n’a par exemple aucun film documentaire (d’époque, s’entend) sur Diaghilev, qui se méfiait de la caméra et a toujours refusé qu’elle entre au théâtre. Le refus pourrait être motivé par le boucan de la machine et le problème de post-synchronisation de la musique et de la danse.
À la même époque, le muet n’empêche pas les cinéastes allemands ou d’origine allemande (comme Ernst Lubitsch) de tourner des scènes de danse. Fritz Lang fait ainsi danser une cabarettiste dans Le Docteur Mabuse (1922) et j’imagine qu’il y a aussi une scène de danse dans La Rue sans joie (1925) de Georg Wilhelm Pabst pour qu’il soit cité. Ce qui est certain, en revanche, c’est que sa Loulou (1929) est jouée par Louise Brooks, ancienne élève de la Denishawn passée par les Ziegfeld Follies. L’apprentissage de la danse donne une manière de bouger que n’ont pas les autres. Beaucoup de danseurs, de mimes et d’acrobates participent au cinéma muet, qui est un cinéma physique dans lequel les comédiens traditionnels ont plus de mal. Le cinéma burlesque, notamment, use de tout le langage du corps, lequel se trouve en constat déséquilibre chez Buster Keaton. Quant à Charlie Chaplin, il arrive même à danser assis dans The Gold Rush (1925). Il paraît que Cooks comporte une parodie de la danse de Salomé, où la tête de Jean-Baptiste est remplacée par un chou-fleur, mais à défaut de le trouver, vous aurez l’extrait passé lors de la conférence.
Tout cela a un petit côté Mickey Mouse, vous ne trouvez pas ?
L’âge d’or des comédies musicales
Le passage au parlant ne se fait pas sans résistances (et la poésie du geste, alors ?) mais comment résister aux jambes de Cyd Charisse et aux envolées de Fred Astaire ? Adaptant les comédies musicales à succès de Broadway, Hollywood met en place son usine à rêve. Danse et musique sont alors le sujet du film, le moyen de faire avancer l’action ou une simple ornementation au goût du jour. Les chorégraphes sont invités à venir travailler à Hollywood. La balletomane pense rapidement à Jérôme Robbins pour West Side Story (1957 au théâtre, 1961 au cinéma) mais il s’avère que Balanchine également a travaillé pour les comédies musicales et le cinéma, fait que j’ignorais complètement. Les parcours sont assez variés, certains danseurs ou chorégraphes passant même à la réalisation.
C’est le cas de Busby Berkeley (années 1930-1960) qui, de son séjour parmi les militaires, retient les alignements et réalise de véritables kaléidoscopes humains. Quelque chose de nouveau arrive avec lui : la caméra, mouvante, rentre dans la danse avec dans vues aériennes plongeant sur des grappes de filles. Décors, plateaux tournants à différents niveaux et miroirs démultiplient les effets, de sorte que le point central n’est plus le corps des danseurs mais l’œil de la caméra et donc du public. Je ne connaissais pas et dois dire que c’est assez impressionnant.
Fred Astaire, au contraire, souhaite replacer la danse au centre, qu’elle ne soit pas un simple motif mais fasse avancer l’action. Sa seule exigence est donc de décider où placer la caméra dans les scènes de danse, de manière à ce qu’elle soit le moins mouvante possible et ne prenne pas le premier rôle.
Pour une caméra dansante, il faudra attendre un peu et aller voir du côté de Bob Fosse avec All that jazz (1979) ou Sweet Charity (1969), le film à l’origine de la comédie musicale (bouclant la boucle de l’inspiration).
Et, pour le plaisir du who’s who…
Gene Kelly est à Fred Astaire ce que Fanny Elssler est à Marie Taglioni. À la danse aérienne de Fred Astaire, il oppose une danse plus athlétique, plus sportive, ancrée dans le sol – ce qui n’empêche aucunement la poésie, comme vous pouvez le vérifier dans cette séquence de Cover girl (1944), où il danse en duo avec… lui-même.
Jack Cole, ex-élève de la Denishawn, est considéré comme le père de la danse jazz à Broadway. Si, comme moi, vous croyez ne pas le connaître, sachez qu’il a chorégraphié l’apparition de Rita Hayworth dans Gilda (1946) et Diamonds are a girl’s best friend (1953) pour Marilyn Monroe.
Dans la catégorie des célèbres inconnus, nous avons également Marc Breaux et Dee Dee Wood, travaillant en couple pour Mary Poppins ou La Mélodie du bonheur. Les balletomanes retiendront le nom de Herbert David Ross, entre autres acteur, chorégraphe et mari d’une étoile de l’ABT, comme le réalisateur de The Turning point (1977 ), dans lequel danse Baryshnikov. Après avoir vu le trailer, qui vend du rêve, vous pourrez vous rincer l’œil avec White Nights.
Et après ?
Dans les années 1960-1970, l’épopée de la comédie musicale semble se terminer. En 1979, Miloš Forman adapte la comédie musicale Hair mais l’usine à rêve à vécu : le ton est plus désabusé, désenchanté ; la télévision commence à concurrencer le ciné… Cela n’empêche pas le genre d’être un succès de temps à autres : Saturday Night Fever en 1977, Grease en 1978, et, plus récemment, Moulin rouge (2001) ou Nine (2009). En France, le genre n’a jamais vraiment pris, à l’exception notable de Jacques Demy qui revisite avec tendresse la comédie musicale (Les Parapluies de Cherbourg, 1964 ; Les Demoiselles de Rochefort, 1967).
Pour trouver de la danse au cinéma, il faut soit se tourner vers d’autres genres soit vers d’autres horizons. Par exemple, on observera dans les westerns comment la danse des Indiens évolue du signe de sauvagerie à celui d’une culture propre (cf. Danse avec les loups, 1990). Puis pour un nouveau shoot de comédie musicale façon clip, direction Bollywood. Les studios sont plus vieux qu’on ne le croit : le premier film, muet, sort en 1913 ! La tradition indienne liant chants, danse et musique, c’est tout naturellement que le pays est venu à la comédie musicale, agrégeant toutes les modes à la danse indienne proprement dite, dans un melting-pot chorégraphique joyeusement kitsch. La censure de toute scène à caractère sexuel a pas mal encouragé le recours aux scènes dansées, qui font passer beaucoup de choses sur un mode onirique (c’est pas moi, c’est moi inconscient, d’abord). L’importance de ces scènes est telle qu’elles sont filmées par une équipe spéciale et les chorégraphes-réalisateurs sont en Inde de véritables vedettes. Et puis, moins connu que Bollywood : Hollywood on the Nil. Le cinéma égyptien s’est lui aussi frotté à la comédie musicale dans les années 1940-1960.
Tout une gamme d’émotions
C’est la partie thématique que Sonia Schoonejans n’a pas vraiment eu le temps d’aborder, à cause d’un quiproquo avec la salle et l’équipe technique – en fait de deux heures, il n’y avait qu’une heure et demie de prévue (ça craint un peu quand la conférencière a vingt-cinq minutes d’extraits à montrer à un public qui a payé sa place – peu cher, certes mais tout de même, c’est dommage). Les pistes données à toutes vitesse comportent, en vrac : la scène de bal de Fisher King où la danse est une métaphore du coup de foudre (les Jane Austiniennes et les fans de comédies sentimentales trouveront pleins d’autres scènes de bal très pertinentes, je n’en doute pas) ; Le Bal, d’Ettore Scola, où la danse se fait le miroir d’époques successives à travers un dancing du Front populaire aux années 1980 ; On achève bien les chevaux, où une certaine violence sociale prend corps ; Pulp Fiction, où la danse est le signal d’une violence physique à venir. Dans la débandade de la prise de notes, j’ai pris le temps de me faire un warning : Charles Atlas à éviter absolument. On ne sait jamais, ça peut toujours servir.
Sur ce, je vous laisse vous perdre dans les méandres de Wikipédia et YouTube. N’hésitez pas à poster les perles que vous trouverez, à l’image de cette rencontre improbable entre Méliès et le gangnam style.