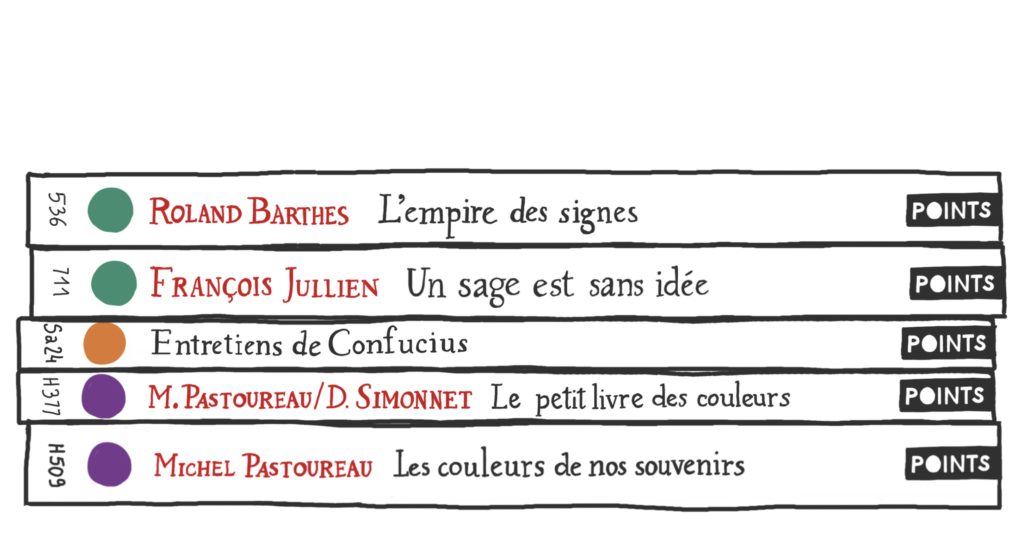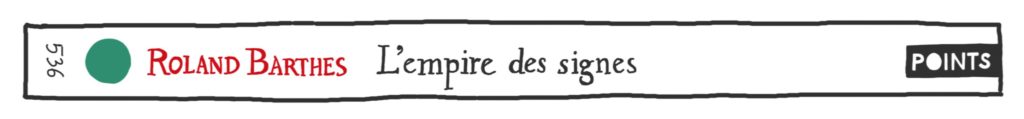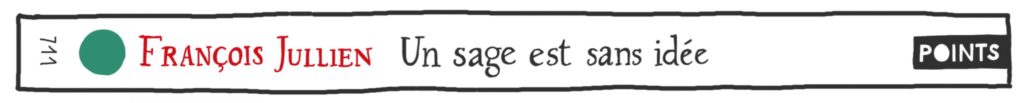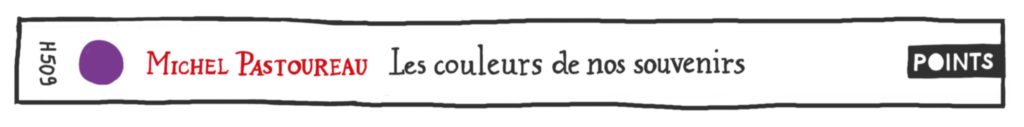Depuis que j’ai croisé une fois la roue des émotions, sans rien chercher à connaître de Robert Plutchik, son créateur, je me demande s’il vaut mieux chercher à vivre au centre de la roue pour éprouver des joies vives (quitte à éprouver plus intensément d’autres émotions négatives) ou s’attarder sur les pétales pâles, moins vivaces mais aussi moins violents. Peut-être qu’en s’ouvrant à plus subtil, en devenant perméable à trois fois fois, on ne vit pas moins intensément, juste autrement, de manière plus sereine ? À moins que les pétales ne fanent plus vite et ne nous lassent par leur fadeur.
Cette tension du fade au savoureux, François Jullien l’a explorée dans un Éloge de la fadeur qui s’éloigne des intensités toutes occidentales pour aborder cette absence de saveur marquée, louée tant du point de vue moral qu’esthétique dans la pensée chinoise. J’ai lu un peu trop vite, probablement, n’étant pas d’humeur à l’érudition philosophique et littéraire pourtant mise en marge par le philosophe (littéralement : les auteurs, siècles et notions-clés sont inscrites dans de larges marges). Je voulais ma réponse à la roue.
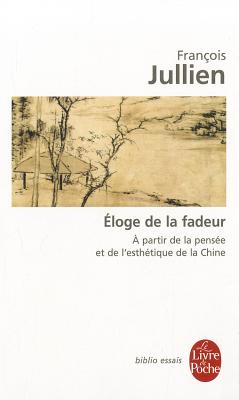
En gros, la fadeur est prisée par la pensée chinoise en tant que saveur qui contient virtuellement toutes les autres. Si on a un peu trop fréquenté Aristote et compagnie, on pourrait être tenté d’assimiler cette fadeur à un substrat en attente de prédicats, mais que nenni, nous explique notre guide, la fadeur n’est pas un concept, pas même une abstraction. La fadeur, c’est du concret, c’est du sensible. Elle est savoureuse, même si c’est le degré zéro de la saveur.
J’avoue, j’étais un peu perplexe. Il a fallu une histoire de sage qui goûte diverses eaux de source pour que ça fasse tilt. Je me suis souvenue de voyages dans des pays où l’eau du robinet est déconseillée, et des eaux embouteillées qu’on y trouve : au bout de quinze jours à boire cette horreur qu’est la Nestlé Aquarel ou des eaux déminéralisées que je pensais réservées aux fers à repasser, je suis prête à renier toutes mes convictions écologiques et à débourser une petite fortune pour une bouteille d’Evian. Là, voilà qui est bon, aucun arrière-goût, je peux étancher ma soif… de non-saveur. Une eau est meilleure si elle est neutre au palais : fade.
En somme, il faut que cela coule de source, même si l’on doit grimper deux heures dans la forêt pour la trouver. Dans l’art pictural, la fadeur favorise la circulation du regard ; rien ne l’accroche au point qu’il rechigne à se relancer… mais aussi, rien n’arrête ce mouvement perpétuel au sein du tableau ; ce n’est pas une image que l’on zappe. L’attitude qui l’accompagne ne relève pas du désintérêt, mais du détachement : sans se focaliser sur rien en particulier, on est prêt à tout considérer, à contempler l’harmonie.
Rien n’accapare l’attention, n’obnubile par sa présence, tout ce qui commence à prendre forme se retire et se transforme.
La fadeur est diffuse, elle infuse, fond sous la langue et sa saveur est d’autant plus prégnante qu’on ne l’a pas liquidée au premier coup d’œil, à la première bouchée ; elle met du temps à s’apprécier, mais n’en finit plus ensuite de captiver.
Un peu comme la danse classique, j’aurais envie de dire avec mes gros sabots de balletomane. Évidemment, la virtuosité réjouit par son intensité, mais ce qui pousse à retourner encore et encore voir le même ballet sur une même série, c’est bien l’interprétation, cet art de la variation, du même qui est encore autre, un poignet qui s’infléchit davantage, un regard qui s’attarde un peu moins, une attaque décalée… Moins un geste est techniquement marqué (plus il est fade ?), plus il laisse place à l’interprétation du danseur. Je l’ai constaté lors d’un concours de promotion où les sujets se suivaient dans une variation dramatique : rapidement, ce ne sont plus les arabesques ou les tours qui font la différence ; ce n’est plus aux difficultés techniques que l’on prête attention (comme on le ferait dans une épreuve sportive) mais aux transitions, aux entre-pas, à tout ce qui n’étant rien fait tout. La variation vue quatre, cinq, dix fois continue de déployer des richesses encore inouïes, in-vues, et ces deux minutes de danse qui semblaient n’être pas grand-chose se mettent à contenir un monde. Le novice frôle l’ennui, l’esthète de la fadeur se régale. La variation n’en finit pas de fondre en bouche. Elle n’est ni réductible à une interprétation (une saveur marquée) ni une abstraction (elle n’existe pas si elle n’est pas incarnée). Elle est souvenir et projection au moment même où elle se danse. Aucune des saveurs et toutes à la fois…
Pourtant, la fadeur est moins paradoxale que ténue. Elle est ce qui reste de ce qui advient, entre réalité pleine de potentiel et souvenir (ré)actualisé. À ce titre, j’ai bien aimé le chapitre « Reste de son » et « reste de saveur » — l’idée que le son s’apprécie davantage au moment où il rejoint le silence et la saveur quand l’aliment vient d’être avalé. Pas à son acmé, mais juste après, juste avant son épuisement, retenu à la lisière du sensible.
La fadeur, in fine, c’est un peu la non-saveur qui nous rend disponible à toutes, un état neutre mais pas insipide à partir duquel on peut goûter à tout… comme la position du sage développée dans Un sage est sans idée, qui n’est pas un juste milieu auquel on parvient, mais un point de départ pour naviguer d’un extrême à l’autre selon les circonstances. La monade FrançoisJullienne de légumes vapeur n’en finit pas de se déplier.
Il n’y a plus qu’à redessiner la roue des émotions en inversant le bord et la périphérie : évacuer au bord des pétales les émotions les plus vives (celles qui font éclater le bourgeon en fleur) et mettre au centre (au cœur) les émotions plus subtiles ; on navigue avec plus de fluidité d’une émotion à une autre, d’une couleur à une autre, depuis ce concentré de fadeur / blancheur teintée.
![]()
Pour goûter la saveur, il faut la retenir ; en cela se trouve une communauté d’expérience entre lecture et nourriture :
[…] la logique de jouissance est aussi la même, elle repose sur le principe de rétention.
C’est un truc qui m’a rendue dingue en prépa, qui me le fait encore parfois : de peur de ne pas retenir, de ne plus réussir à tenir dans une même pensée toutes les étapes de son déploiement, je me mets à ressasser et n’avance plus. Je dois m’entraîner à laisser filer — mes entraînements préférés : les glaces et les feux d’artifice.
Si je n’étais pas obsédée par cette idée de retenir, je m’en serais tenue à mes souvenirs de lecture et ce paragraphe n’aurait jamais été là. La chroniquette (quête chronique ?) aurait été plus courte et plus cohérente aussi, au lieu que je la truffe des oublis qui me reviennent en feuilletant le livre.