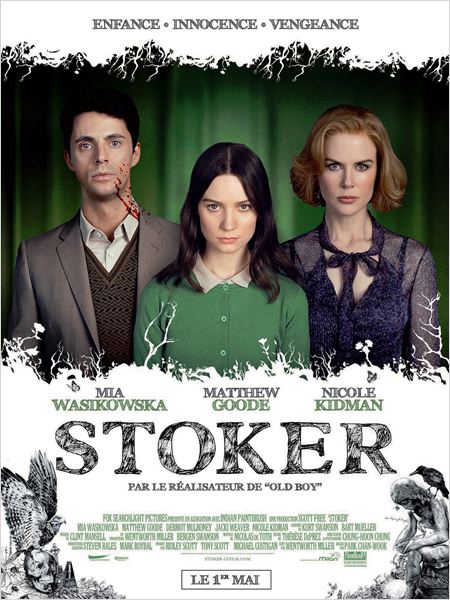Je me suis efforcée autant que possible de parler du film de Sofia Coppola par allusions indirectes, mais les indices risquent de se transformer en spoiler lorsque vous le verrez (surtout si vous dépassez le quatrième paragraphe). À bon entendeur…
Il y aurait une thèse à écrire sur la bande-annonce comme péritexte du film, et notamment comment, en mettant le spectateur sur une fausse piste, elle peut miner ou amorcer le film. À en croire sa bande-annonce*, Les Proies serait un huis-clos plein de tensions et de peurs : une promesse non tenue pour le spectateur indûment appâté (qui note sévère sur allociné), mais une attente assez fascinante à déjouer et que l’on se plaît à contourner avec Sofia Coppola pour peu qu’on accepte de flotter. Car le film flotte, c’est vrai. Il est plein de flottements et de torpeur : c’est la chaleur, les atermoiements, l’uniforme de l’ennemi qu’on hésite à voir comme corps ou corps d’armée.
En pleine cueillette de champignons, un chaperon rouge à tresses tombe sur un loup blessé et le ramène dans son pensionnat de jeunes filles quasi-déserté : ne restent plus que celles qui n’ont nulle part où aller tandis que la guerre tonne autour, la fumée de canon se confondant avec le brouillard de chaleur qui entoure la belle demeure à colonnes. Le motif du loup dans la bergerie est trop gros, trop attendu : ce n’est pas qu’il ne prend pas ; Sofia Coppola ne s’y attèle même pas. La peur n’est déjà plus à l’ordre du jour ; la méfiance s’installe, et même moins que la méfiance, autre : la défiance. On se défit de l’autre, mais aussi de soi-même face à l’emprise de l’autre. Car la traduction française est un moindre mal bien imparfait : The Beguiled ne désigne pas la proie mais la personne envoûtée, séduite. Le titre français déçoit (faux-ami : deceive) en se focalisant sur la cible, implicitement préméditée, alors que la référence à la prédation vaut surtout pour la fascination face au prédateur, l’immobilisme à laquelle il contraint dans l’instant où on l’autorise à fondre sur nous.
La fascination à l’œuvre est à multiples visages : c’est la séduction outrancière, adolescente d’une Elle Fanning réduite dans sa gamme de jeu ; la fuite ou la réalisation de soi pour une Kirsten Dunst empâtée-empêtrée dans ses jupons ; une aubaine ou un piège pour un Colin Farrel convalescent ; et un relâchement ou un soulagement pour une Nicole Kidman qui fait front et ne lâche rien, pas même ses traits quelque peu botoxés. Le terme d’awe a dû être inventé pour elle : il n’y a pas plus contradictoire et parfaite incarnation de qui en impose et par la peur et par l’admiration. (La géniale gamine d’Oona Laurence est la seule qui échappe à la fascination, la seule vraie amie que se reconnaît le soldat blessé.)
The Beguiled : l’envoûté, les envoûtés. Le genre et le nombre déjà trahiraient l’ambiguïté, sur laquelle Sofia Coppola se garde bien d’insister. N’occupant réellement aucun camp, la peur ne peut pas en changer. De ce fait, il n’y a pas de revirement, mais un lent glissement, un enlisement dans la situation qui vient compléter la leçon bien-pensante que la directrice voudrait inculper (pour se disculper ?) à ses ouailles : l’ennemi, pris individuellement, n’est pas toujours celui qu’on croit, non, oui mais : il est constitué par l’enchaînement des hasards et des accidents et peut le redevenir après l’avoir été. Et c’est finalement ce qui est assez glaçant : la violence ressurgit, intestine, d’un nouvel ordinaire, et s’accomplit le plus naturellement du monde.
Un point après l’autre, les boucles sont bouclées : de la cueillette des champignons à la cueillette des champignons ; de la broderie sur linge puis sur peau, en points de suture, à la couture de linceul. À points bien serrés, les filles, comme on vous a appris.
Cela valait certainement le coup d’être déconcerté : contrairement à une tension qui s’oublierait dans la surprise de son dénouement, le film de Sofia Coppola continue doucement de hanter, comme la mélodie enfantine qui accompagne le générique.
(Quand même : je serais curieuse de voir l’original, même si j’aurai nécessairement l’impression d’un remake du remake.)
* À en croire la bande-annonce… et les principales images diffusées, toutes sombres, alors que la photographie est bien souvent lumineuse. La comm’ a privilégié la piste du huis-clos et, in fine, ce n’est pas si faux : quand on y pense, chez Sartre ou Yasmina Reza, par exmple, l’enfermement est essentiellement relationnel ; à point nommé, on pourrait partir… mais on reste, sans l’avoir vraiment décidé.