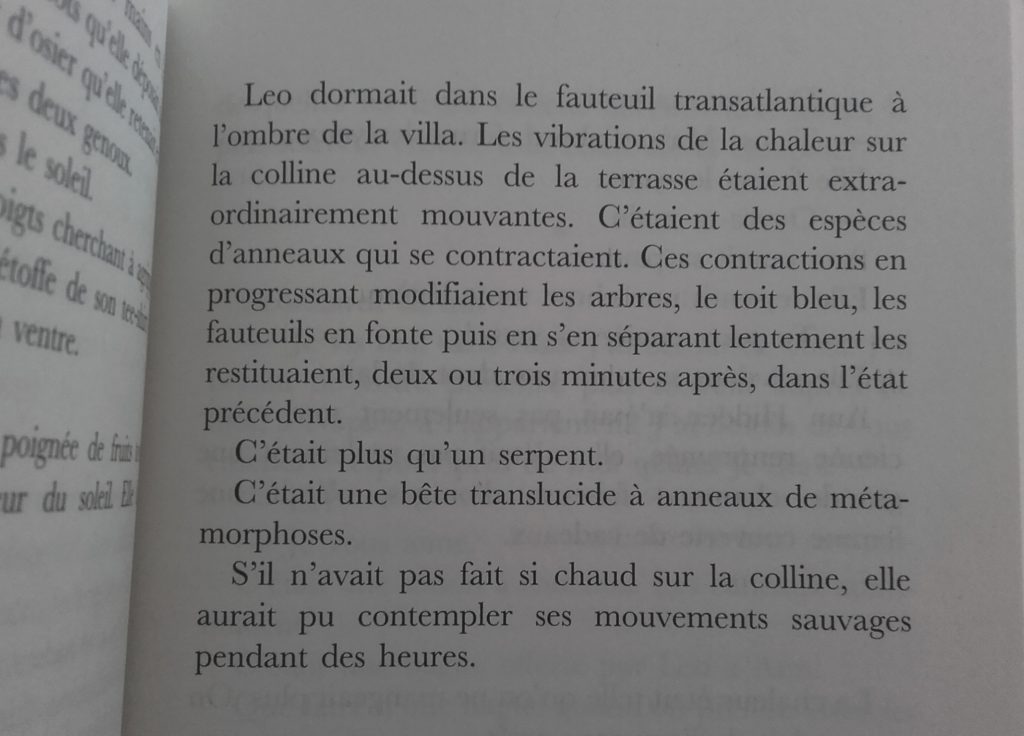Pascal Quignard diffracte sa Leçon de musique en trois parties à la narration distincte, qui se font souterrainement écho :
- Un épisode tiré de la vie de Marin Marais : l’équilibre est bon entre récit, érudition et mystère ; le sens se feuillette, lève et s’agglomère.
Il faut quand même n’être pas allergique à l’érudition, qu’affectionne Pascal Quignard. Je me suis fait la réflexion que toutes ces dates et ces noms propres ne fonctionnent qu’imprimés dans une police à empattement ; il faut bien ça pour leur conférer une certaine volupté, pour qu’un dictionnaire soit remplacé par le nom complet de son auteur en huit syllabes : “Émile-Maximilien Littré assure que dans la mesure où […]” - Un jeune Macédonien débarque au port de Pirée : c’est peut-être l’effet de la fièvre (j’avais le Covid en octobre), mais cette partie m’a semblé lourde — un ensemble de fragments qui ne s’assemblent pas harmonieusement comme des airs musicaux qu’on enchaînerait en récital, mais doivent sans cesse être contrecarrés avec effort pour plier dans la direction souhaité, comme des pierres qu’il faudrait tailler, maçonner.
- La dernière leçon de musique de Tch’eng Lien : le conteur reprend le dessus, et quel conteur ! Quand j’y repense avec le prisme de François Jullien, c’est un peu le triomphe de la philosophie chinoise sur la philosophie occidentale : moins cérébrale et beaucoup plus poétique. À la limite, on pourrait ne lire que ce récit.
![]()
Pour la mémoire, pour la curiosité : des extraits…

I Un épisode tiré de la vie de Marin Marais
Pour Pascal Quignard, les hommes n’ont que deux alternatives pour ne pas perdre la voix de l’enfance : la castration ou la musique. Marin Marais se serait dirigé vers la composition et aurait choisi la viole suite à la trahison de sa voix.
“Ils travaillent une voix qui ne les trahira pas. Et c’est la vocation que Marin Marais s’invente : devenir le virtuose de la voix basse, de la voix muée au point de la rendre impossible à tout autre.”
“Les femmes persistent et meurent dans le soprano. Leur voix est un règne. Leur voix est un soleil qui ne meurt pas.”
(versus les hommes qui perdent leur voix, ont deux voix)
On aurait ainsi beaucoup de femmes virtuoses et peu de compositrices parce qu’elles échappent à la mue (mouais, ça m’étonnerait qu’Aliette de Laleu valide).
“Au bout de trois ou quatre heures, épuisés, la tête enfin aussi vide et belle que la caisse d’un instrument de musique ancien — qui ne contient rien —, […] nous buvons du vin.”
“Telle est aussi une part de l’objet de la musique : endurer le délai. Construire du temps à peu près non frustrant, éprouver la consistance du temps et peu à peu y infiltrer de l’avant et de l’après, du retour et du à-venir, de l’est et de l’ouest, du soprano et de l’aggravé, du rapide et du lent, tenir les rênes de la frustration, maîtriser la carence immédiate, jouer avec l’impatience.”
L’homme connaîtrait trois mues :
- la naissance en tant qu’abandon de la perception des sons depuis le ventre de la mère, de la musique antérieure au langage (le récit serait ainsi relatif au temps humain, la mélodie au temps qui le précède) ;
- la mue telle qu’on la connaît, vers 13/14 ans ;
- la mort comme mue finale.
“Un roman ? L’histoire ? La Bible ?
Abeille dans la ruche répétant le chemin d’une fleur.”
“Une voix résonne dans le temps. La voix masculine y est brisée en deux morceaux. Elle est comme en deux temps. La voie des hommes est le temps fait voix.”
“La langue allemande nommait l’ennui le « temps-long ».”
“La rage qui est sous l’ennui, c’est la rage qui est la plus partagée, c’est la rage d’être soumis à la sexuation et à la mort ou, pour le dire plus simplement, c’est la rage d’être soumis à l’attente de ce qu’on ignore.”
“Écouter attentivement de la musique. C’est faire d’un moment de temps-long une faveur du sort. C’est se divertir du temps par une espèce d’attente de lui. C’est de l’ennui qui jouit.”
“À la plainte de l’enfance : « C’est long ! », la musique répondait : « Je consens à la longueur du temps. J’éprouve du plaisir à l’éloignaient de ce que je convoite. » Le jeu, pour l’enfant, était beaucoup plus efficient que la musique. Mais la musique était jouée Mais la musique joue, se joue. Elle joue avec le temps déposé et sans mort en nous.”
![]()
II Un jeune Macédonien débarque au port de Pirée
En grec, muer se dit “bêler comme un bouc” et Pascal Quignard établit à partir de là un lien entre théâtre (antique, où ont lieu des sacrifices) et mue : un changement de peau.
Quant au Macédonien du titre, il s’agit d’Aristote :
“L’âge venant, il avait cessé de lire. Il se passionna pour l’observation de tout ce qui vivait. […] L’univers était comme un grand théatron.”
“Aristote meurt. Mais c’est le réaliste, c’est le zoologue qui meurt. Minutieusement il abandonne le jour, l’odeur, la voix, lui-même. Même la voix muée, il la laisse derrière lui. La voix muée mue dans quelque chose de moins rauque et de moins inégal. La robe ultime qui est laissée, c’est la vie.
Un corps soudain se décompose et mute dans le silence. Il se minéralise. C’est le réel qui approche.”
![]()
III La dernière leçon de musique de Tch’eng Lien
“J’amplifie une vieille légende.” Oui, c’est bien de le dire, monsieur Quignard.
Souvenir d’une scène furtive, à la mort de la première épouse de son père (on aurait presque envie de l’illustrer, je trouve) :
« Il était à genoux et son front touchait le sol en bois. Il entrapercevait les lueurs mouvantes des lampes, des ombres et des pieds. Puis, en même temps, il avait entendu la goutte d’huile qui crépitait dans le grand luminaire et le bruit de ses larmes qui tombaient sur le plancher de bois. »
“Votre luth du temps de la naissance des proverbes est comme une coque de noix. Il faut la briser pour manger le fruit. Souvenez-vous que dans la musique le son n’est pas le fruit.”

 Un an, deux ans peut-être que j’entasse mes livres à l’horizontale, près de mon lit et dans les derniers trous de ma bibliothèque, pour en dire un mot et garder une trace de leur lecture avant de les ranger. Je ne me souviens déjà plus de leur ordre de lecture, ou un ordre très lâche seulement : celui-ci avant celui-là, sans les intervalles ; alors pour retrouver une bibliothèque verticale, j’ai décidé de les prendre par petits tas hasardeux.
Un an, deux ans peut-être que j’entasse mes livres à l’horizontale, près de mon lit et dans les derniers trous de ma bibliothèque, pour en dire un mot et garder une trace de leur lecture avant de les ranger. Je ne me souviens déjà plus de leur ordre de lecture, ou un ordre très lâche seulement : celui-ci avant celui-là, sans les intervalles ; alors pour retrouver une bibliothèque verticale, j’ai décidé de les prendre par petits tas hasardeux.