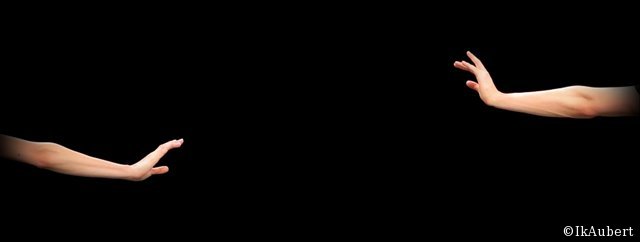Avoir l’occasion de voir des ballets de chorégraphes américains dansés par des compagnies américaines est à double tranchant : au plaisir de découvrir un nouveau style pour ainsi dire in situ répond la légère déception de ne pas le retrouver lorsqu’on revoit les mêmes pièces dansées par des troupes exogènes. L’avantage du désavantage, c’est qu’il devient plus facile pour le balletomane parisien de cerner ce qui fait la spécificité de ce qui lui semble n’en avoir aucune, aka le style Opéra de Paris. Je comprends peu à peu ce que les étrangers entendent par élégance, et comment celle-ci peut se retourner (toutes proportions gardées) en fadeur.
Laura Cappelle, journaliste pour la presse anglo-saxonne bien que Française, s’est ainsi amusée de ce que l’entrée de Fancy Free au répertoire de l’Opéra de Paris a tout d’un pari entre programmateurs, qui aurait été perdu par Aurélie Dupont. Difficile de faire entrer Broadway à Garnier. Même si j’ai grand plaisir à revoir Karl Paquette avant son départ à la retraite, il faut avouer que l’étoile qui s’est fait une réputation de partenaire attentif n’est pas franchement à l’aise dans le rôle de coureur de jupons un peu balourd. À ses côtés, Stéphane Bullion paraît encore plus en retrait. Cela manque de gouaille – ce que l’on aurait pu avoir d’équivalent, en titi parisien, à l’attaque et la désinvolture américaines, et que nous aurait sans doute bien servi Allister Madin par exemple. Il n’y a dans cette distribution que François Alu pour tirer son épingle du jeu ; sa gestuelle un peu brusque, qui a tendance à me déranger, fait ici merveille : on voit le marine en permission, qui fait le mariolle avec ses potes. Les étoiles féminines campent sans souci les pin-ups qu’ils tentent de séduire : Eleonorra Abbagnatto, qui ne cesse de rajeunir à mesure qu’elle se rapproche de la retraite, joue le sex-appeal avec une classe d’enfer, tandis qu’Alice Renavand fait montre à la fois d’une extrême choupitude et d’un tempérament bien trempé. Comme les marines, je défaille à l’amorce d’un rond de jambe dessiné par un pied dont la cambrure est encore amplifiée par les talons.
A Suite of Dances, dansé par Joaquin de Luz lors de la venue du Pacific Northwest Ballet à la Seine musicale, était une pochade poétique. Dansé par Paul Marque, c’est très beau, mais tout autre chose, comme si le danseur en brun de Dances at a gathering poursuivait la soirée en solitaire. L’humour se fait si discret qu’il cesse de fonctionner comme un contre-poids aux aspirations lyriques. On part en rêverie et l’on s’y perd. (Tout de même très agréablement surprise, surtout en tenant compte de la déception de ne pas voir Mathias Heymann.)
Afternoon of a Faun m’a toujours plus séduite par sa dramaturgie que par sa chorégraphie. Cela ne risque pas de changer avec le faune tout en plastique de Germain Louvet ; luisant sous les projecteurs, il ne sue pas, ne transpire pas l’animalité qui seule peut injecter la tension érotique nécessaire à troubler cet instant de narcissisme partagé. Léonore Baulac y est manifestement à l’étroit, et repart sur la pointe sonore des pieds sans qu’il se soit passé grand-chose.
La soirée se clôturait par Glass Pieces, un plaisir dont je ne me lasse pas, tant pour la troupe d’hommes menée pieds flex et tambours battants que pour le fourmillement des danseurs qui se croisent en tous sens avant de former une colonie de fourmiz à l’arrière-scène. Cette traversée a tout d’une descente des ombres moderne, répétitive et hypnotique ; le genre de passage qui doit donner envie aux solistes de faire du corps de ballet juste pour y participer. Hyper synchronisé, le corps de ballet de l’Opéra se montre encore plus puissant que ses homologues outre-Atlantique dans le passage masculin des tambours, mais estompe un peu l’effet de fourmillement dans les passages où tout le monde se croise. En voyant Héloïse Bourdon rayonnante en scène, je comprends soudain que c’est peut-être ceci qui me donne cette impression de demi-teinte : dans l’ensemble, les danseurs sourient peu. On devine qu’ils prennent du plaisir à danser ce programme, quand on s’attendrait à se faire contaminer par la bonne humeur. Cet amusement somme toute très policé se répercute sur mon impression de la soirée : j’y ai pris plaisir sans pour autant m’éclater. Question de style et non de talent, faut-il le préciser.