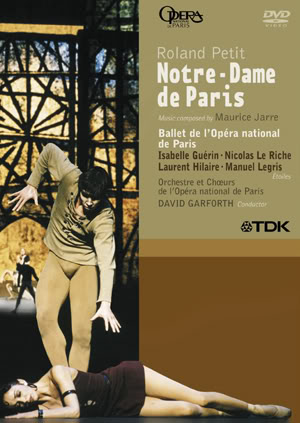J’allais ajouter d’Alexeï Ratmanski, mais, comme pour d’autres classiques qui ont connu plusieurs chorégraphies, le ballet est ici attribué au compositeur, Rodion Chtchedrine (il faut que je m’en souvienne – mais pour cela, il faudrait déjà que je parvienne à le prononcer).
Palpatine se félicitait d’avoir la corpulence du héros (mais pas ses renversantes attitudes renversées, je le crains) ; il l’aurait également pu de ne pas avoir été taillé à l’image de son acolyte : dans la file d’attente pour les places de dernière minute, nous avons frisé l’émeute lorsqu’il m’a fait signe de le rejoindre alors que je discutais déjà depuis une vingtaine de minutes à un mètre de lui, peu encline à forcer l’entrée dans la cohue. B#4, qui m’a identifiée à la tache orange de mon sac à dos (signalétique de spectacle) me raconte qu’elle a fait un Casse-Noisette avec thermos, dans le froid, où les gens se poussaient et dénonçaient avec véhémence toute tentative de resquille, fût-elle involontaire. L’esprit de Noël sans doute. Nous n’étions lundi que le premier novembre mais aujourd’hui les décorations sont installées tellement en avance qu’il n’est guère surprenant que nous nous soyons fait enguirlander. Palpatine de se faire l’avocat du père Fouettard : « Il faut les comprendre, ces vieux, c’est sûrement leur dernière chance de voir le Mariinski. »
Le Mariinski au Châtelet. J’ai bien failli rater cette soirée ; Le petit cheval bossu, dont je n’avais jamais entendu parler, ne m’évoquait nullement un ballet. C’en est un merveilleux, pourtant – traversé d’êtres fantastiques dont la présence n’est pas discutée et néanmoins ne laisse pas d’émerveiller. De temps à autres, le môme de la rangée devant moi éclate de rire, parfois à retardement, comme si son jeune âge ne lui avait pas encore permis d’élaborer les modèles de la farce, qu’il nous suffit, adultes, de voir esquissés pour que nous sourions d’un air entendu. Il faut au môme un plus grande nombre de répétition avant que le mécanisme ne se fasse sentir et son rire part toujours précisément au moment où s’émousse celui que je ne laisse pas échapper, retardant ainsi le moment où l’adulte blasé se ferme à ce qu’il voit. Et c’est vrai que les frères du petit paysan sont fidèles à l’esprit de la vodka, deux larrons pas bien dégourdis dont les jambes vont en tous sens ; qu’Ivan lui-même est un peu fou (follet), et que le Tsar, auquel il vendra ses chevaux, a (dixit le gamin) « un chapeau de Père Noël », rouge et pointu. Je vous vois lever un sourcil circonspect : un paysan, le Tsar, hum ? C’est qu’un conte, surtout dansé, autorise le grand écart.
L’histoire est délicieusement alambiquée, pour peu qu’on l’ait en tête pour comprendre ce qui se passe sur scène. Heureusement, B#4 avait prévenu et nous avons sagement décrété un atelier lecture avant le lever de rideau, avec révision à l’entracte. En allant guetter un rôdeur, Ivan attrape une cavale qui lui offre en échange de sa liberté deux étalons (mains à l’égyptienne, habillés à la Elvis Presley, oh yeah !) et un petit cheval bossu qui devient son rusé compagnon et nous offre ainsi des manèges où cavalier et canasson sont parfaitement à l’unisson. Ils réussissent pourtant chacun à garder leur style et ainsi ne jamais abandonner leur personnage au profit d’une danse qui deviendrait ornementale : Leonid Sarafanov est un Ivan fluet aux gestes vifs et déliés tandis que Grigori Popov, sa monture, est plus nerveux et incisif. Les deux maigrichons sont de fabuleux danseurs et il faut bien les tours suivis à la seconde de la fin pour nous rappeler que c’est technique. En attendant, le jeu l’emporte et les compagnons piaillent au milieu des oiseaux de feu – ce sont mes couleurs, mais aux tutus je préfère encore la lumière rougeoyante projetée depuis les coulisses sur le torse nu du jeune paysan.
Pendant qu’ils caracolaient, les frères ont dérobé les chevaux pour aller les vendre en ville, au marché. C’est évidemment l’occasion de faire briller le corps de ballet, tout de vert vêtu (!), et de faire alterner des groupes de demi-solistes. J’aime beaucoup les danseuses tsiganes, leur petites chaussures noires, leurs robes amples et colorés, leurs roulements d’épaules… Les nourrices, même avec des fichus jaunes sur la tête, sont splendides, éplorées dans de grands développés en quatrième devant, bras en supination au ciel. Quant aux chevaux qui nous ont mené à ce divertissement, le Tsar en (petite) personne se trouve intéressé. Ivan survient à ce moment pour les récupérer ; il ne s’oppose pas à la tractation, mais choisit en échange le chapeau du chambellan, lequel se roule par terre d’être ainsi remplacé – et le petit paysan de partir pour les appartements royaux.
Je ne sais pas si la sagesse retourne à l’enfance, mais le Tsar était un « petit » vieux qui trépigne dans son pyjama rouge et se fait dorloter par ses belles nourrices, qui le font manger, jouent avec lui, le chatouillent et lui font la lecture avant de le border. Le chambellan (Youri Smekalov – j’aimerais bien le revoir, tiens) est là pour nous rappeler que nous sommes à la Cour et qu’on y intrigue. Malgré sa tenue de joker avec croix sur la poitrine et rond sur les cuisses, et sa manière machiavéliquement toonesque de tourner le buste pour tourner la tête en se frottant les mains (gantées de blanc), ce n’est pas bien méchant : il pique à Ivan sa plume d’oiseau de feu et l’amène au Tsar, qui nous déclenche ainsi une petite vision et fait un caprice pour qu’on lui ramène dare-dare la demoiselle qui lui est apparue. Coups de sabots pour marquer le départ : Ivan et le petit cheval bossu sont repartis pour un petit tour de manège…
Au deuxième acte, forcément, les compagnons trouvent la demoiselle (Alina Somova) qui ne met pas longtemps à frotter les oreilles du petit cheval (il hennit de plaisir, Palpatine comprend pourquoi) et à se laisser entraîner par Ivan, dont elle a du modérer les ardeurs pour avoir relevé une trop grande déférence. Encore un de ces moments tendrement comique où l’absence de demi-mesure est moins caricature qu’enthousiasme naïf.
De retour près du Tsar, Ivan lui présente la jeune fille à regret. Lorsqu’elle entame la même danse qu’avec Ivan, celui-ci s’assoit sur le lit du Tsar, tout dépité. Mais s’il est agréable à la demoiselle de se faire courtiser par une tête chapeautée couronnée, se marier à un petit vieux qui est essoufflé au bout de quelques pas de danses (espèces d’arabesque sautillées tout à fait comique pour traduire le souffle court) ne lui dit pas plus que cela ; elle pose alors comme condition au mariage l’obtention d’une pierre qui repose au fond de l’océan. La pierre n’a pas de pouvoir particulier et ne sert qu’à prouver que la demoiselle sait parler au vieux Tsar un langage qu’il comprend bien – le caprice. Avant de me décider pour la soirée, j’avais fait un tour sur youtube et trouvé un extrait sous-marin. Je me demandais comment on y arriverait ; c’était pourtant simple, j’aurais du m’en douter : comme un cheveux sous la soupe. Quelques pas de cheval et c’est reparti pour de nouvelles aventures.
Au milieu des flots qui ondoient (groupe resserré de danseurs cagoulés de blanc, snake en cascade – malgré un argument ancré dans la tradition, Alexeï Ratmanski développe une chorégraphie émaillée d’accents relativement modernes), ils rencontrent Yekaterina Kondaurova, Cavale revenue sous les traits de Princesse de la mer, tout en jambes et en présence imposante. Tandis que Palpatine avait déjà commencé à fantasmer dessus en Cavale (la perruque rousse), c’est à ce moment que je la découvre – royale, vraiment. Elle me plairait presque davantage que la demoiselle.
[Ne cherchez pas à zoomer pour la voir, il s’agit d’une autre représentation.][Un drôle de tête à l’envers était dessinée sur le costume… comme un reflet de Narcisse intégré ;
en revanche, pas trop compris pourquoi des détails de visage sur les larges tuniques des danseuses tsiganes…]
Lorsque le Tsar lui offre la pierre qu’Ivan lui a remis, la demoiselle invente une autre épreuve, de plonger dans un chaudron d’eau bouillante. Mais le Tsar n’a nulle envie de prendre son bain, d’autant qu’il a goûté l’eau et que cela lui a brûlé le doigt ; il demande à ce qu’Ivan passe le premier. Enfer et damnation, mais le petit cheval bossu est là, jette un sort et non seulement Ivan en sort indemne, mais il est encore métamorphosé en tsarévitch.
Il ne reste donc plus qu’à faire passer le Tsar à la casserole (les boyards ont alors vraiment l’air de mirlitons avec leur toque sur la tête) : on obtient ainsi un beau petit couple royal qui prépare son mariage à grand coup de variations.
Cela pourrait être totalement niais, c’est en fait naïf, au sens où on le dit parfois des peintres : c’est coloré, vif et amusant ; peu de décors, réduits à quelques formes géométriques, maison ou soleil stylisés ; on ne prend pas la pose en arabesque mais on y saute beaucoup, les personnages virevoltent dans d’incessants changements de direction. En fait de brillant, c’est surtout scintillant, la technique diffractée dans une multitude d’entre-pas incisifs ; on brosse à petits traits une peinture fort vivante de tout ce petit monde cahotant, où le merveilleux n’en est pas moins relevé par une petite touche de cruauté rapidement oubliée, et où la bonne fée est jouée par un petit cheval bossu et rusé, malicieux à souhait. Il n’était pas en bois mais j’aurais bien fait un nouveau tour de carrousel.
[Pourquoi diable est-ce que je ne trouve aucune photo du petit cheval ?]