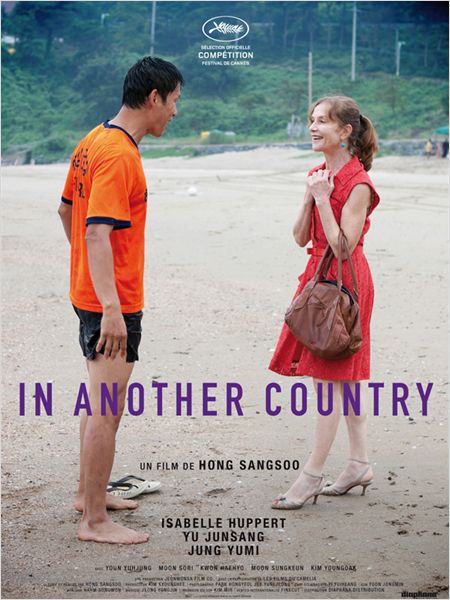Habituellement, l’héritage miracle d’un obscur oncle intervient sur la fin, lorsque les amants ont été surpris ensemble au lit et qu’il faut trouver une condition au jeune homme désargenté pour pouvoir le marier. Dans The Rake’s Progress, il survient dès le début alors que Tom et Anne profitent des mœurs de leur époque* pour batifoler sans convoler, sous le toit même du futur beau-père. De Molière à Stravinski, la providence est devenue hasardeuse, ouvrant au danger plus qu’elle en écarte. L’homme venu annoncer au jeune homme fainéant que jamais il n’aura à travailler le précipite dans le désœuvrement.
Sous prétexte de faire fructifier l’héritage, il l’entraîne à la ville. Pour quitter la chambre lumineuse où les rideaux volaient sous l’action des ventilateurs et laissaient entrer « des parfums et des sons d’allégresse » d’une nature printanière, Tom emprunte une petite échelle dont il descend un à un les degrés – la descente a commencé. Il laisse derrière lui cette chambre qui apparaît déjà comme un souvenir, encadré et inatteignable, et se laisse initier au plaisir – ou à ce qui est communément admis pour tel, Tom ne semblant pas en prendre outre mesure. Élève docile et désœuvré, il sombre peu à peu dans la débauche mais, ce qui est curieux, beaucoup moins par goût que par faiblesse. Au milieu des prostituées, il pense encore à Anne, l’aime et en souffre, sans pour autant songer à la retrouver.
Nick Shadow fait de lui ce qu’il veut et lorsqu’il lui fait miroiter une invention miraculeuse qui change les pierres en pain, Tom s’illusionne davantage encore qu’il n’escroque les ouvriers. Cette machine d’alchimiste soi-disant chrétien, Olivier Py la figure sous forme d’une roue dont les rayons sont des néons : hypnotisé par ce qui brille facticement, Tom ne voit pas que la roue tourne et que sa chance est en train de le perdre.
Déçu par la nature qu’il rend responsable de sa mécompréhension des plaisirs et de la nature humaine, il prend son contrepied sur le conseil vicié de Nick et décide de s’enticher de ce qu’elle a produit de plus laid. Baba, femme à barbe et bête de foire, lui apparaît comme le remède au plaisir, qui lui-même devait l’être à l’amour. C’est alors une débauche, non plus des sens, mais de grotesque et d’acrobaties. Jongleurs, musclors, nains, danseuses de revue emplumées grouillent sur scène et font alors ressortir le parti-pris d’Olivier Py de ne pas avoir représenté la débauche à demi-mot. Au-delà de la provocation qu’il y a à exhiber porte-jarretelles et nudité bandée à des spectateurs très convenables, le bordel qui se tient sur la scène du palais Garnier trouble autant les habitudes de l’amateur d’opéra que les sens de Tom. Le premier, distrait par ce qui s’agite sous ses yeux, peine à se concentrer et à écouter, tout comme le second a du mal à entendre la voix de la raison ou même celle, avec un e, de la nature.
Esclave d’une liberté qu’il a voulue et qui, en l’absence de liens, ressemble davantage à une errance, Tom ne peut plus croire à sa bonne fortune. Les dettes se soldent par une vente aux enchères ; après les bêtes de foire, c’est tout un bestiaire de sculptures qui est exhibé devant un public curieux et contempteur : boa, autruche et un for-mi-dable pingouin (le mien est tout fier de se faire épousseter par procuration par une soubrette).
Froid. La descente aux enfers se finit sans feu ni flamme – à la rue. Corps exténué, Tom s’est perdu et avec lui, la raison. L’homme qu’Anne, sainte Anne, récupère n’est plus ni lui-même ni le même : elle peut lui pardonner mais lui ne peut pas se racheter. Elle veille sur ce vieux fou comme sur l’enfant qu’il lui a fait avant de la quitter, jusqu’à ce qu’elle comprenne que la Vénus qu’il aime n’est pas plus elle qu’il n’est Adonis : il n’a jamais eu le cœur de l’aimer autrement que comme un idéal regretté. La force lumineuse d’Anne (Anne Trulove) n’a pas réussi à sauver Tom de son ombre, Shadow méphistophélique – seulement à la préserver de son amour. L’épilogue rit jaune : sans dieu, pas de morale à l’histoire quand ses protagonistes en ont été dépourvus.
Le vrai héros de l’histoire, c’est Nick, i.e. Gidon Saks, formidable voix et acteur.
Vu en compagnie de Palpatine.