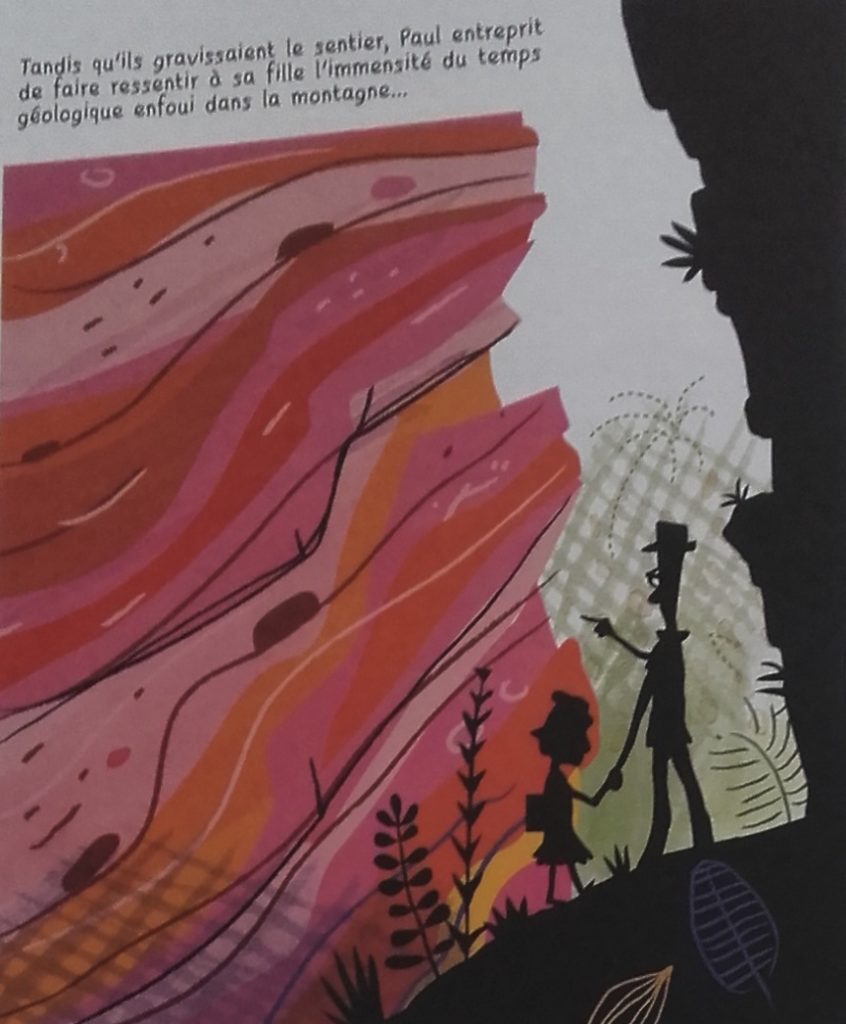On peut se demander pourquoi le concours est maintenu d’année en année alors que la prestation de jour J n’est manifestement pas l’unique paramètre pris en compte. C’est tant mieux, dans une certaine mesure, car il y a les paramètres qu’on oublie en tant que spectateur, tels que la nécessité d’avoir un danseur de tel grade assez grand pour servir de partenaires à des danseuses déjà promues à ce même grade, ou la moindre tendance aux blessures, qui évitera de trop nombreux changements de distributions… Prendre en compte le travail de l’année évite aussi de bloquer les artistes qui perdent leurs moyens dans ce genre de circonstances – les bêtes de scène qui ne sont pas des bêtes de concours. Pablo Legasa et Héloïse Bourdon, par exemple, captent la lumière comme personne en spectacle ; le jour du concours, ils étaient éteints. Cela n’a pas empêché Pablo Legasa d’être promu, mais cette promotion peut en retour sembler n’être pas très fair play pour ses concurrents (on avait un peu envie de lui rappeler que, hey, dude, tu danses le rôle d’un mec qui risque de mourir, là, ce n’est pas une promenade pour faire prendre l’air au coup de spleen du dimanche soir).
Chaque année, les résultats du concours interrogent. Pas forcément parce qu’ils seraient injustes ou incompréhensibles (encore que ne nommer personne chez les femmes sujets alors qu’il y a pléthore d’excellentes danseuses soit un non-choix contestable), mais parce qu’ils obligent à se demander ce que l’on attend d’un danseur. Il y a par exemple une certaine contradiction entre une moindre valorisation du néoclassique ou du contemporain et la programmation du ballet. Je n’ai pas assisté aux concours de ces dernières années et il faudrait de touts façons faire des statistiques pour s’en assurer, mais il me semble qu’il y a 6-7 ans, il y avait moins de classique pur dans les variations libres, moins de pointes chez les filles. Mauvaise mémoire de ma part ou valeur-refuge avec l’arrivée de la nouvelle direction ? Simon Le Borgne a été promu avec une chouette variation de Forsythe, mais toutes les autres promotions masculines l’ont été sur de Perrot, Lander et Noureev. Le Frédéri d’Hugo Vigliotti, par exemple, est complètement passé à la trappe, alors qu’il filait carrément des frissons (les pointes de pieds nerveuses, le torse vibrant… jusqu’à la chute finale où le danseur ne s’est pas jeté hors-scène sur un tapis qui l’aurait attendu, mais… au sol). Dément, un de mes plus beaux souvenirs du concours.
Le choix des variations libres montre également l’attachement des danseurs à un répertoire qui n’est pas souvent programmé, et notamment à Roland Petit, avec une Arlésienne, donc, mais aussi un fantôme de l’Opéra (Allister Madin), deux Esmeralda et trois Carmen (celle d’Aubane Philbert lui a permis de monter, après toutes ces années… et celle de Lydie Vareilhes était vraiment à s’en mordre le doigt dans la bouche, mamma mia !). Je serais curieuse également de voir un jour Arepo, dont je ne parviens pas à me faire une idée globale ; je l’associais si bien aux académiques rouges et aux doigts chatouilleurs que j’ai cru à une nouvelle erreur d’annonce lorsque Caroline Osmont est arrivée sur scène en tutu blanc – en réalité pour une variation très drôle, truffée d’interruptions méta, qui lui allait comme un gant.
Au-delà du choix des variations, il y a les danseurs que l’on regarde et ceux que l’on ne regarde pas. Certains soulèveraient des montagnes qu’on ne leur accorderait pas de crédit, tandis que d’autres peuvent donner des signes de faiblesse et encore enchanter. Il y a là quelque chose de fascinant qui interroge, au-delà même de suspicions de favoritisme et de têtes de turc – ou alors : pourquoi nos chouchous sont-ils devenus nos chouchous ? Il y a probablement une raison de physique (tout est physique dans la danse, mais je veux parler des proportions du corps, sur lesquelles on n’a pas prise) : les jambes d’acier de Katherine Higgins et son caractère n’auraient-ils pas été snobbés parce que la carrure de la danseuse est plus imposante que celle de ses camarades ? Serait-ce pour une raison analogue que le cygne d’Éléonore Guérineau, tout de force rentrée, suspendue, n’a pas été aussi apprécié que celui de Roxane Stojanov ? Allister Madin doit-il ses années de chef des brigands sujet à n’avoir pas le physique d’un prince (alors qu’il a montré qu’il pouvait avoir une danse princière à tomber) ? On a la désagréable impression que ces danseurs ne seront pas distingués quelque que soit la force avec laquelle on les remarque.
Encore ne les remarquons-nous pas tous de la même manière. Je suis toujours fascinée, lorsque je discute ensuite avec des amies, de constater que nous n’avons semble-t-il pas assisté à la même représentation, ou pas au même concours. Je ne parle même pas des avis et des préférences (les goûts et les couleurs, on sait bien…) mais de la perception initiale qui devrait servir à étayer ces avis et préférences, et qui semble souvent réinventée par leur prisme. Par exemple, je reconnais que le cygne d’Éléonore Guérineau a une certaine densité ; elle a une présence, une qualité de danse avec laquelle ma sensibilité personnelle n’entre pas toujours en empathie, mais que je perçois. Pour d’autres, par exemple Naïs Duboscq, dont il a beaucoup été question autour de moi, j’ai l’impression d’avoir été aveugle. Et inversement : je récolte parfois un Ah ? en mentionnant un danseur qui m’a particulièrement enthousiasmée. La perception se fait toujours tellement d’un bloc qu’on a parfois du mal même à s’accorder sur ce qui paraît le plus factuel, le plus basique : la maîtrise technique du danseur.
À force de parler de technique et d’artistique comme si on assistait à une compétition de patinage, on finit par oublier que l’artistique n’est que maîtrise corporelle et que la technique est déjà artistique – une énième variation sur le thème du corps et de l’âme, si cher à notre culture dualiste. En assistant à ce concours, je me suis demandée si, attirée spontanément par les candidats faisant montre d’une technique aisée, presque malgré moi, malgré la volonté que j’ai d’admirer des artistes et non pas des sportifs, je n’étais pas en réalité attirée par autre chose : par la grâce. Souvent, ce ne sont pas trois tours qu’on admire ou la hauteur d’un saut, mais l’absence d’effort visible avec laquelle ils sont enlevés. Je ne peux pas m’empêcher d’admirer les danseurs pour qui tout à l’air facile, ceux qui m’épargnent leurs efforts pour ne plus me communiquer que leur joie de ne plus toucher terre. Cela va à l’encontre des principes de notre société soi-disant méritocratique : on voudrait admirer les gens proportionnellement aux efforts qu’ils fournissent, mais cela ne fonctionne pas en danse ; même à effort égal, certains se démarqueront des autres. C’est injuste et c’est splendide à regarder, si l’on accepte d’entériner cette injustice et de ne pas condamner d’office la maîtrise technique comme pure virtuosité vide de sens simplement parce qu’elle disqualifie les moins chanceux. Si on l’admet : une petite batterie pleine de ballon et l’on se met soudain à mieux respirer (attribuant alors un « supplément d’âme » au danseur ; dans mon monde, il n’y a de supplément que de supplément chantilly, sachez-le) ; un équilibre sans tremblement et c’est le monde qui s’offre à nous, avec l’illusion que nous aurons tout le temps de l’explorer.
Il y a de cela par exemple chez Marion Barbeau. Je me soupçonne toujours de l’apprécier pour la beauté de ses traits, pour son sourire, et à chaque fois que je la vois danser, je dois me rendre à l’évidence : c’est tout son corps qui sourit ; cette danseuse rayonne. La variation imposée du concours m’a fait voir ce que je n’avais jamais vu, aveuglée par ce rayonnement : la maîtrise de cette danseuse, la facilité avec laquelle elle amène son buste au-dessus de ses attitudes, ainsi parties pour se prolonger en équilibre, la sûreté de ses piqués, de ses développés… Si je ne me suis jamais souvenue d’elle comme d’une technicienne, c’est parce que la grâce l’a toujours emporté.
Semblable effet s’est produit chez les quadrilles avec une danseuse que je ne connaissais pas (et que le jury n’a semble-t-il pas reconnue). Seohoo Yun a réussi l’exploit de me faire aimer Paquita. J’ai complètement redécouvert la variation de l’étoile avec elle : lorsqu’elle remonte un bras le long de l’autre, on la voit enfiler de longs gants somptueux, et le reste est à l’avenant. Son cambré à n’en plus finir semble même faire ployer la musique ; elle a cette capacité dingue à créer de l’espace dans la partition sans distendre la musique. Dans son imposée même, là où d’autres détournent en quatrième dans le feu de l’action, elle a le temps de rassembler ses jambes sous elle dans des soutenus qui sont le comble du chic.
Chez les garçons, quoique le degré de maîtrise n’ait rien à voir (ce n’est pas tous les jours qu’une quadrille danse à l’égal voir surpasse des étoiles), c’est Isaac Lopes-Gomes qui m’a donné un sentiment d’aisance assez grisant. Sa danse manque encore certainement de nuances par rapport à un Andrea Sarri, par exemple, mais son énergie ragaillardit dès qu’on le voit (il m’avait déjà attrapé l’oeil dans le corps de ballet de Don Quichotte).
La capacité semble-t-il innée de certains à briller est à tempérer avec les acquis de l’âge et du métier. Cela m’a frappée chez les quadrilles, où l’on trouve à côté de Bambis graciles de vraies femmes, qui entrent en scène avec un vécu qui donne plus de présence, plus de poids – et partant, une danse plus nuancée. Claire Gandolfi, par exemple, a une belle manière de « donner du dos », quand d’autres plus jeunes cessent d’exister le temps d’un détourné ou d’une préparation. Il y a quelque chose d’extrêmement émouvant dans cette approche pour ainsi dire artisanale de l’art, du métier qui s’affine avec les ans et que l’on peut admirer par exemple chez Aubane Philbert, Charline Giezendanner, Juliette Hilaire (non mais cette danseuse en vert, pleine de détails piquants) ou Allister Madin… à moins que cela ne soit qu’un biais de perception, appliqué à « ma » génération de danseurs, de quelques années mes aînés, que j’ai pour certains pu admirer de près durant les stages de danse estivaux ?
Sans même les connaître, on finit par entretenir un rapport affectif avec les danseurs que l’on suit depuis des années – un peu comme des personnages de séries, intimes et lointains à la fois. Et lorsqu’on les a connus… J’ai passé la variation d’Axel Magliano à me demander où diable dans ce gaillard hyper musclé avait disparu le petit garçon de dix ans avec lequel j’ai partagé la barre quelques années avant son entrée à l’école de danse, témoin de sa ténacité (il fallait le mettre dehors à la fin du cours) et de ses agacements (il ne faisait pas encore aussi bien que Daniil Simkin)… Toutes ces années ne se sont pas envolées ; elles se sont incorporées, dans les corps, dans les danses de chacun, et c’est ce que je trouve si beau à voir dans ce concours, et si dur aussi, parce qu’on voudrait voir chacun reconnu, chacun valorisé pour ce qu’il est et qu’il pourrait être un peu plus avec la reconnaissance. Tous les danseurs ne m’ont pas émue ; toutes les prestations ne m’ont pas plues ; ce serait mentir que de prétendre le contraire, mais j’espère qu’ils nous croient sincères quand on les remercie tous d’être là et de danser pour nous comme ils le font.