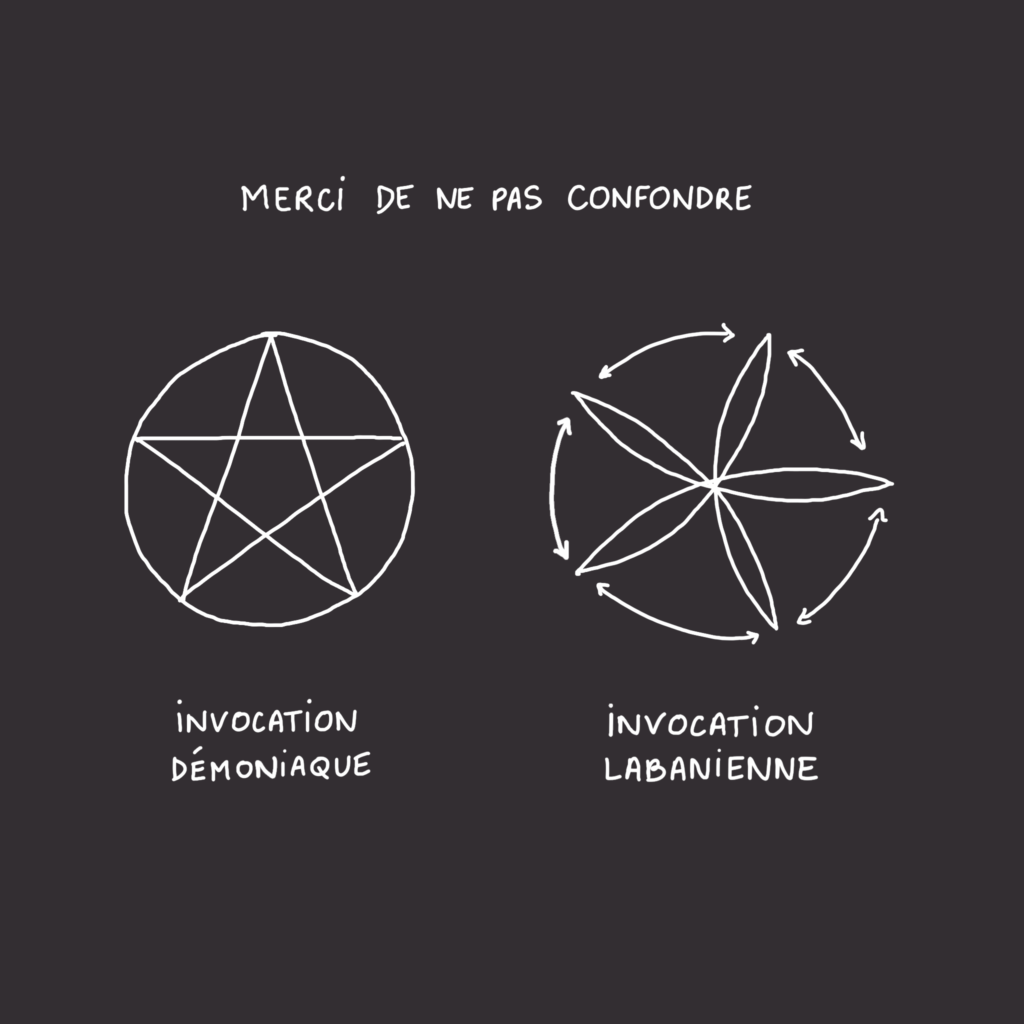Lundi 15 mai
Nous sommes censées nous donner mutuellement cours pendant 1h30, à deux dans un studio vide. Nous passons une bonne heure à parler de choix et chemins de vie. N. rayonne quand elle parle de la place du scoutisme dans sa vie. J’aime pour cela l’entendre parler de flots, jaune, rouge, vert, de parole de feu, de père spi(rituel), tout une mythologie qui m’est étrangère. Je n’y comprends pas grand-chose, seulement qu’il s’agit d’étapes, d’introspection, d’accompagnement, de cheminement, et que ça la transporte et l’interroge. Au-delà des événements, du décorum, on sent qu’elle a trouvé une communauté qui l’aide à avancer. Elle rayonne quand elle en parle, et s’ouvre, se livre, de métaphore en anecdote, un diamant dans chaque caillou, et chaque caillou unique dans le gravier.
![]()
Mardi 16 mai
La formatrice nous fait expérimenter un atelier de découverte de la danse classique. Pas de barre, pas de terme techniques de pas, mais une simple marche pieds parallèles dans l’espace, à laquelle s’ajoutent peu à peu des indications qui structurent le corps dans l’espace :
- une posture érigée,
- des bras tenus de sorte à ne jamais clore l’aisselle,
- les surfaces internes des cuisses à tourner devant soi — l’en-dehors comme l’intime qui s’offre,
- un déplacement qui se fait en croix, latéralement et d’avant en arrière — la première position au centre de cette croix,
- des ports de bras qui s’articulent autour de leur propre croix, dont le centre est également en première position (double axe couronne-bras bas & première-seconde),
- le tout à placer face à un public qu’on ne perd jamais longtemps du regard — cette contrainte superposée aux déplacements en croix fait naître les épaulements.
L’approche est intelligente. Elle éclaire Z., en tous cas, qui a pris ses premiers cours de danse classique l’année dernière, la cinquantaine déjà entamée. Faire ressortir des principes structurels avant d’entamer un apprentissage forcément un peu morcelé me semble une bonne piste pour faire débuter des adultes — les grands absents de cette formation, où la pédagogie est pensée uniquement pour les enfants.
La nuit courte n’aidant pas, j’ai du mal à maintenir mon attention lors de la conférence sur les missions des conservatoires. Le changement de politique explique certains décalages que j’avais perçus entre “mon époque” et aujourd’hui : à leur création, les conservatoires ont été pensés comme des succursales des écoles supérieures, des pépinières délocalisées pour repérer ceux qu’on formerait comme danseurs professionnels ; aujourd’hui, ils doivent remplir un service publique d’ouverture à l’art, indépendamment de ce que pourront devenir les élèves, pré-pro, amateurs éclairés ou spectateurs avertis. Je découvre avec surprise que les textes officiels préconisent des cours pour adultes débutants et des cours de composition chorégraphique pour les adultes aguerris ; je n’en ai jamais entendu parler en conservatoire.
![]()
Mercredi 17 mai
Observation d’un cours de première année de danse classique. Au bout d’un moment, il faut se rendre à l’évidence : la prof est méchante. Elle est jeune, formée à l’idée que nous sommes au service des élèves et pas les élèves au service de la danse ou du nôtre, mais ses loulous s’en prennent plein la tronche. Pas d’invective directe ou de remarque sur le physique, c’est plus insidieux : jamais rien de positif qui soit souligné, des rappels constants de ce que cela fait des mois qu’ils travaillent tel ou tel exercice, des massacres, des ohlala, des prénoms qui fusent, suivis de temps de pause théâtraux où les élèves ont tout le temps de se raidir et de se demander ce qu’ils ont bien pu faire de si terrible ; tout semble fait pour leur faire sentir à quel point ils sont nuls.
Mon seul espoir est que cette attitude soit une réaction de stress, générée par notre présence, trois apprenties profs. Que par peur d’être jugée, l’enseignante adopte une posture autoritaire, dépréciant le travail de ses élèves pourtant hyper attentives et volontaires. Je fais semblant d’y croire, souris d’excuse et d’encouragement aux élèves dès qu’il y a eye-contact.
Cela finit de balayer mes scrupules à devenir professeur de danse. Ce n’est plus une question de niveau et de compétences, mais d’attitude : je veux prendre la place des gens comme ça pour les empêcher de nuire. Je voudrais montrer que l’on peut être exigeant sans être méchant ; prendre du plaisir dans la rigueur, dans une bonne ambiance ; se réjouir de ses progrès, si minces soient-ils. Et si je ne parviens pas à faire mieux qu’elle avec les élèves (ce qui est probable : on voit toujours moins de choses quand on doit mener le cours que lorsqu’on l’observe tranquillement), du moins ne les aurai-je pas dégoûtés de la danse classique.
________
Dans le métro parisien, j’observe, je me laisse surprendre par ce que j’ignorais quand je l’empruntais quotidiennement, et que je ne remarque pas tant dans le métro lillois : l’extrême diversité des gens qui s’y croisent. J’ai l’impression de voir dans une rame l’échantillon des avatars les plus divers possibles qu’il serait possible de créer avec x formes de sourcils, nez, coupes, couleurs de cheveux et accessoirisation.
Toutes les combinaisons semblent permises, au-delà même de panoplies archétypales qui feraient tomber directement dans une case (la Parisienne du XVIe, le jeune cadre dynamique, l’ado gothique… ; en métropole lilloise : les bourgeois catho de Croix, les ados en jogging de Roubaix, les mères de famille voilées ou non, les jeunes femmes archi pimpées, cheveux gras ou laqués…).
En face-diagonale de moi, une jeune femme très belle, aux traits fins, métis je crois, joue les contrastes avec des baskets de sport blanches et un ensemble pantalon-chemisier noir, fluide, soyeux — élégant et synthétique, pourtant ; elle pianote sur son téléphone, une bague dorée à chaque pouce — sans vulgarité ostentatoire pourtant, tous bijoux assortis. J’aime qu’on ne puisse pas la classer, qu’elle ait du goût, le sien.
Dans la travée, debout, se tient une jeune femme autrement incaractérisable. Rien ne coïncide avec rien : son manteau en tissu, coupe et matière qu’on verrait bien portées par une jeune altermondialiste, a un motif bleu-noir trop discret pour cela ; il jure un peu sous son sac à main plus habillé, qui relève de la maroquinerie pour dame en caban et talons. On ne lui donne aucun âge : elle a la voix flûtée d’une enfant, mais des obligations à gérer au téléphone ; un front haut et large, que viennent distordre d’épais verres de lunettes, rendant le bas de son visage plus fluet (de faux airs de Cortex). Elle pourrait être une toute jeune femme qui fait plus que son âge, ou une femme dont l’âge aurait oublié de s’inscrire sur son visage et dans sa penderie. Je la voudrais musicienne, sans savoir pourquoi. Le sac noir, peut-être, un peu usé mais de coupe moderne : plus volumineux, il aurait pu devenir un étui à instrument.
![]()
Jeudi 18 mai
Cette fois-ci, je parviens à me brancher sur l’énergie de la ville, sans qu’elle me décharge entièrement de la mienne et me fasse sentir en terrain de jeu rabâché. Je retrouve le Paris que j’aime, le Paris où je m’oriente facilement, où l’on se retrouve de même. Où il y a toujours quelque chose à observer, dont s’amuser. Une statue antique qui fait de l’exhibitionnisme sur le balcon d’un appartement privé. Des tag amoureux sur une fontaine. Un passant avec un tote bag Bonne gueule et qui la tire. Une pancarte sur les grilles du jardin du Luxembourg rappelant aux influenceurs, influenceuses, Français, Françaises des Instagram, que toutes les photos à visée commerciale sous soumises à approbation préalable du Sénat.
Une glace de la Fabrique givrée avec JoPrincesse, après-avant promener notre discussion dans tout le Luco, les chemins détournés, réumpruntés pour prolonger le plaisir de se retrouver. Elle s’arrête un instant pour prendre en photo des arbres majestueux ; je ne les avais pour ainsi dire par vus, parce que je ne fais que dire, justement. Le reste, les arbres, le monde dans les allées, devant les kiosques de boisson, sur les quelques bandes de pelouses autorisées (une densité telle que les gens ont l’air d’attendre le début d’un concert en plein air), tout ça, je le vois sans le voir, un brouhaha estival comme dans une brume de chaleur. Je parle trop, trop vite, l’enthousiasme, l’amitié me soulèvent, le soleil revenu, j’oublie souvent de me taire, de me caler sur le calme de mon amie — qui ne m’en tient pas rigueur. Sur un banc, côté ombre ou côté soleil, je ne sais plus où on en était entre les couleurs à prendre sur les joues et le coup à éviter sur le nez, elle me dit que ce calme date de son quatrième mois de grossesse, elle l’a senti, elle aussi, ça l’a inquiétait, qui elle devenait ? Les hormones sont passées, le calme est resté, ça fait du bien, en fait. Elle a mis à distance qui elle devait, a constaté son attache à qui elle voulait, et ne s’oublie plus dans sa nouvelle vie, sa nouvelle vie qui n’a pas changé et qui n’est plus la même de n’être plus la sienne seule. Il y a une autre vie arrimée à la sienne. Elle est, ils sont deux, trois, une : famille ; elle est aussi seule à me rejoindre, à conserver notre amitié rapprochée. Elle est belle, ses yeux clairs, brillants, de tout son calme dispensé.
![]()
Vendredi 19 mai
Un banh mi mi-ombre mi-soleil, sur une table où l’on devine un échiquier, dans un renfoncement qu’on ne nommerait pas même square. Il fait beau en ville. Ça chauffe à l’arrière des lèvres.
Le boyfriend se dit qu’il pourrait venir se manger un banh mi plus souvent, il ne le fait pas s’il est seul. Ça a probablement moins à voir avec la solitude qu’avec la difficulté à marcher, qui vide la flânerie de sa substance. On ne flâne pas d’un point A à un point B. Pour moi, manger un sandwich seule en ville, aller seule au cinéma, faire seule n’importe quoi qui n’a pas à être fait, se vit comme un plaisir transgressif, une fugue qui n’inquiète personne, où je me conduis selon mon bon plaisir du moment, jolie lumière à droite, glace à bâbord, sans avoir à m’adapter à aucune autre personne ni convention horaire. C’est moi enfant, qui me dérobe à l’adulte que je suis devenue, tout en jouissant de ses prérogatives. Incartades insues.
Le boyfriend me fait découvrir le “vrai” Tang Frères, que je m’obstine à appeler Frères Tang, et que je confondais avec le Paris Store qui lui est quasiment accolé. Ça grouille de monde, c’est bruyant, désagréable, on ne trouve pas tout ce que l’on cherche… Les items manquants seront dégotés chez “mon” Frères Tang, celui plus petit tout près de la place d’Italie, auquel je venais me ravitailler quand j’habitais le quartier — fierté de propriété mal placée.
Je relève les nouvelles échoppes de Bubble Tea qui ont ouvert. La file d’attente qui se trouvait perpétuellement devant Chatime s’est déportée juste à côté : on fait maintenant la queue pour des pancakes soufflés.
Dans la rue, soudain, le boyfriend se retourne et vivement : « Oui, je te vois » — à une femme à la dérive que je n’avais pas vue, pas entendue, qui le remercie, ça fait du bien, merci, d’être vue, de voir son existence reconnue et non ignorée comme un dérangement. Elle nous avait interpellés d’un « Hey, double chignon ! » Tant que le boyfriend aura son man bun haut et moi mon chignon bas enroulé à la hâte pour prendre ma douche, je ne veux pas d’autre nom de couple, de gang : call us double chignon.
Le pèlerinage du XIIIe ne serait pas complet sans une glace à La Tropicale. Le boyfriend opte pour un sorbet esquimau, et je ris je ris en voyant sa tête s’allonger quand il engloutit le dernier bloc de glaçon citronné qui ne tient plus au bâtonnet.
Le soir, twist dans la série que nous regardons ensemble, dont je ne comprenais pas qu’elle s’appelle Mr. Robot, un personnage plutôt secondaire. Puis la joie brute, distincte du plaisir, de sa peau contre la mienne, de ses paroles tout contre moi.
![]()
Samedi 20 mai
Présentation Melendili <—> boyfriend sur fond d’éclair à la cacahuète, quiche et brownie au praliné. On a parlé d’intolérance pour des cheveux teints en rose, de Blanquer et de catcheurs habillés en dorés, de classe sociale réelle et perçue, d’encourager ses proches à aller chez le psy en repoussant d’y aller soi-même, du rapport à l’échec et de la perception d’avoir plus ou moins échoué, de campagne amsterdamoise et de Cornouailles, de mariage superflu, des chats qui grattent la terre dans le potager, du piège et de l’agrément du confort, de reconversion réelle ou fantasmée (mais souvent supportée financièrement par les proches, fin de la blague). Plus difficile encore pour Melendili : aimer son métier, mais pas les conditions dans lesquelles l’exercer.
On parle longuement, j’ai le temps d’aller reprendre une pâtisserie et de me laisser hypnotiser par les boucles d’oreilles dorées de Melendili, ondulées comme un bord de moule à tarte. Pull rayé, tonalités douces assorties, elle est classe, posée.
La parole circule et va là où elle ne serait pas allée si nous n’avions été que toutes les deux : non seulement parce que, par ignorance, désintérêt ou dépit, je fuis la politique hors période électorale, mais aussi parce que la triangulation fait surgir des remarques à la troisième personne, en passant, tiens… On parle des envies et des réticences à partir de région parisienne, des brocantes en Normandie (elle) et des marchés de petits producteurs en Touraine (lui). Melendili n’aurait pas parié que je me serais autant plu dans le Nord. Sur le mode : on ne sait jamais, tu pourrais te plaire encore ailleurs. J’objecte que la voiture tous les jours, c’est encore autre chose. Melendili par ses préférences personnelles argumente tantôt en faveur de l’un tantôt en faveur de l’autre, team du boyfriend puis la mienne. C’est un signe que la rencontre prend, quand on se ligue gentiment contre vous. Ce serait aussi un signe qu’il y ait un Paris Store à Tours, en plus du chèvre frais et de la difficulté à faire des choix, certaines plus que d’autres, ne suivez pas son regard derrière ses lunettes de soleil.
Plus tard dans la nuit, la peau presque translucide, un peu rougie autour des yeux élargis, la question de savoir ce que j’en pense, au fait, moi, du mariage. Que c’est superflu aussi, quand il n’y a pas d’enfant. Mais pas qu’il ait posé la question, tard dans la nuit.
![]()
Dimanche 21 mai
Le boyfriend se rendort sur le canapé en me tenant le mollet, tandis que je continue à bloguer. J’aime le sentir abandonné contre moi. (Je n’avais juste pas prévu qu’il serre si fort que je doive finir par dégager mon mollet sous peine de ne plus le sentir.)
Curry de quattre heures, et sommeil qui me rattrape dans le train. L’air de vacances se dissipe quand j’arrive à Lille et ressors dans Roubaix tout gris. Les fleurs roses que j’avais laissées ouvertes m’ont laissé leur souvenir en pétales sur la terrasse ; de nouvelles, rouges, ont éclos en mon absence.