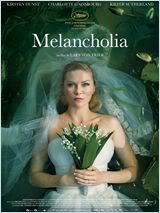La fable, le sujet et la comédie romantique
[Difficile d’analyser sans spoiler, à plus forte raison quand c’est par la fin que tout commence.]
Après quelques images de notre héroïne du jour, un compteur s’installe en bas à gauche de l’écran (un peu comme dans 500 jours ensemble, ce qui, avec l’italique bien anglaise bien niaise, m’a fait un peu peur) et entreprend de nous faire remonter le fil des ans. Vu le flashback, le spectateur se doute bien que le début du film correspond à la fin ; ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il ne s’agit pas de l’happy end de la comédie romantique mais de la fin d’une histoire amour (quand je vous disais que l’amour n’a pas de fin heureuse car l’amour heureux prend alors fin), qui ne coïncide pas elle-même avec la fin du film. Trois fins : celle de la comédie romantique, celle de l’histoire d’amour et celle du film qui n’est donc ni tout à fait une comédie romantique ni tout à fait une histoire d’amour.
Un jour, mon prince viendra
Pour remettre un peu d’ordre dans tout cela, revenons au flashback, à l’intérieur duquel la chronologie (et la comédie romantique) reprend ses droits. Emma (Anne Hathaway) et Dexter (Jim Sturgess, pas dégueu) se rencontrent après la remise de leur diplôme et, après une fin de soirée ratée où ils se couchent ensemble (tout est dans le pronominal), deviennent amis plutôt qu’amants. Malgré leur proximité suspecte et l’évident regret d’Emma, « la vie les sépare » : elle, s’enferre dans un tex-mex pourri ; lui, débute son ascension télévisée. Puis, dans leurs voies différentes, ils évoluent en sens contraire : la bigleuse s’épanouit en belle plante tandis que le roi du showbizz devient une épave. Enfin les vases communiquent, Emma constate s’être plantée avec son apprenti comique pas très drôle et Dexter est repêché par une femme sans humour qui devient sa femme puis son ex.
Les différentes époques de leur vie sont très bien identifiées : à défaut de vraiment faire vieillir les personnages, des coupes et des styles vestimentaires différents marquent le temps qui passe.
[Anne Hathaway en geekette- une fausse fausse moche]
[… et en goguette]
[Jim Sturgess en étudiant sympathique]
[… et en bogosse insupportable]
Leur amitié amoureuse survit aux aléas des vies qu’ils ont à moitié choisies, à moitié subies, entretenant chez le spectateur l’attente amoureuse du « un jour, mon prince viendra ». Puis les erreurs reconnues et la course de rigueur observée, ce sont les retrouvailles – voilà pour la comédie romantique. Ils se marièrent et n’eurent pas d’enfant. Parce que l’héroïne meurt.
Un jour noir
Retour au début du film qui, jusqu’à présent, ressemble à ce qu’Emma aurait pu voir défiler devant ses yeux avant de se faire percuter par un camion. Cette scène est ambivalente, sorte de pivot qui met successivement l’accent sur la comédie romantique (qui prend ainsi fin, encadrée par la reprise de la scène initiale) et sur le drame (qui commence). La narration du deuil (jolie scène avec l’ex d’Emma qui remercie Dexter de l’avoir rendue heureuse mais souhaite couper les ponts car ils n’ont rien d’autre à se dire – et avec l’ex de Dexter qui l’aide mais ne reviendra pas auprès de lui, malgré leur fille) suggère que l’histoire d’amour n’est pas l’histoire de toute une vie, que celle-ci déborde celle-là et que c’est à l’intérieur de son foisonnement, avec ses hasards et ses aléas, qu’on trouve les événements à partir desquels construire une histoire – un amour ou… un film. Grâce à cette poursuite du bonheur, Un jour réinscrit l’histoire d’amour dans la contingence de deux vies bien (même mal) remplies et en fait une négation de la comédie romantique, tout comme la comédie romantique se veut la négation et le dépassement du conte de fées. Dans cette course à la réalité, l’idéal est repoussé comme obstacle (il met fin aux histoires – ou alors il s’agit de L’Astrée mais c’est tellement long que je ne peux même pas vous dire si cette comparaison a lieu d’être) mais non pour mieux être sauté ça c’est l’héroïne, car il reste ce qui confère sa force à l’ensemble sinon bien prosaïque (Thomas Pavel appliqué aux romances, pincez-moi).
Un jour, autrefois
Le seul moyen d’incarner à nouveau cet idéal perdu avec l’héroïne est de ressusciter cette dernière par le souvenir. On termine ainsi par un flashback dans le flashback, qui ne nous ramène pas au début du film mais à celui de l’histoire. La boucle est bouclée à l’anglaise. Nous revoilà au temps des espoirs, lors de la rencontre dont il nous manquait un morceau. Après leur nuit amicale, les jeunes tourtereaux un peu tourte quiche échouent à nouveau à concrétiser leur désir mais cette fois, la faute incombe à des parents rentrés trop tôt ; ils échangent leur numéro et se quittent dans un baiser à la Doisneau. Voilà l’affiche et son aspect de photo sépia qui aurait dû nous prévenir de ce que le titre ne renvoyait pas à l’avenir mais au souvenir du passé, dans lequel s’ancre toute l’histoire qui a suivi. Le drame trouve dans le souvenir son apaisement et, bien qu’on se demande pourquoi l’amour esquissé bascule à nouveau dans l’amitié (ce qui rend certes plus évidentes encore leurs retrouvailles), ce jour passé nous réconcilie en même temps avec celui où le prince devait venir puisque le souvenir est placé à la fin du film, dont on est habitué à ce qu’elle livre le fin mot de l’histoire.