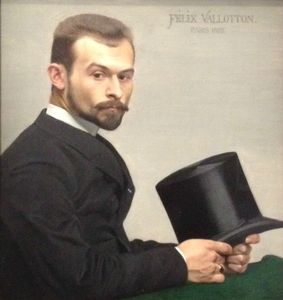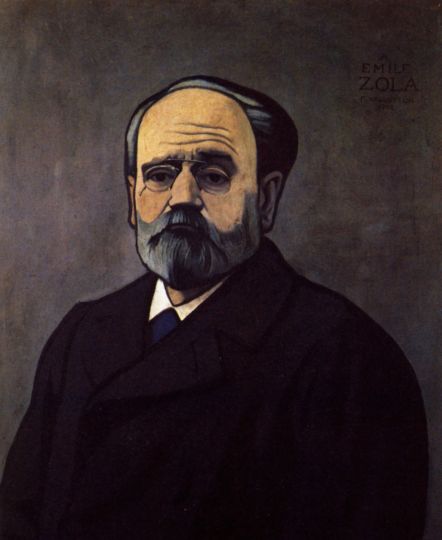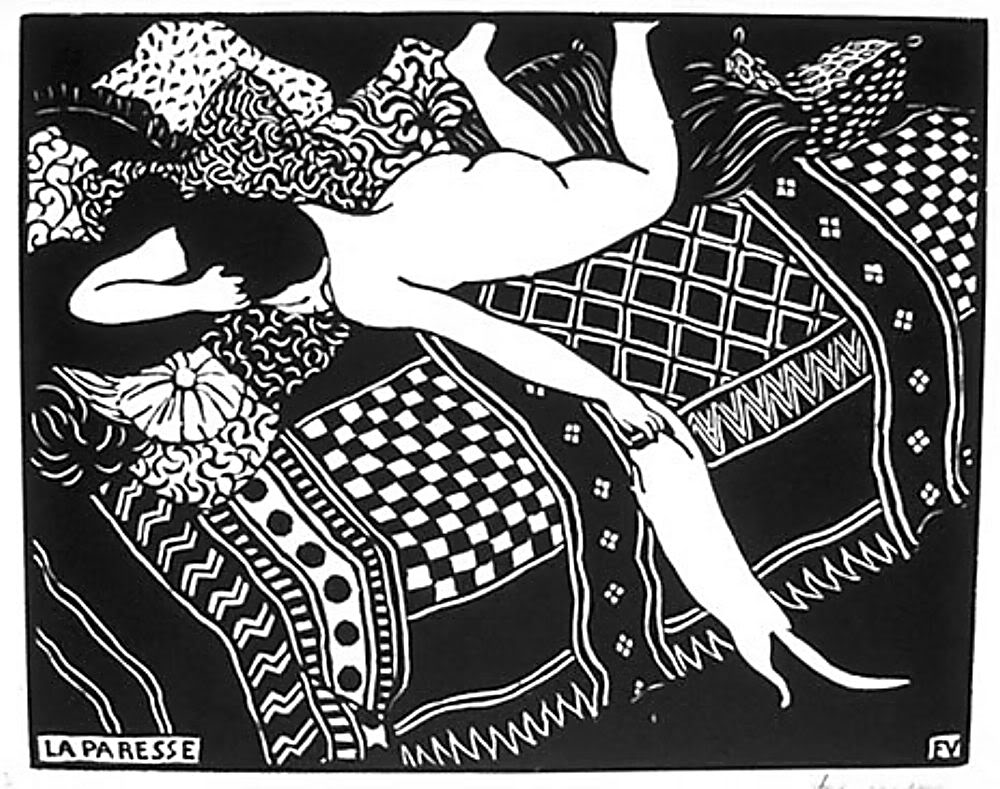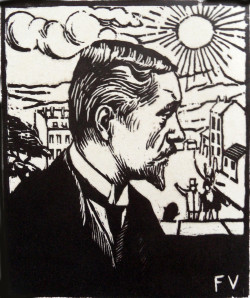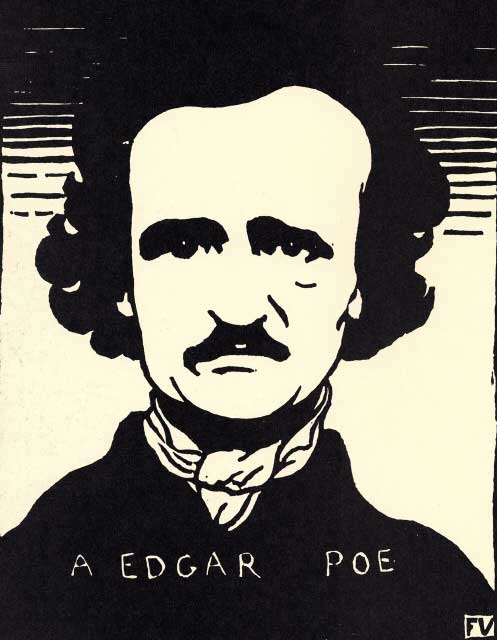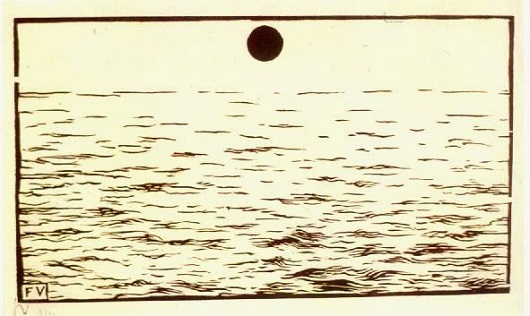Avant le XIXe siècle, un peintre a peu de chances de me plaire. S’il peint des sujets religieux, il a même toutes les chances de me déplaire. Moi et les vieilleries, ça fait deux. J’ai été biberonnée à l’impressionnisme et à l’Art Nouveau (avec un soupçon de Magritte)… et force est de constater que je n’ai pas beaucoup évolué par moi-même sur le plan pictural : j’ai pu ponctuellement avancer dans le temps (passion pour Hopper, fascination pour Richter) mais j’ai rarement voyagé en arrière, sauf peut-être pour certaines lumières (Vermeer) et clairs-obscurs (La Tour).
Sur le papier, Le Greco a donc tout pour me déplaire. Sur la toile, pourtant, c’est autre chose. La première fois que j’en ai vu une en reproduction, j’ai été saisie par son ciel orageux ; quand j’en ai détaché le regard pour chercher la légende, persuadée d’avoir à faire à quelque fauve inconnu, j’ai eu la surprise du siècle : on peut donc trouver des toiles du XVIe qui ne soient pas des vieilleries ? Intéressant, intéressant… J’ai égaré ça dans un coin de mon esprit.
J’y ai repensé en croisant l’affiche de l’expo du Grand Palais, avec sa police de luminaires de loge, que j’avais crue choisie spécialement pour l’exposition Hopper, et qui s’est tapé l’incruste depuis. Le tableau choisi est quand même un brin trop religieux pour que je songe à y aller de moi-même. Mais en me laissant porter par l’enthousiasme de Palpatine, pourquoi pas, oui ! (Heureusement que je n’ai pas soupçonné, à la taille limitée de la file d’attente, qu’il me faudrait sautiller sur place pendant une heure complète dans le froid…)
À l’intérieur, si je balaye une salle du regard, je n’y trouve pas spontanément sujet à réjouissance : des saints, des annonciations, des Christ ; ça pullule de rappels de mon manque de culture religieuse. Si je m’attarde, en revanche, si je me laisse aller à l’intérieur d’un tableau, m’y perds et parcours à n’en plus finir les mêmes méandres d’étoffe, de ciel et de chair, le sujet se dissout, simple prétexte : il n’y a plus sujet, il y a matière à réjouissance. Des traits brossés, des corps vibrants sous la caresse rude d’un regard sans cesse répété, des étoffes pures couleurs et mouvements… le saint cesse d’être Saint Truc ou Saint Machin, c’est un foyer lumineux et vibrant, un homme aux yeux agrandis pour y glisser le reflet de la larme qui ne coule pas. Le rayon lumineux qu’il peut recevoir comme signe divin n’est plus un signe mais une manifestation : la lumière, brouillonne, vive, est diffractée sur la toile comme sur un verre de caméra éblouie. Le sang du Christ n’est pas peint : ce sont des gouttes qu’on a laissé dégouliner. Et ainsi de suite.
À baigner au sein des toiles, on laisse infuser une familiarité avec les œuvres, les modèles, repris d’une toile à l’autre – une œuvre qui finit par être autoréférentielle, nous informe un cartel. Ce n’est pas seulement que Le Greco reprend les mêmes sujets voire les mêmes compositions. Ce sont les mêmes visages ou presque ; son fils, beaucoup de saints… beaucoup de visages étroits, de nez aquilins. Ils deviennent familiers, créent un univers dans lequel leurs personnages ne nous tiennent plus à distance, magnifiés-oblitérés par la lumière et la couleur (plus besoin d’utiliser le pluriel pour les pigments, couleur et lumière, c’est tout un).
J’aime beaucoup l’usage que Le Greco fait du blanc, qui avive la couleur en peignant la lumière qui la masque. Plus le blanc est opaque, plus le peintre suggère la lumière, la transparence – jusqu’à esquisser des silhouettes fantomatiques dans ses ricordi (qui en comportent tant qu’on s’amuserait presque autant que devant un tableau de Bosch). Je ne connaissais pas le principe de ces reproductions réduites réalisées par le peintre pour se souvenir de ses œuvres ou faire un geste envers un mécène (mieux que la carte postale signée par l’artiste) ; je les ai préférées aux œuvres originales en grand format : un concentré de l’esquisse comme trait nécessaire et suffisant.
A chaque fois qu’on voit « Collection particulière » sur un cartel, on se répète avec Palpatine, incrédules : quelqu’un a ça dans son salon. C’est trop gros. Ou trop fort. Je n’en voudrais pas dans le mien, même sous forme de reproduction, mais ne peux m’empêcher d’être happée par ce trait bougé, brouillon, ce sens de l’esquisse qui ne vient pas avant l’œuvre (l’esquisse préparatoire, le tableau inachevé) mais après, pour ainsi dire par-dessus le bien peint trop-bien-peint ; c’est le flou qui fait surgir l’impression nette, le pinceau qui dérape dans un excès de vie et la fait irradier du trait, du tableau.