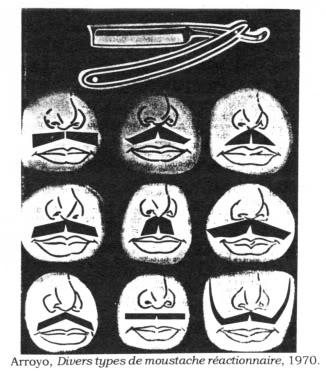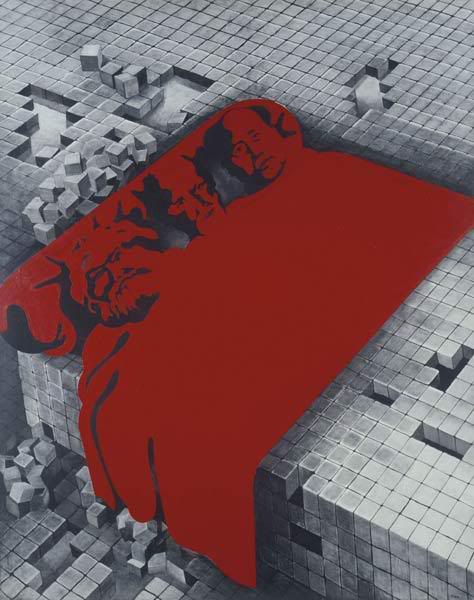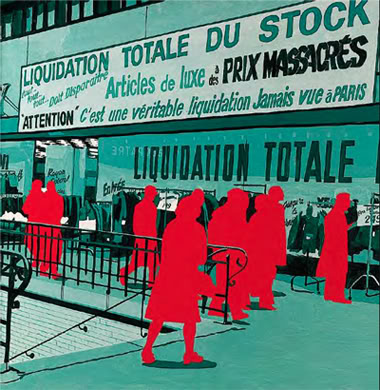Celle de Vermeer, évidemment. Celle du film, comme une évidence. L’évidence du mystère. Le film nous présente en effet une genèse du tableau, mais une genèse imaginée à parti du tableau lui-même, si bien qu’il est moins une explicitation du tableau que la mise en scène de son mystère.
Jamais l’histoire ne tombe dans la minutie fastidieuse d’une reconstitution historique, ni dans le cliché romanesque. Griet, entrée comme bonne au service de la famille Vermeer est bientôt remarquée par le peintre pour la sensibilité qui perce sous son effacement presque mutique. Il y a la vieille bonne qui la rabroue un peu mais discute avec elle et la met peu à peu au courant des affaires de la maison ; la maîtresse de maison un peu sèche et sa sale gosse, mais aussi le peintre qui la prend sous son grenier d’atelier sinon sous sa protection ; le mécène pervers qui souhaiterait être peint avec Griet pour lui en faire voir de toutes les couleurs, mais aussi Vermeer qui s’y oppose, sans pour autant que ce maître d’œuvre soit maître en toute choses. Il n’est pas vraiment libre de faire ce qu’il veut, ligoté qu’il est par les commandes que lui passe son mécène et qui doivent lui permettre de faire vivre sa famille.
Dans cette palette en demi-teintes, une étrange relation se tisse entre Vermeer et Griet. Le premier devine par instinct l’intelligence et la sensibilité de a seconde qui, émerveillée, demeure en admiration devant les tableaux. Pourtant la confiance tacite qui s’instaure (Griet se place sous sa protection, Vermeer lui confie le soin de la préparation des couleurs, tout aussi précieuses que difficiles à obtenir) n’est pas entièrement dépourvue de défiance. Pas de méfiance que le qui-vive. Une défiance latente qui fait parfois sursauter Griet lorsque le sensible glisse vers le sensuel. Lorsque Vermeer applique ses mains sur les siennes afin de leur imprimer le mouvement juste pour broyer le pigment. Lorsque appliquées tous deux, côte à côte, à la préparation des couleurs, Vermeer suspend son mélange et le gros plan de la caméra sur sa main fait ressentir l’absence d’un mouvement qui aurait pu se produire – tressaillement désireux de couvrir la main figée de Griet.
Vermeer a bien des gestes tendres et sensuels pour celle qu’il choisit secrètement pour modèle, se met dans une rage folle (mais froide) lorsqu’elle est accusée à tort d’avoir dérobé un peigne en corne, et lui fait don à la fin des perles qu’elle a portées pour poser, mais jamais le désir n’est entièrement contenu dans le registre physique. Il y a pour cela les taquineries de la vieille bonne sur les rêveries de Griet qu’elle suppute orientées vers le jeune boucher, amoureux puis bientôt amant de la petite bonne. Il y a pour cela le mécène lubrique. Il y a pour cela les pleurs de sa femme jalouse qui ne peut pas comprendre et que Vermeer doit néanmoins accepter. Il y a pour cela d’ingénieux contrepoints. Le désir (longing) qui baigne Griet et Vermeer est aussi dense et nuancé que la lumière de ses tableaux – aussi délicat et réel. Le désir de l’art, peut-être.
Tout le film est là pour nous y rendre sensible. A travers sa propre mises en scène, ses éclairages étudiés, son cadrage, son montage. A travers également des indices égrainés comme les cailloux du petit poucet. On ne cherche pas en effet à entrer par effraction dans l’esprit du peintre (et tout juste l’ose-t-on dans son atelier) : celui-là est toujours en retrait, comme pour signaler que l’on a affaire au personnage social et que l’artiste doit être cherché autre part, dans ses tableaux. On nous fait bien plus entrer dans le monde de Vermeer, suivant le point de vue émerveillé de Griet. Le spectateur ré-apprend l’étonnement et la surprise devant des toiles qui ont finit par s’incruster aux décors publicitaires. Comme Griet, on découvre sans jamais apprendre la couleur des nuages (blanc ? du jaune, du bleu et du gris), l’élaboration d’un tableau (par aplats successifs de couleurs, comme des calques sous Photoshop), la matière des couleur (le préciosité du bleu en lapis-lazuli), la composition et l’importance que peut prendre une chaise ou le reflet essentiel qu’introduit une perle dans le coup d’un portrait.
La perle : cet élément indispensable dans la composition du maître l’est tout autant dans celle de l’intrigue. Entre l’esthétique et le social, elle réunit dans sa boucle le portrait et le bijou (appartenant à la femme du peintre, qui ne doit rien savoir de cet emprunt) et murmure à l’oreille du spectateur des vagues inaudibles mais cependant assez nombreuses pour composer peu à peu l’arrière-plan de tout une époque. Et au-delà de leur dédoublement réel-représenté dans le moment de la peinture, ces perles sont également, lorsque, renvoyée, Griet les reçoit néanmoins en souvenir, le trait de (dés)union entre la simple bonne qu’elle demeure et l’univers bourgeois qu’elle a côtoyé, à qui semblait réservé le privilège de la peinture, lors même que d’autres auraient été plus à même de l’apprécier comme œuvre d’art.
La perle, enfin, nous sort de cette merveilleuse fiction en redevenant une note distante mais aiguë dans le tableau de Vermeer que nous pouvons contempler aujourd’hui au Rijskmuseum (transcription phonétique des plus approximatives). Ouvert sur un titre de légende, le film se referme sur le tableau puisque, si stimulante soit-elle pour l’imagination, l’œuvre est indépassable. Laissant l’histoire derrière lui, prête à être oubliée, le spectateur peut alors entrer dans l’univers d’un artiste.