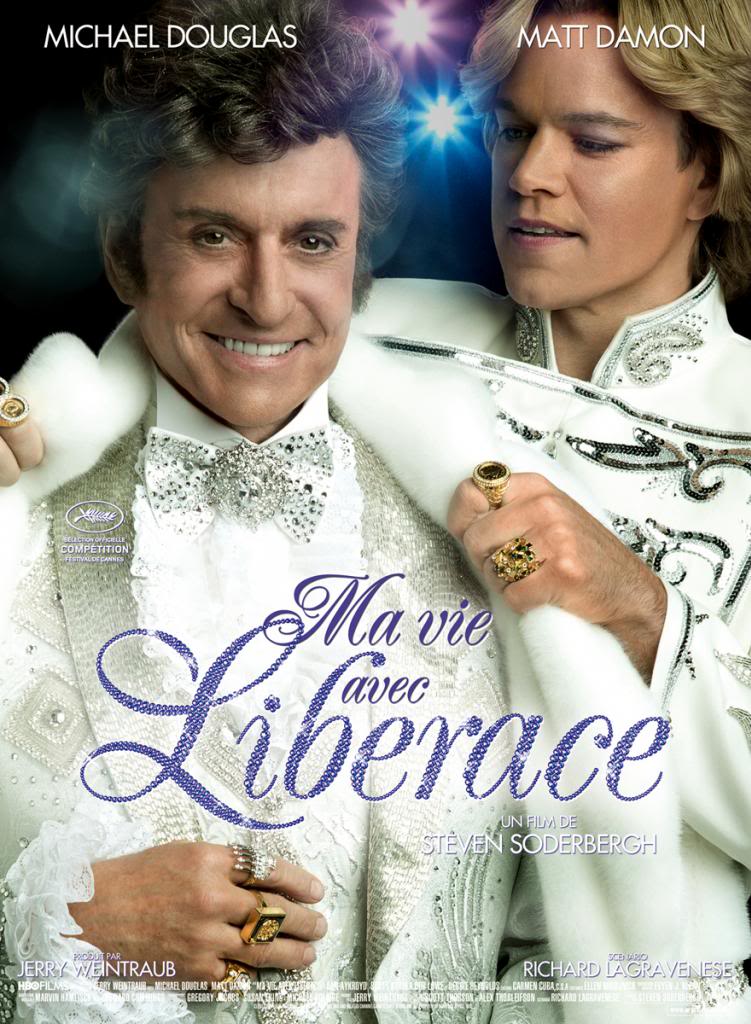Ce film n’est pas crédible : les lycéennes y sont davantage maquillées à l’eye-liner qu’au crayon ; les cours de littérature sont menés comme des leçons de vie sans figure de style par un prof à la voix rocailleuse de baroudeur ; une grande adolescente fait des spaghettis bolognaise avec des tomates achetées au marché.
Ce film est affreusement crédible : le mec mignon et gentil à qui plaît Adèle n’a lu qu’un livre dans sa vie et confond madame de Merteuil et la présidente de Tourvel ; le mec mignon et gentil à qui plaît Adèle ressemble étrangement à mon premier crush ; sa bande de copines veulent savoir si elle a couché avec et Adèle n’arrête pas de tirer sur ce qui n’attend que la validation de Kétamine pour être appelé un bun de pétasse ; Adèle fait une fixette sur Emma, qui est en histoire de l’art et a les cheveux bleus ; Emma s’y connaît en philo : y’a Sartre et sa philosophie de l’engagement, qui plaît toujours aux lycéens, toujours partants pour participer à une manifestation (plus tard, ils sauveront le monde tous les dimanches mais en attendant, c’est plus fun de louper les cours) ; une camarade d’Emma, qui trouver Klimt « fleuri » prépare une thèse sur la morbidité chez Egon Schiele. C’est fou ce qu’on est arrogant quand on a dix-sept ans – et pousse. Je ne dis pas forcément que c’est passé à vingt-cinq ans, hein, seulement qu’on est déjà en mesure de se rendre compte que c’était bien pire avant. Marivaux, Laclos, Sartre, Klimt… le réalisateur ne nous en épargne pas un, tous assénés avec le plus grand discernement – celui de l’ignorance pédante et enthousiaste de la découverte.
D’une manière générale, La Vie d’Adèle ne fait pas dans la dentelle. Et vas-y que je te serve des huîtres. L’huître, le sexe féminin, l’homosexualité lesbienne : vous y êtes ou vous voulez qu’on vous resserve ? Abdellatif Kechiche filme comme pensent les ados : en gros. Gros plans. Les visages grossis des centaines de fois par la projection donnent au film un aspect un peu surréaliste, qui seul l’empêche de sombrer dans la romance mièvre. De fait, tout le film repose sur le jeu des actrices (n’allez donc surtout pas voir ce film si vous ne pouvez pas voir peinture Léa Seydoux ni, à plus forte raison, Adèle Exarchopoulos). Gros plans sur le visage d’Emma, gros plan sur le visage d’Adèle, gros plan sur les larmes d’Adèle, gros plan sur la morve d’Adèle, gros plan sur la bouche d’Adèle (qu’elle soit en train de sourire ou de manger), gros plans, gros plans, gros plans, jusqu’à l’écoeurement – surtout quand la salle comble ne vous a pas laissé d’autre choix que le deuxième rang. On se demande comment Adèle peut encore avoir du désir pour Emma quand on est en tant que spectateur à ce point gavé de morceaux de chair, de joue, de bave, de cuisses, de fesses, de seins. Le désir est un regret, le constat d’une absence : il faudrait, pour lui laisser une place, mettre un peu de distance entre la caméra et les corps car on ne voit plus rien dans ce monceau de morceaux, et les scènes de sexe, quoique peu nombreuses, en paraissent un brin interminables.
On voudrait nous faire croire à la passion mais la fringale des sens n’est pas franchement suivie par celle de l’esprit, entre Emma, trop sûre de ses connaissances pour vouloir apprendre quoi que ce soit, et Adèle qui ne se consacre plus qu’à Emma, laquelle lui donne des cours de philosophie à la Pangloss. À force de tout voir en gros plans, ils agissent comme des oeillères et il devient difficile d’élargir son horizon. L’obsession tranquille d’Adèle pour Emma ne laisse que peu de place à leurs univers respectifs. On a d’un côté celui d’Adèle, où les cheveux bleus, comme l’homosexualité, passeraient mieux avec une boîte de Quality Street et où l’on s’inquiète d’avoir une situation stable – pour faire des spaghettis bolognaise –, et de l’autre celui d’Emma, où la passion pour la créativité engendre le mépris de ceux qui manquent d’ambition (artistique) et où la liberté des mœurs est une dénonciation du puritanisme – gaussons-nous et avalons donc quelques huîtres pour fêter ça. On dirait un exposé sur la réception de l’homosexualité selon le milieu social et familial. Au final, le tableau est un peu terne : les deux univers qu’il peint ne sont assez opposés – ni pour aller à la confrontation ni pour susciter une préférence. La relative sagesse d’Adèle, qui choisit de construire son bonheur avec ce qu’elle a (Emma et les enfants dont elle devient l’institutrice), est rapidement mise à mal par son manque d’estime de soi, qui l’empêche de passer à autre chose le moment venu. On a beau savoir que l’on peut être aussi pathétique (et merde, encore une boîte de mouchoirs de flinguée), on n’a pas franchement envie qu’on nous le rappelle on commence à trouver le temps long : la maturité tarde à venir dans la vie de cette fille dont le film couvre pourtant sept ou huit années. Alors on vous dira mieux que moi la soif, l’avidité de savoir, de sexe et de vie de la bouche perpétuellement ouverte d’Adèle. Il n’empêche, l’air empoté d’Adèle finit par ne plus me faire penser qu’à une chose :
Adèle, mouche-toi et ferme la bouche, tu vas gober les mouches.

Pendant ce temps, Palpatine joue à l’apprenti sociologue.