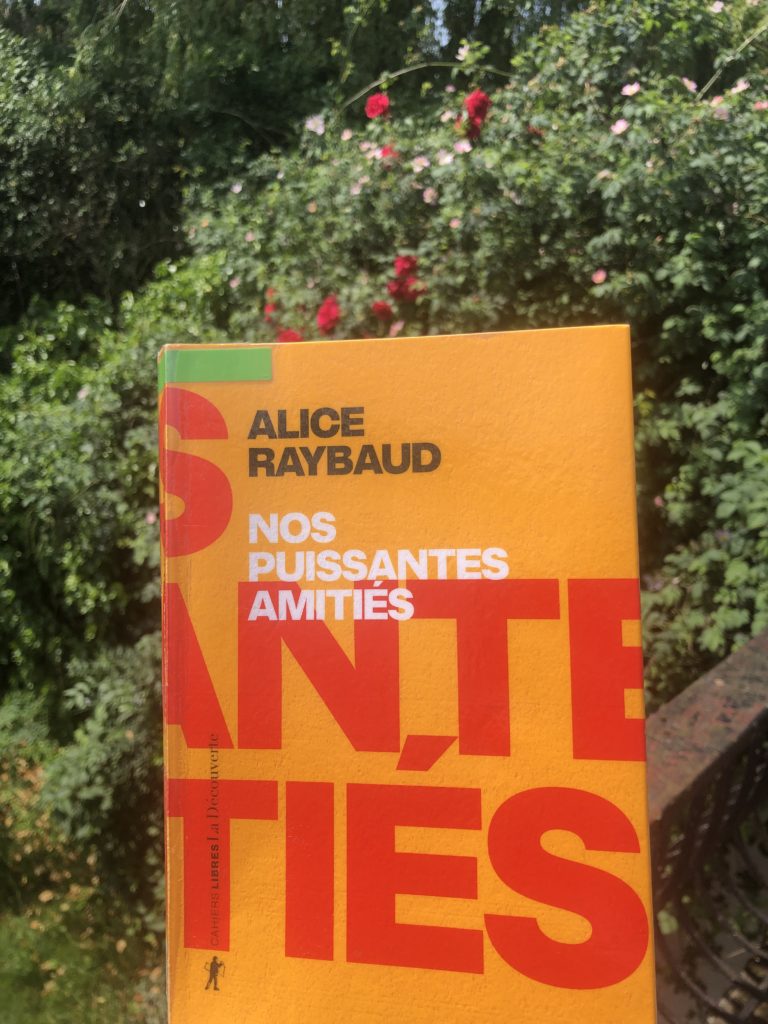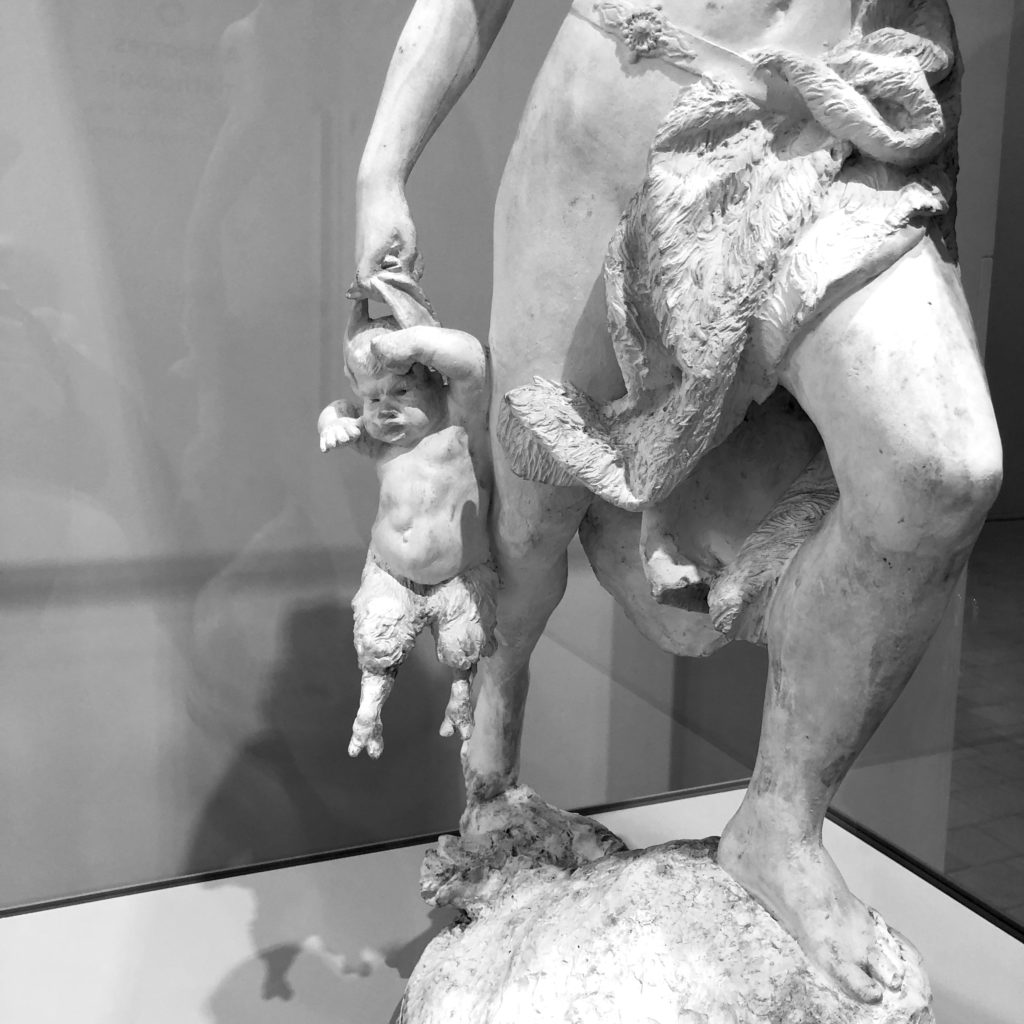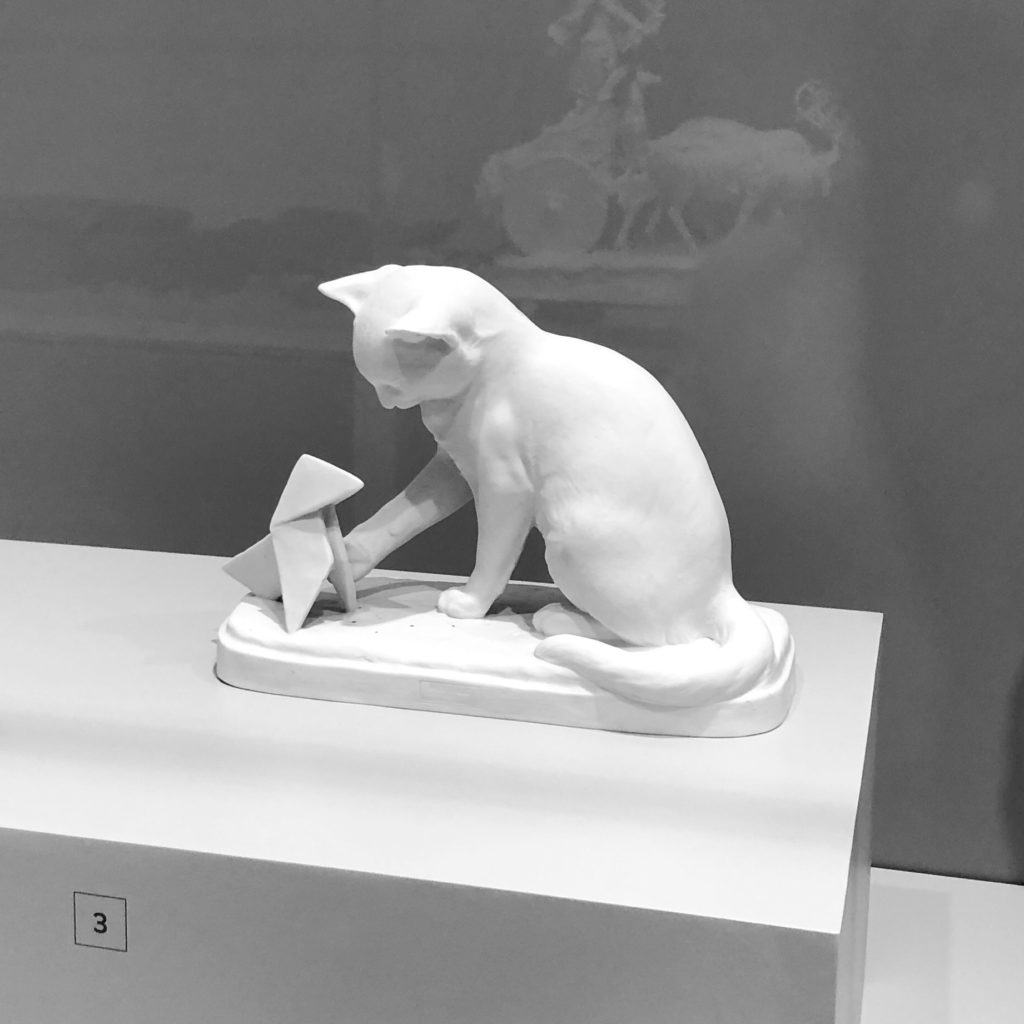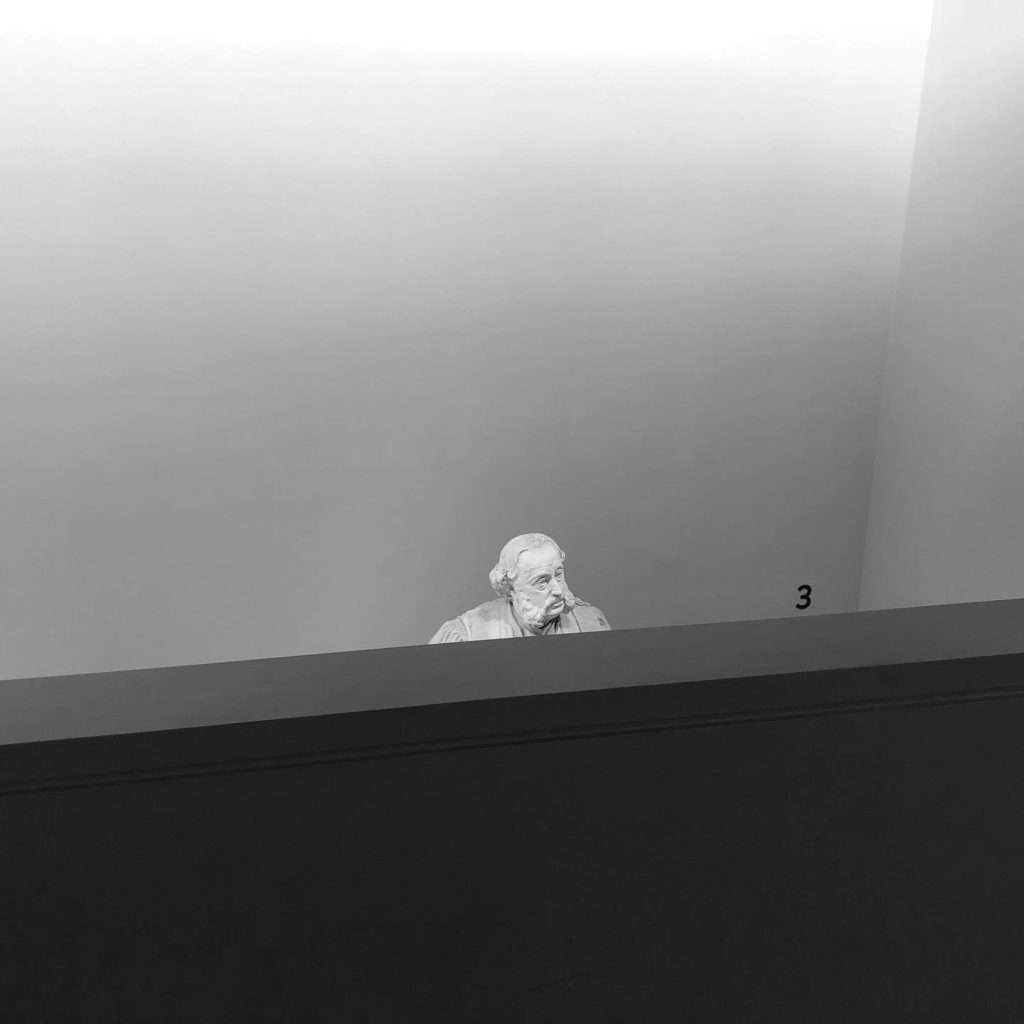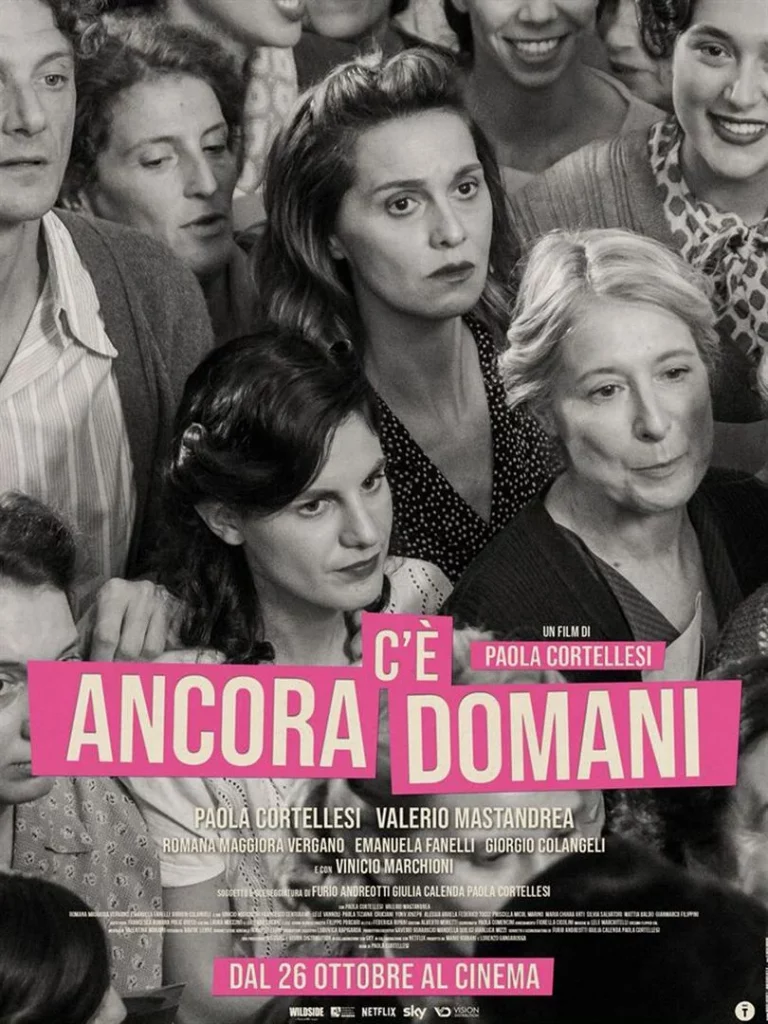De part et d’autre d’une nuit, j’ai lu Nuits de noces au pluriel, le destin en mots simples, en lignes légères pourtant chargées d’amour et de violence, de la mère de Violaine Bérot, narré à la première personne :
Depuis la disparition de mon père, j’assiste, impuissante, à la douleur de ma mère face à la disparition de cet homme follement aimé, qu’elle avait il y a très longtemps arraché à l’Église.
Leur histoire, je la connais surtout par elle qui l’a toujours racontée.
À partir de son interprétation, mais aussi de mes propres observations d’enfant puis d’adulte, j’ai voulu donner à entendre combien fut bouleversant de côtoyer de si près leur explosif amour.
Très vite m’est apparue cette évidence : il me fallait écrire depuis sa place à elle, ma mère, aussi incestueux que puisse paraître ce geste.
J’ai eu peur que cette première personne incestueuse perturbe ma lecture,
puis j’ai oublié,
puis j’ai compris,
Œdipe-Elektra qui évince et redonne place à une mère qui a craint de n’être plus que ça,
une mère,
et qui souvent s’y est refusée, cabrée, cassante.
Pour réparer être sa fille,
écrire à la place de la mère :
Parfois
ces enfants
je leur en voulais.
Mais j’anticipe.
Avant, il faut lire le destin, la défroque,
la gratitude d’un amour désintéressé, qui devient absolu,
qui devient fou,
qui devient mauvais, par peur de perdre qui est si bon,
les mots simples,
encore plus puissants
d’être si simples,
irréductibles.
J’ai trouvé ça follement beau,
alors je vous livre le squelette de cette histoire
à travers ces passages qui m’ont
…
qui font une histoire
qui ferait un formidable ballet,
comme celui que je n’ai jamais (qu’)imaginé
après la lecture de Mademoiselle Else.
J’espère que vous trouverez ça aussi beau que moi,
que vous irez lire la suite, l’avant, l’entre, les interstices.
Et j’ai pensé à toi, Dame Ambre,
que je ne connais pourtant pas,
j’ai pensé à toi dans ces histoires d’enfance, d’héritage,
de peur qui rend mauvaise,
et d’amour qui répare.
Chaque passage entre les points de suspension colorés appartient à un chapitre distinct, dont aucun n’est reproduit en totalité, loin de là.
![]()
Dix-neuf ans et demi j’avais
pas même vingt
et pourtant l’absolue certitude
l’instantanée certitude
lui
lui et aucun autre
lui, l’homme interdit
l’homme de messe
pour moi
rien que pour moi.
![]()
Pourtant à lui
au prêtre
à lui
en parler
je ne sais pas pourquoi
je ne sais pas comment
en parler c’est venu
c’est venu tout seul
de dire le père
les coups du père sur la mère
à lui, le prêtre
c’est venu naturellement
de pouvoir enfin en parler.« Je vais t’aider »
il a seulement ditEt ses yeux sur moi
ses yeux au tout dedans de moi
ses yeux jaunes
au plus profond de moi.Je vais t’aider
et j’ai compris
je vais t’aimer.
![]()
Mais je voulais
que tout seul il le comprenne
je voulais que l’homme-prêtre
découvre de lui-même
effaré
émerveillé
son erreur
qu’il réalise
que Dieu et la Très Sainte Institution
non
mais moi
moi.
![]()
J’en devenais folle
et je hurlais
plus fort que ne hurlait mon père
de ne pouvoir jamais
cet homme
ni le voir ni le toucher
car le toucher enfin
le toucher
oh mon Dieu, toucher cet homme-là.Cette peau
gaspillée
à ne pas le laisser s’en servir.Cette peau
rien qu’à vous
consacrée
pauvre Dieu
qui n’en saviez rien faire.
![]()
Et soudain
la lettre.Celle dans laquelle
il me l’annonçait
officiellement
me le demandait
« veux-tu
devenir
ma femme ? »Et alors
ne plus
savoir
comment
on fait
pour
respirer.
![]()
Pas une simple nuit
mais une kyrielle
de nuits de noces
et se moquer
que ce soit la nuit ou le jour
et bien loin de la date des noces.
![]()
Fallait-il que je sois sotte
moi qui pour rien et avec personne ne voulait plus le partager
fallait-il que je sois sotte
de vouloir des enfants
qui feraient de lui leur père
et me le voleraient
[…]Or
le voir père
lui
le voir père aimant
voir ce que c’est
un père
sans le coups
comprendre enfin ce que c’est
un père.Lui
que tous avant appelaient
mon père
cela me mettait les larmes aux yeux
qu’il soit mainteannt
seulement pour nos enfnats
leur père.
![]()
[…] je ne le reconnaissais plus
et ça me rendait mauvaise
mauvaise autant que mon père […]Nos enfants
me voyaient crier
puis ne me voyaient plus
ces enfants dont je ne voulais pas m’occuper
ne plus être leur mère
![]()
Mais
il suffisait
que sa main
ses doigts
se posent sur moi.Il suffisait de cela
sa peau sur la mienne
ses yeux jaunes
pour que s’envole la panique
et l’angoisse
et la peur.
![]()
Mais j’ai ce putain de sang
de mon père et du père de mon père
ce putain de sang
[…] je prie pour que dans les veines de nos enfants
ne coule que son sang à lui
son sang de messe
rouge et joyeux.
![]()
Car l’avais-je imaginé cela
à dix-neuf ans et demi
vieillir auprès de lui
petite vieille et petit vieux
main dans la main
à nous faire de chastes baisers
[…] par l’un à l’autre réclamés
par l’autre à l’un donnés.