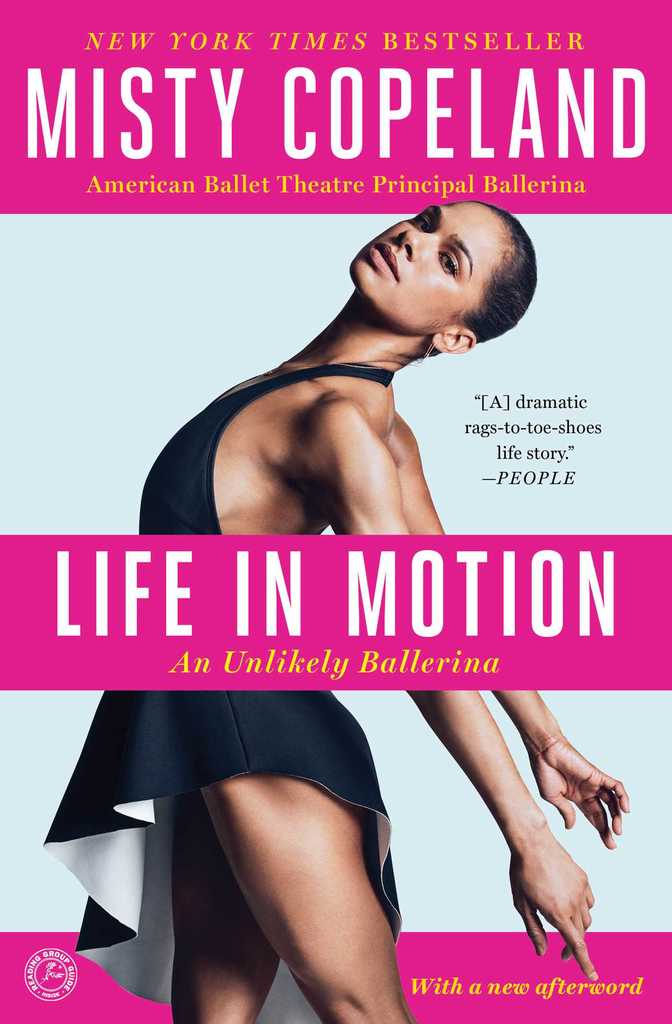Impressing the Czar revisite l’histoire de la danse classique, paraît-il. Cela commence donc à la cour du roi ou du tsar, ou dans un hôtel, on ne sait pas bien, il n’y a plus de cacahuètes, seulement un bric-à-brac doré pour tout indice baroque (tentures-peintures, fauteuil, arc, flèches…). La scène, divisée en deux, comporte une plateforme dorée à carreaux qui évoque de loin l’échiquier du pouvoir. Dans cet espace morcelé, les messieurs portent ou tombent la redingote (marque intemporelle du passé, qui donne toujours beaucoup d’allure, il faut bien l’avouer), les femmes des robes de bal, sauf une, habillée en Kylian-like, sauf deux en assistantes-de-la-Défense, et leurs homologues masculins en cravate, et ceux qui reviennent en scène, là, et Mr Pnut, qui fait peanuts dans son pagne imprimé faune, tous abdominaux dehors, véritable parodie de Roberto Bolle – l’inspiration de la statuaire, sans doute. Mais s’il est Apollon, la mise en scène est certainement dionysiaque : un chaos organisé, où il y a toujours quelque chose à regarder, toujours quelque chose à zapper. Des bribes d’autres chaînes nous parviennent d’ailleurs, conversation téléphonique avec la réception, news d’Obama à Trump, et une histoire de cerises que Mr Pnut voudrait acquérir.
On retrouve lesdites cerises dans le tableau suivant, dorées comme un fruit des Hespérides, suspendues au milieu, quelque peu surélevées : In the Middle, Somewhat Elevated. À peine les remarque-t-on lorsque la pièce est donnée seule : c’est une petite touche d’espièglerie, voilà tout. Dans Impressing the Czar, le détail devient l’aiguille qui dégonfle comme une baudruche le morceau de bravoure. À moins que ce ne soit l’exécution sommaire des danseurs – et des danseuses, surtout, danse en force et physiques compacts (sauf une, grande). Je m’étais déjà fait la réflexion que la pièce fonctionne mieux avec des physiques longilignes, qui prolongent d’autant plus le mouvement. Mais cela va au-delà, comme le confirme cette danseuse élancée, qui manque étonnamment de souplesse dans le tronc, alors que ses jambes nous assurent que, non, elle n’est pas raide. Il manque à mon goût un chouilla d’élasticité dans le mouvement et la musicalité (les crashs sonores déchirent souvent des gestes déjà entamés ou gâchent la surprise de ceux qui arrivent avec une fraction de retard). Ce n’est pas bien loin, pourtant : il suffit qu’une danseuse sur pointe défie le déséquilibre en ramenant sa jambe au ralenti pour que ça s’électrise. Retour à la terre, fin du frisson. J’avais un meilleur souvenir du Semperoper Ballett Dresden dans cette pièce : il jouait la nonchalance là où le ballet de l’Opéra de Paris joue la provoc, et ça marchait. Là… ça danse, c’est sûr.
Que faire après avoir mené le ballet à son paroxysme, au bord de la dislocation ? Deux trajectoires possibles. La première est de revenir au classicisme : c’est la position actuelle de Forsythe, qui s’emploie activement à remonter ses anciennes pièces (et quand je dis activement, j’entends qu’il est resté debout derrière moi pendant tout le spectacle, à débriefer en live avec son compère). Le Forsythe de l’époque choisit l’autre option : il continue dans la dislocation et met aux enchères les oripeaux dont il a débarrassé le ballet. On ne sait pas trop à quoi ça rime, pas même la commissaire-priseur prise au dépourvu. Une métaphore, peut-être ? Personne ne répond ; Forsythe surenchérit. Poussé à bout, le ballet n’est plus ? Eh bien, dansez maintenant.
La danse classique est morte, vive la danse. On revient au cercle primitif, à mi-chemin entre danse de la pluie sioux et débandade disco, le pouvoir dionysiaque amplifié par l’unisson de toute la troupe. Bongo Bongo Nageela. À côté, Blake Works, c’est peanuts : les jupettes et les déhanchements de la création étaient bien sages par rapport à cette bacchanale d’écolières des deux sexes (qu’on croirait sorties de Dah-dah-sko-dah-dah). Les hommes, travestis, sont peut-être ceux qui s’en donnent le plus à cœur joie, relevant allégrement les jupes qu’ils n’ont pas d’ordinaire : écolières gone mad.
Et le tsar, dans tout ça ? Probablement comme deux ronds de flan, la mâchoire Tex Avery. Ou alors tout sourire en coin, mi-amusé mi-indulgent.
Et vous, quel genre de tsar Forsythe fait-il de vous ?