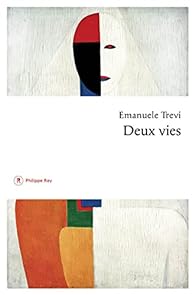 Deux vies, d’Emanuele Trevi : ma première lecture de 2024… et un article resté en brouillon depuis près d’un an. J’avais croisé Emanuele Trevi dans La Librairie sur la colline d’Alba Donati ; le retrouver par hasard sur une étagère de la médiathèque dans la même collection que l’excellent L’Allégement des vernis m’a semblé un signe. Je l’ai emprunté.
Deux vies, d’Emanuele Trevi : ma première lecture de 2024… et un article resté en brouillon depuis près d’un an. J’avais croisé Emanuele Trevi dans La Librairie sur la colline d’Alba Donati ; le retrouver par hasard sur une étagère de la médiathèque dans la même collection que l’excellent L’Allégement des vernis m’a semblé un signe. Je l’ai emprunté.
Les deux vies en question sont celles de deux amis de l’auteur… que je n’aimerais pas avoir pour ami. Il a l’amitié âpre. Difficile de déceler de la chaleur dans les portraits qu’il dresse devant lui, devant eux, comme un étrange miroir, témoin scrupuleux plus que complice. Je ne peux pas vraiment dire que j’ai aimé l’ouvrage qui en résulte, l’affection ne relève pas du vocabulaire adéquat, mais l’écriture m’a retenue ; il y a de ces dissections de la psyché et de ses mystifications tortueuses…
![]()
Quand à être heureux, c’est
terriblement difficile, exténuant.
Cela équivaut à porter en équilibre
sur sa tête une précieuse pagode
de verre soufflé, ornée de clochettes
et de fragiles flammèches,
et à continuer d’accomplit heure après heure les mille
mouvements obscurs et pesants de la journée
sans qu’un seul lumignon s’éteigne,
qu’une seule clochette émette une note fêlée.
Lettre de Cristina Campo (citée en exergue)
C’est comme une antithèse à l’expression de Simone de Beauvoir ; on pourrait n’être pas « doué pour le bonheur ».
![]()
Please meet Rocco :
Drue et compacte, la masse inamovible de ses cheveux paraissait modelée et peinte sur sa tête, comme celle des marionnettes.
Toute fantaisie, jusqu’aux innocents losanges d’un pull-over, lui causait de l’embarras, m’a-t-il confié un jour.
L’efficacité de la description. Le mec te taille un costard-jacquard en deux deux. Et ne lésine pas sur la névrose :
Il avait une soif désespérée, dirais-je, du sens exact des mots, purifiés de toute leur ambiguïté […]. […] Rocco s’efforçait obstinément de simplifier, de nettoyer. Si l’anatomie humaine l’y avait autorisé, il aurait volontiers astiqué ses os et ses serfs à l’aide d’une brosse en fer.
Évoquer le vie de Rocco signifie nécessairement évoquer son infélicité et admettre qu’il appartenait à la troupe prédestinée des individus nés sous l’influence de Saturne.
Néanmoins, cette constellation de faits positifs, ou du moins normaux, se disposait autour d’une espèce de trou noir, capable d’absorber en son centre toute son énergie vitale, la transformant en un mal d’exister lourd, inerte, désespéré, qui l’amenait à voir dans l’avenir la répétition irrémédiable d’un présent insupportable. Il était assailli par des nuées de pensées, pareilles aux sauterelles de la malédiction biblique, dont il ne réussissait en aucune façon à se libérer.
![]()
À côté de ce Rocco torturé, il y a Pia… et quelques préjugés sexistes qui transparaissent. Pour notre auteur hétérosexuel, Pia est une « créature enchanteresse », forcément appréhendée par sa beauté ou son absence.
Pia, cette charmante ‘demoiselle anglaise’, si séduisante qu’elle n’a jamais semblé regretter la beauté qui lui faisait défaut […]
Elle était plutôt un être intense, dotée d’une âme réceptive et sensible, encline à l’illusion, se vexant facilement.
Difficile de ne pas soupçonner une pointe de rancœur inconsciente de n’avoir pas été considéré comme amant, même si rationnellement, évidemment, c’est beaucoup mieux comme ça, il n’est pas de la même étoffe que la « vermine » de Pia — terme apparemment utilisé par la principale intéressée pour ironiser sur ses choix amoureux peu judicieux.
Heureusement il y a de la malice dans le portrait de la « demoiselle anglaise »,
une sorte de Mary Poppins à l’envers, en rien pédagogique, dotée de dangereuses réserves d’incohérence et de susceptibilité étrangement associées à une douceur de caractère que son attitude ironique et malicieuse trahissait parfois de manière émouvante.
Cela sautait aux yeux, Pia était une créature bizarre, absolument non conformiste, un véritable trésor dans le désert social et la prison des convenances intellectuelles. Ainsi, tout en étant occupée par d’austères travaux de traductions de vieux textes religieux, tels que la Vie de l’archiprêtre Avvakum par lui-même, elle aimait écrire des scènes de sexe d’une façon très désinvolte, c’est-à-dire sans rien estomper quand ses personnages en venaient au fait. Comme toutes les personnes intelligentes qui s’efforcent de dénicher un équivalent crédible au sexe, elle optait parfois pour des moyens qui relevaient davantage de la pornographie que de l’égotisme hypocrite et bon marché qu’on trouve dans tant de romans pour dames, lesquels sont le seul lieu au monde où les bites se transformant en « membres » et autres agréments de ce genre . […] l’érotisme n’est autre qu’une censure adoucie par les lieux communs du racolage.
(Les scènes de sexe sont vraiment des passages casse-gueule dans les romans. Il faudrait une anthologie du pire et du meilleur.)
![]()
Quelques considérations sur la disparité des souvenirs et des traits humains, qui rend l’exercice du portrait si intéressant et difficile :
De manière inexplicables on associe à la photographie l’idée d’immortaliser, mais c’est une façon de parler erronée : plus que tout, la photographie, inexorablement liée à l’instant et au présent, nous rappelle notre nature transitoire et futile.
Plus on s’approche d’un individu, plus il ressemble à un tableau impressionniste, ou à un mur écorché par le temps et les intempéries […]. Si l’on s’éloigne, en revanche, ce même individu se met à ressembler excessivement aux autres. La seule chose qui importe, dans ce genre de portraits écrits, est de chercher la bonne distance, qui est la marque de l’unicité.
// La bonne distance pascalienne. // On n’y voit rien arassé. // Le monstrueux qui naît de trop de perfections rassemblées en un seul visage chez Théophile Gauthier, les traits qui s’entrechoquent, symptôme de la jettatura.
Par quel mystère enfermons-nous tant de traits aussi inharmonieux et contrastés, à l’image de vieux tiroirs où les objets s’entrassent en vrac sans le moindre critère ?
Un souvenir isolé peut être parfaitement gai et insouciant, comme une marguerite qui s’ouvre entre deux gelées.
![]()
Back to Rocco
[…] l’écriture stimulait chez lui deux de ses talents les plus dangereux et les plus destructeurs : l’art de se tourmenter pour des motifs futiles et celui d’être déçu par son prochain.
Plus tard seulement, alors qu’il n’était plus de ce monde, nous avons été nombreux à nous rendre compte que ces polémiques, ces entêtements […] étaient un moyen d’occuper le centre de l’attention et de réclamer cette affection dont il se croyait toujours créditeur. Il lui était impossible de percevoir une affection silencieuse et privée de manifestations tangibles. Et si le prix de ce qui lui était indispensable consistait à culpabiliser les autres alors qu’ils se sentent coupables !
Nous croyons être malheureux pour une raison ou pour une autre, sans nous rendre compte que c’est justement l’infélicité qui produit en permanence son théâtre de causes, lesquelles ne sont en réalité que des masques qu’elle adopte, et nous passons une bonne partie de notre vie — pas toute, espérons-le ! — aux prises avec des problèmes apparents : sentimentaux, créatifs, économiques…
![]()
Les deux vies ont pris fin quand l’auteur s’attaque à leur portrait, deux morts qui ont leur propre violence, Roco décédé dans un accident de moto, Pia à la suite d’une maladie neurodégénérative. Peut-être que ce livre est un hommage en même temps qu’un pillage. Peut-être que leur rendre justice, c’était de ne pas les épargner.
[…] lorsqu’elle parle d’une maladie, la littérature se contentera de la transformer en une maladie sans nom, la seule qu’on puisse proportionner dignement à cet unique entrelacement de destin et de caractère, de contingence et de nécessité, qui donne vie à un personnage.
Rocco avait trouvé une façon de se tenir à l’écart des gros problèmes ; l’infélicité et la joie de vivre avaient repris leur rythme acceptable de systoles et diastoles.
[Nous dépensons de l’énergie] pour repousser d’obscures menaces, pour chercher un équilibre instable entre des forces contraires, pour fuir le destin que nos parents ont souhaité pour nous. Nous ne nous en rendons même pas compte, pourtant, lorsque nous nous sentons fatigués, nous ne devrions pas songer uniquement à ce que nous avons fait, mais au travail obscur de soustraction et de renoncement que nous coûte notre propre consistance en état de veille ou de sommeil.
[…] la volonté de s’installer à la campagne, lorsqu’elle n’est pas dictée par une nécessité pratique incontournable, m’est toujours apparue comme une automutilation délétère. J’ai beau passer la plupart de mon temps enfermé chez moi, j’ai besoin de savoir que la ville est là, dehors, avec son enchevêtrement infini de possibilités et de désirs, de mauvaises odeurs et de beautés involontaires, et j’ai tendance à attribuer aux autres mes propres besoins.
Si elle n’était plus en mesure de prendre soin de son jardin, c’était le jardin maintenant qui prenait soin d’elle. Exactement ainsi : il l’attendait, non comme les morts, dit-on, attendent les vivants, plutôt comme un véhicule apprêté devant la porte […].
Pia Pera est entre autres l’autrice de Ce que je n’ai pas encore dit à mon jardin.
![]()
Les deux vies du titre apparaissent p. 106 et ne désignent pas celles de Rocco et Pia :
Parce que nous vivons deux vies, toutes deux destinées à s’achever : la première, la vue physique, est faite de sang et de souffle ; la seconde se déroule dans la tête de ceux qui nous ont aimés. […] pendant que j’écris et tant que je continuerai à écrire ces lignes, Pia est ici, sa présence est aussi encombrante que la table à laquelle je suis assis, ou que la lampe.
encombrante… le choix de cet adjectif est assez emblématique de cet étrange rapport de l’auteur à ses amis.
[…] l’écriture est un moyen singulièrement approprié pour évoquer les morts et je conseille à tous ceux qui ont la nostalgie d’un être cher de s’y exercer : ne pas penser à lui, mais composer un écrit à son sujet ; on le constate vite, le défunt est attiré par l’écriture, il trouve toujours un [je n’ai pas photographié la page suivante, où se terminait cette phrase — le défunt trouve toujours un moyen de se manifester à nous, j’imagine, nous rappeler de lui des choses que l’on croyait avoir oubliées]

 Je ne prends plus aucun passage en note ensuite. N. devient de plus en plus méprisant parce que méprisable. L’inverse aussi, méprisable parce que méprisant. L’humour noir ne fait plus rire mais grincer, puis dégoûte et lasse. Le lecteur alors est mûr pour l’escalade, l’accident puis le meurtre délibéré. Le juge d’instruction nous récupère. Journal refermé, la trajectoire exemplaire est décapée de son ironie littéraire, devient très littéralement un exemple parmi tant d’autres de violence.
Je ne prends plus aucun passage en note ensuite. N. devient de plus en plus méprisant parce que méprisable. L’inverse aussi, méprisable parce que méprisant. L’humour noir ne fait plus rire mais grincer, puis dégoûte et lasse. Le lecteur alors est mûr pour l’escalade, l’accident puis le meurtre délibéré. Le juge d’instruction nous récupère. Journal refermé, la trajectoire exemplaire est décapée de son ironie littéraire, devient très littéralement un exemple parmi tant d’autres de violence. Le titre est beau. Il m’attire, comme m’attire le mélange d’essai et de récit à la première personne. Ça commence bien entremêlé, puis Julia Kerninon tire si fort le fil que soudain je me demande comment j’en suis venue à lire une biographie de Gertrude Stein. On finit par s’éloigner, on divague et ça se précise, je crois.
Le titre est beau. Il m’attire, comme m’attire le mélange d’essai et de récit à la première personne. Ça commence bien entremêlé, puis Julia Kerninon tire si fort le fil que soudain je me demande comment j’en suis venue à lire une biographie de Gertrude Stein. On finit par s’éloigner, on divague et ça se précise, je crois.



