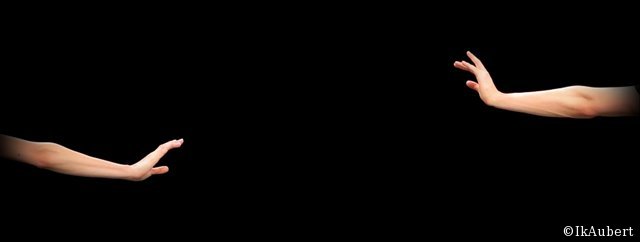La semaine dernière, j’ai reçu une mention de @phildethrace, à Chaillot, totalement perplexe devant le Nederlands Dans Theater. J’ai bien ri, parce que Phil, c’est le mec qui m’avait fait croire qu’Alban Richard serait aussi canon que lui. Passé le petit instant de vengeance personnelle, j’ai été bien embêtée : j’ai pointé quelques passages, des mouvements qui me semblaient névralgiques mais Phil n’est pas novice, il les a vus, comme moi. Il a vu les lettres des Mémoires d’oubliettes (Jiří Kylián) glisser des mots pour en former d’autres, plus bas, aux résonances souterraines, et à leur suite, la scène devenir un puits d’inconscient, où tout ce qui tombe revêt un éclat particulier, fussent des canettes argentées1. Il a vu les mouvements organiques de Solo Echo (Crystal Pite), cette masse humaine qui entraîne, éjecte, rattrape, malaxe et pétrit les danseurs qui la composent. Il a vu les décors tournants de Shoot the moon (Sol León et Paul Lightfoot), qui tantôt empêchent tantôt permettent au danseurs de se retrouver dans la même pièce, circulant dans ce manège d’appartement pour mieux revenir sur leurs pas.
Qu’y a-t-il à expliquer à quelqu’un qui a vu tout cela ? On peut éduquer son regard mais non forcer sa sensibilité esthétique. Les journalistes peuvent agiter tous les thèmes qu’il veulent (au premier rang desquels la solitude et l’impossibilité de communiquer, qui passent bien auprès de la foule des spectateurs habitués à la communication, aussi bien culturelle que commerciale), si on est sourd à une œuvre, on conclura qu’elle ne nous parle pas. Cette surdité me met toujours le doute lorsque je suis, moi, tout ouïe : y a-t-il quelque chose à entendre ou suis-je en train de lire sur les lèvres, croyant comprendre ce que j’ai tant de fois entendu et que l’œuvre n’articule en rien d’une nouvelle manière ? Rencontrer cette surdité chez quelqu’un aux goûts opposés aux miens me rassure pourtant : elle est la garantie de ce que l’œuvre n’est pas si neutre que cela (qu’elle est œuvre, en somme), puisque certains s’y retrouvent et d’autres pas. Et elle préserve le doute lorsque, à mon tour, je n’entends rien et suis prompte à incriminer l’œuvre plutôt que moi.
Il n’y a donc rien à ajouter que des souvenirs qu’il me plaira de me remémorer : les immenses doigts de la plus grande des danseuses (Myrthe van Opstal), dont j’ai mis un certain temps à m’apercevoir qu’il s’agissait de prothèses, tant ils la rendaient sexy ; la neige qui est tombée sans discontinuer, apaisant la crainte que l’on a de la voir cesser et les grouillements des danseurs, qui, sous la tranquille pluie de paillettes neigeuses, deviennent partie intégrante d’un mouvement organique infini, reposante agitation ; les motifs des papiers peints, baignés dans une lumière lunaire où surgissent les angoisses folles de vies bien rangées, par ailleurs bien vécues, emplies de désirs qui tuent le temps. C’était beau, voilà.
1 Des canettes, oui, vous avez bien lu. Le pire, c’est que c’était magnifique, sorte de geyser lunaire inversé. Kylian nous rappelle ainsi que la drogue est en vente libre aux Pays-Bas. Et c’est de la bonne. (J’ai d’ailleurs cru au retour des momies.)