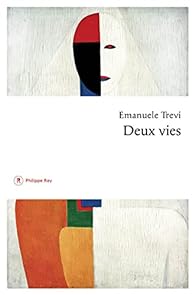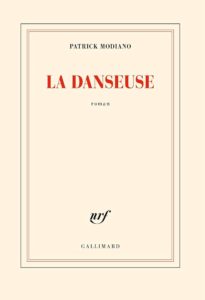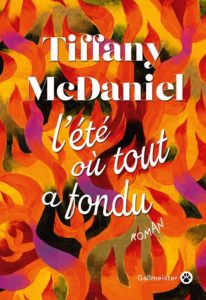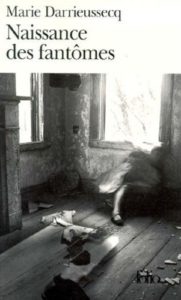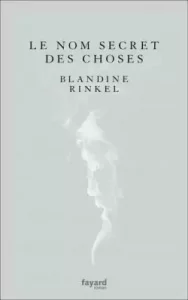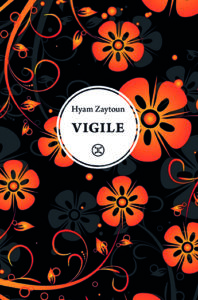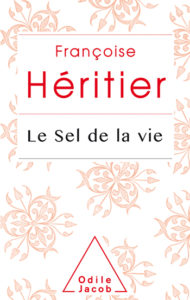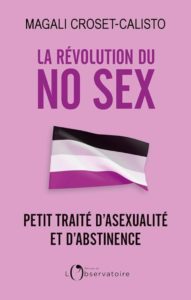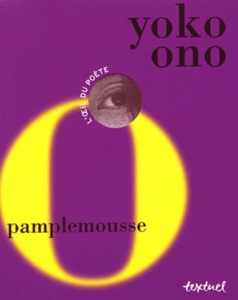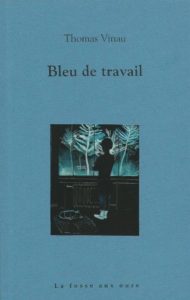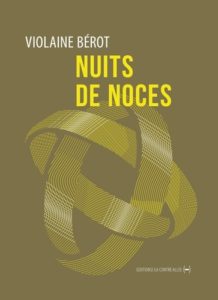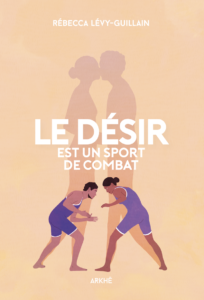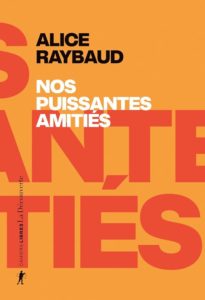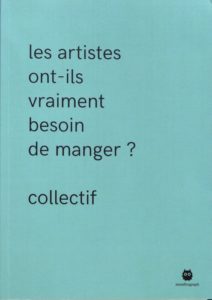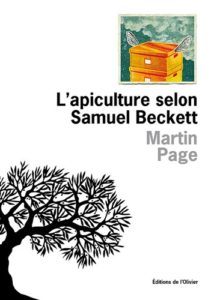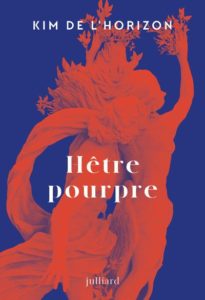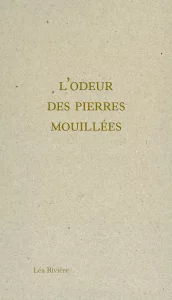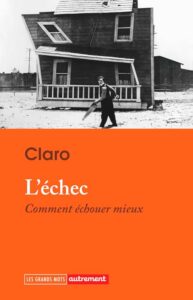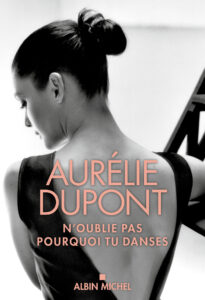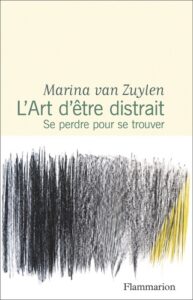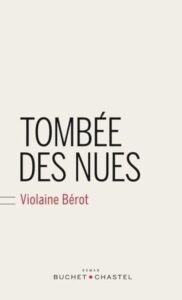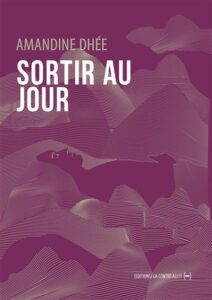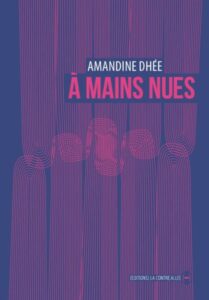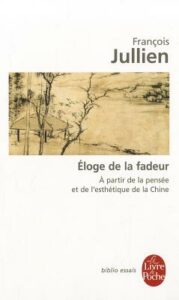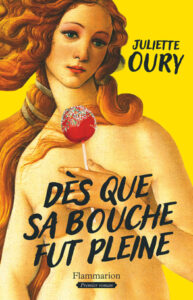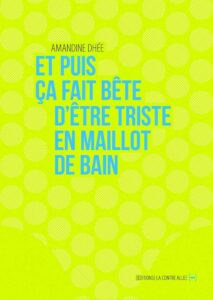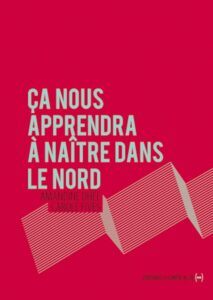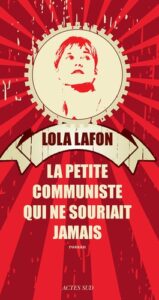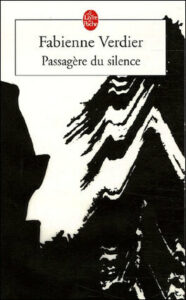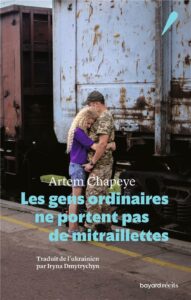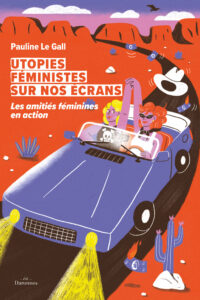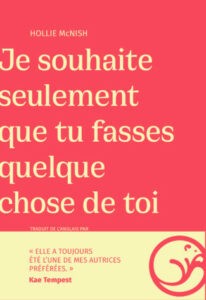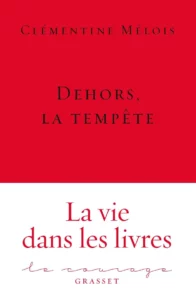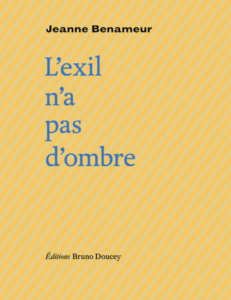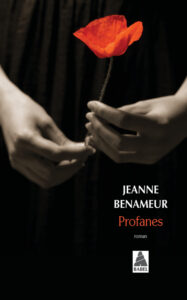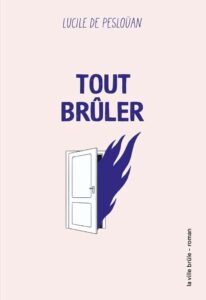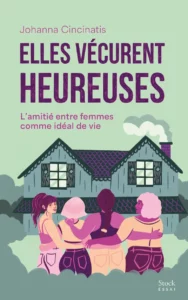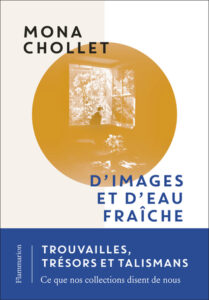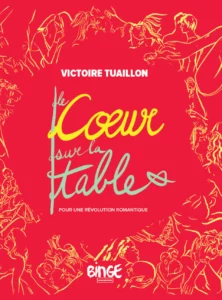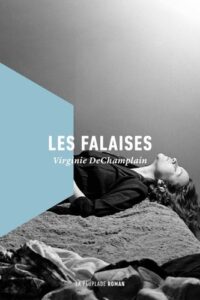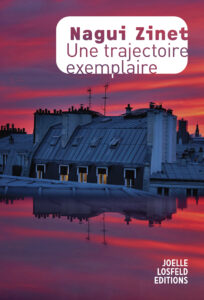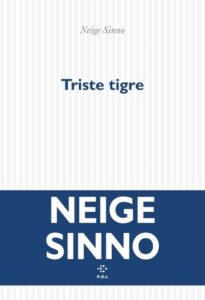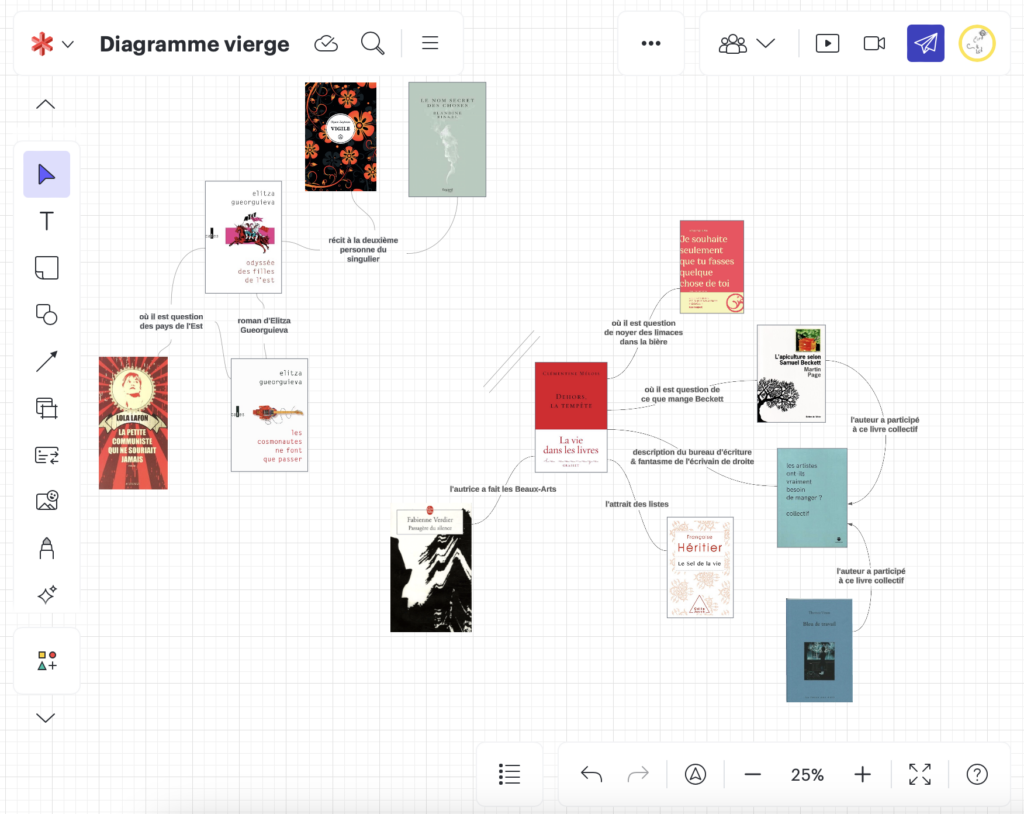La dernière moisson de médiathèque aura été de trois essais pour un roman (mais un pavé de 600 pages, ça équilibre), inversant la vapeur de cette année pour l’instant très fictionnelle.
![]()
De grandes dents, enquête sur un petit malentendu, de Lucile Novat
Lu en dernier, commenté en priorité : j’ai déjà déversé mon enthousiasme-admiration pour cet improbable essai sur les contes, l’inceste et son tabou.
![]()
La Voyageuse de nuit, de Laure Adler
Certaines thématiques s’incrustent dans mes lectures sans que je sache pourquoi. À côte de l’inceste (un roman-poésie, un texte littéraire et l’essai susmentionné, plus un épisode dans le pavé de ce mois-ci), la vieillesse serait presque un sujet fun. C’est en tous cas le mood qui émane de La Voyageuse de nuit : l’autrice adore son sujet et compte bien nous montrer que la vieillesse est sous-côtée.
Quand j’ai mentionné ma lecture au boyfriend, il a fait la moue : Laure Adler… Je n’ai pas trop compris sur le moment, dans l’enthousiasme de toutes les chouettes références littéraires que je retrouvais ou découvrais. Puis j’ai avancé, l’essai pas trop. Les biais ont commencé à me sauter au visage : la vieillesse, ça peut être une période de vie si libre… tant qu’on échappe à la maladie… quand on est un artiste de classe moyenne ou supérieure… L’essayiste évacue le vieillissement de la vieillesse ou le minimise en piochant dans le vécu des intellectuels (de son cercle de connaissances) qui, pour sûr, ont continué à jouir de leurs facultés sous leurs cheveux blancs. Mais c’est quoi, la vieillesse, quand on n’a pas été d’une catégorie socio-professionnelle privilégiée ? Quand le corps ou l’entourage ne suit plus ? Ah oui, c’est vrai, faisons donc un rapide tour des Ephad pour saluer le travail déconsidéré des aidants et dénoncer la mise à l’écart des vieux par la société. Ouf, nous nous sommes engagés.
La Voyageuse de nuit offre une chouette collection de références et citations que j’ai la flemme de recopier, mais pour un propos incarné, je continuerai de lui préférer Tout ce qui nous était à venir.
![]() L’empathie est politique, de Samah Karaki
L’empathie est politique, de Samah Karaki
L’essai n’est en soi pas difficile à lire, mais il est rugueux. Je m’aperçois à son contact que j’ai l’habitude de lire des critiques littéraires, philosophes, sociologiques — essayistes qui ont tous une sensibilité littéraire. Samah Karaki, elle, est scientifique de formation et son écriture sans fioriture ne facilite pas l’entrée dans les détours de la pensée. On comprend toujours, mais cela ne coule pas de source, il faut suivre, faire effort.
Je ne vais pas faire de fiche de lecture en reprenant les diverses étapes du raisonnement fort bien articulé et des biais déprimants qui y sont mis à jour (genre plus l’empathie est forte pour un « nous », moins on en a pour « eux » — quand ce n’est pas carrément de la Schadenfreude). Outre ce que j’en ai déjà rapporté dans mon journal (preuve que ça me taraudait), j’ai surtout envie de garder une trace de la dernière partie « Contre le regard empathique ». L’autrice n’est pas contre l’empathie dans l’absolu, cela n’aurait pas de sens, mais contre sa domination / son utilisation dans la sphère médiatique et politique — car l’empathie, en plus d’être biaisée, dépolitise. Paradoxalement pourtant, ce qui m’a marquée dans ces pages, ce n’est pas tant la prise de conscience politique à laquelle elles appellent, que l’éclairage qu’elles m’apportent sur des gênes très personnelles. Encore que le passage du politique au personnel, aussi regrettable soit-il, n’est pas si paradoxal que ça ; il est même en cohérence avec la démonstration de l’autrice. Empathique, je tire jusqu’au bout la couverture à moi.
L’empathie, c’est l' »impéralisme du même » (elle emprunte la formule à Levinas). On se met si bien à la place de l’autre qu’on annihile sa spécificité, on l’objectifie en le réduisant à sa souffrance, souffrance que l’on s’approprie avant de l’écarter quand on juge que c’en est assez — pouvoir choisir à quel moment on détourne le regard est en soi un privilège.
Ainsi, contrairement aux idées reçues, dans l’empathie, on reste isolé et seul en tant qu’individu : isolé dans son cerveau, ses affects, ses automatismes et ses réflexes culturels.
Phénomène inhérent à une position de pouvoir et de domination, le regard empathique transforme et consomme la souffrance pour en faire des expériences esthétiques.
[…] ce tourisme émotionnel dépolitise les doléances et les transforme en spectacle perpétuel.
L’empathie, en provoquant parfois une crise psycho-existntielle chez la personne qui l’éprouve, devient un outil de développement personnel.
C’est ainsi que plutôt que d’être un phénomène qui pourrait conduire à une action, l’empathie plonge l’empathisant dans son propre affect et dans sa détresse personnelle. En cela, l’empathie est une expérience égocentrique.
Bien agir face à la différence ne consiste donc pas à chercher à savoir et à comprendre, mais à supporter le fait de ne pas savoir ni comprendre. […] Dans l’empathie extimisante, il ne s’agit plus seulement de s’identifier à l’autre, ni même de reconnaître à l’autre la capacité de s’identifier à soi en acceptant de lui ouvrir ses territoires intérieurs, mais de se découvrir à travers lui différent de ce que l’on croyait être et de se laisser transformer par cette découverte.
Après ces prises de conscience bien déprimantes, l’autrice nous donne quelques espoirs avec des leviers pour contrebalancer les biais de l’empathie (ce sont des titres de sous-parties) :
- rompre avec les cadres hégémoniques (les médias mainstream qui confortent nos biais empathiques) ;
- accepter la culpabilité et la honte (se laisser transformer et pousser à l’action par ces émotions désagréables plutôt que de les fuir) ;
- développer une connaissance critique et historique du monde — car cette connaissance informe (façonne) nos affects :
La connaissance de l’expérience de l’autre et de son histoire « produit » de l’empathie. […] L’empathie n’est plus l’origine du comportement moral, mais en est la conséquence.
L’empathie s’engouffre dans nos biais : à nous de travailler à les réduire pour que nos affects s’expriment de manière plus altruiste. C’est, je pense, le sens du sous-titre, sur lequel j’ai bugué à chaque fois que j’ai fait une pause dans ma lecture et que je continue de trouver mal formulé : « Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments. » Les normes sociales façonnent les sentiments empathiques, ok, ou interagissent avec la biologie des sentiments, mais c’est justement parce que la biologie est ce qu’elle est que l’empathie se modèle à partir de nos connaissances et de nos biais, en offre pour ainsi dire une cartographie. Dis-moi pour qui tu éprouves de l’empathie, je te dirai à quel(s) endogroupe(s) tu appartiens.