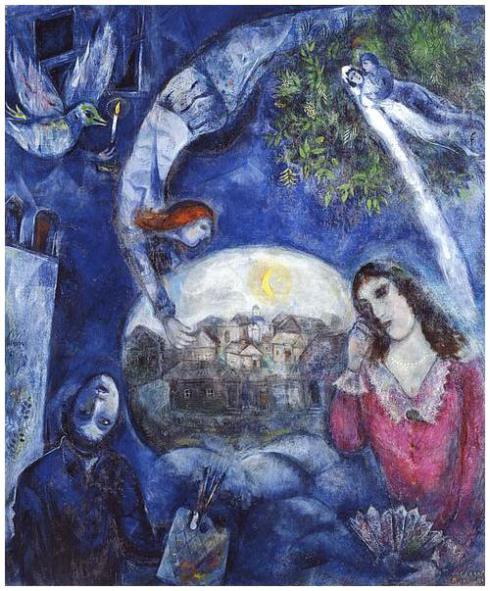Pour ne pas être déçu, mieux vaut ne pas envisager Shirley comme un film mais comme une exposition – une exposition de tableaux entre cinéma et peinture, où Gustav Deutsch reprend les compositions d’Edward Hopper. Pour conserver les perspectives faussées et fascinantes du peintre, le réalisateur a fait construire des objets de taille et de forme improbables, qui perdent toute crédibilité passé un certain angle. Les œuvres originales commandant le cadrage, la mise en scène reste relativement statique et les tableaux s’animent lentement, comme des GIF planants : un rideau ondule, la lumière varie, on perçoit la rumeur de la ville.
Une voix off traverse l’espace comme les pensées vous traversent l’esprit lors d’une exposition – sauf qu’il s’agit de celles de Shirley, prénom sous lequel Gustav Deutsch a unifié divers personnages féminins de Hopper (qui provenaient eux-même d’une inspiration commune, la femme du peintre). Ce monologue intérieur ne s’apparente pas au stream of consciousness ininterrompu des héroïnes littéraires ; ce sont des bribes qui laissent imaginer, avec d’immenses ellipses, ce que pourrait être la vie de Shirley, traversée par un compagnon et des pièces de théâtre. Si l’on entend le nom d’Elia Kazan ou que l’on devine la Dépression en arrière-plan, le contexte politique et social reste cantonné à quelques nouvelles radiophoniques diffusées entre les tableaux, sur écran noir. L’agitation du monde, suggérée, s’amenuise aussitôt pour nous faire entrer dans le tableau suivant – habile manière de réintroduire le hors-champ, essentiel aux cadrages du peintre, sans pour autant abolir la distance. Les tableaux sont comme autant de parenthèses qui, inscrites dans le contexte d’une époque, valent pour elles-mêmes, pour le moment de suspension qu’elles incarnent. Fidèle à leur origine picturale, les tableaux cinématographiques restent des temps de pause – de pose quasi-photographique. Le tableau se développe, il infuse, et l’image se forme et se déforme au ralenti sans que l’on parvienne à fixer le moment où la peinture se trouve reproduite.
On promène le regard sur la toile sans jamais trop savoir si c’est davantage celle de l’écran de projection ou celle d’un tableau, la frontière s’amenuisant à l’extrême dans la scène du cinéma lorsque Shirley, croyant sentir la présence de son mari défunt, se retourne sur un siège vide où les coups de pinceaux sont visibles. On dirait le regard du spectateur qui, s’étant appesanti sur un trait de peinture, a perdu la vision et l’a ravalé à une forme qui n’est plus rien. Rien ne sert d’observer la surface pour elle-même, mais il est également inutile de chercher à voir derrière (l’envers du décor) ou à côté (hors-champ), inutile de sortir de la peinture et du cadre fixé par le peintre : c’est la forme qui fait sens.
Shirley est dans une chambre, un livre de Platon à la main, et des ombres d’oiseau glissent sur le mur derrière elle : cette évocation poétique du mythe de la caverne rappelle que le cinéma est lui aussi affaire de projection – une illusion qui n’est pourtant pas à rejeter car, même dévoilée, elle continue d’opérer. C’est là sa force : on ne peut pas s’abstraire de l’illusion, on ne peut qu’y consentir, accepter d’avoir des visions de réalité et que l’illusion, se donnant comme réalité, lui donne sens. Le personnage de Shirley, comédienne, secrétaire, ouvreuse de théâtre, redouble l’illusion : les multiples vies qu’elle endosse sont-elles des rôles, une immersion pour préparer des rôles ou des boulots alimentaires ? Ou tout ça à la fois, comme dans le hall d’hôtel où surgit un fantôme de King Kong alors que Shirley répète un texte : rôle de comédienne dans la pièce ? matérialisation de l’imaginaire ?
On a des visions, on entend des voix. Quasiment pas de dialogues, contrairement à ce que le métier de Shirley pourrait laisser supposer. Une voix, surtout, seule en scène, qui nous laisse surprendre des bribes d’un monologue intérieur qui se dérobe. Ces bribes laissent imaginer, avec d’immenses ellipses, ce que pourrait être la vie de Shirley, et ces ellipses rendent justice aux peintures, si promptes à entraîner l’imagination : elles sont les entractes dont on aime imaginer les actes. Le film n’est pas un de ces scénarios, plutôt une évocation poétique de la puissance narrative contenue chez Hopper. Il ne raconte, ne dépeint pas d’histoire à partir des personnages ou des décors, mais célèbre cette peinture de l’entr’acte.
On ne se demande pas ce qui va se passer, mais comment le temps va passer (et rien ne va survenir). Ici, la profondeur, c’est le temps, matérialisé par des mouvements infimes. Un objet, une lumière, un grain de peau suffisent à donner du relief. Stephanie Cumming, a comédienne qui incarne Shirley, a une une présence incroyable, présence au monde sensuelle et sensible, à fleur de peau… Autant dire que je n’ai pas été outre mesure surprise en apprenant qu’elle est aussi danseuse. Elle parvient à faire passer des rares instants de ressentis : la distance d’avec l’homme qu’elle enlace, dans son fauteuil ; la tension érotique qui s’installe dans la distance lorsque, pour la première et la dernière fois, elle pose pour son mari photographe : l’œil familier, en l’objectivant, devient soudain étranger – elle est saisie à distance, comme une proie amoureuse ; et d’une manière générale, le flottement dans lequel se font les retours sur la manière dont on vit sa vie…
Un cinéma de tropisme en quelque sorte, tout en suspension. Même le suspens est en suspens et le drame du film, pour beaucoup de spectateurs, c’est qu’il n’y en ait aucun. Je me suis ennuyée, moi aussi, mais le film s’apprécie avec son ennui. Quelque part, c’est parce qu’il y a de l’ennui que Shirley est réussi, que la peinture de Hopper est intimement comprise comme peinture de l’entr’acte, de l’entre-deux sur lequel on ne s’arrête jamais ou presque – à tort ou à raison, à vous de voir.
Mit Melendili et Palpatine (en septembre, donc, voilà, voilà)
À lire : l’interview du réalisateur, en VO sur le beau site du film ou en traduction
l’essai d’Alain Cueff, Edward Hopper, entractes