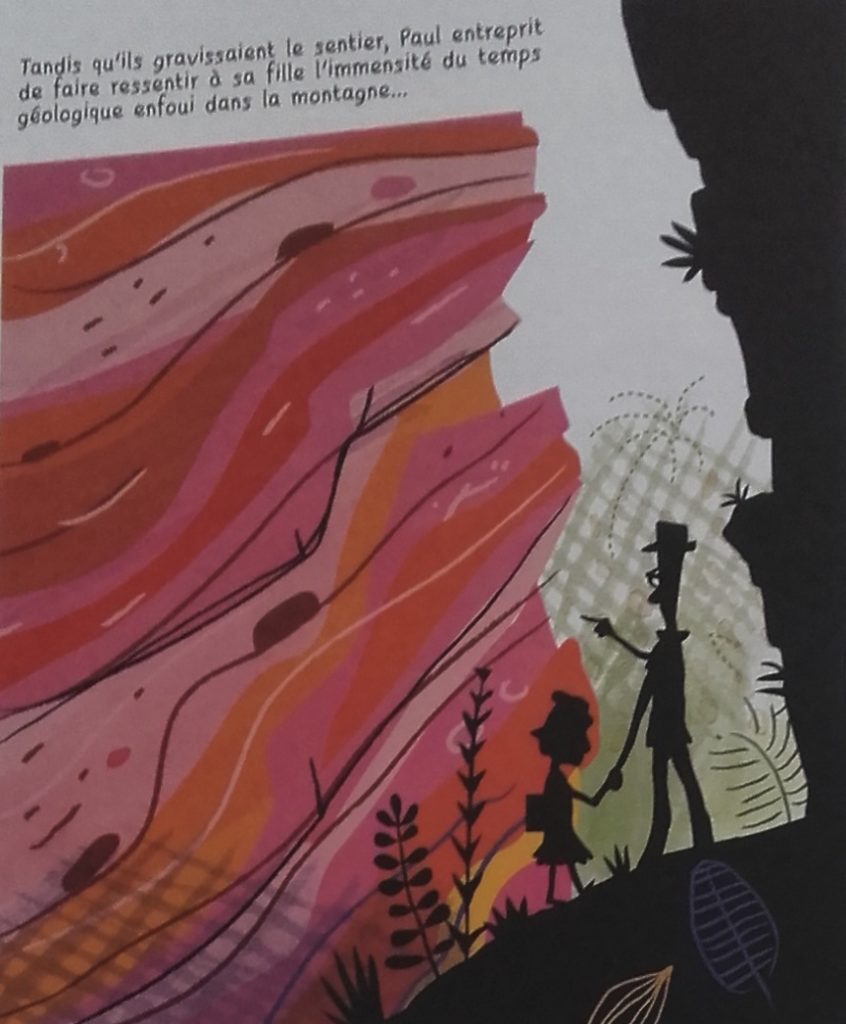Le Livre d’orgue de Messiaen se situe quelque part entre une rue embouteillée aux automobilistes irrités et les notes de synthétiseur qui accompagnent les séquences lumineuses dans les Rencontres du troisième type. À peine la transposition des chants d’oiseaux offre-t-elle un répit à la mi-temps : ils sont aussi doux à l’oreille que les faux appeaux en plastique dans lesquels je sifflais enfant. C’est globalement aussi exaltant que de scander des hexamètres dactyliques en classe de latin : l’exercice est à peu près stimulant pour qui s’y applique, mais sans grand intérêt pour qui y assiste. Les spondées aigus, qui semblent ne devoir jamais finir, sont physiquement douloureux pour les tympans. Du moins la douleur divertit-elle de l’ennui. (Les doigts sur les oreilles, j’ai fulminé.)
Soulagement lorsque je vois la console disparaître à l’entracte. Le Quatuor pour la fin du temps est beaucoup plus écoutable ; même assez beau par moments. J’imagine : mes oreilles sont trop irritées pour que j’en sois tout à fait certaine ; la clarinette me les vrille encore un peu en partant dans les aigus. Dans les graves, et dans la proximité du silence surtout, lorsque le son se fait chuintement, j’aime assez. Plus encore le violoncelle, accompagné par un piano discrètement obstiné, comme une marche à travers un paysage sans autre âme humaine que la conscience qui le constate, un jour sans lumière. Lorsque vient le tour du violon, ma patience est épuisée ; je souscris à l’exclamation du vieux monsieur devant qui, entre deux mouvements, demande tout haut si c’est fini. Patience et espoir : les mauvaises choses aussi ont une fin.
Morale de l’histoire : mieux faut-il écouter un extrait du concert avant d’y aller et se munir de bouchons d’oreille s’il y a de l’orgue à fond les tuyaux.