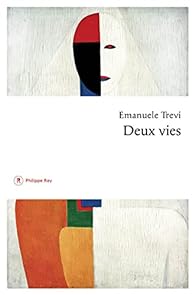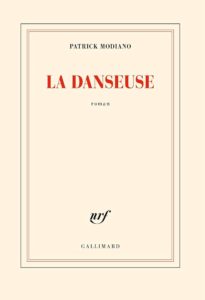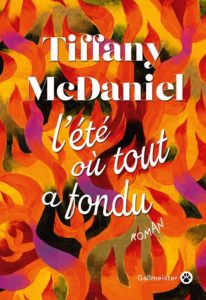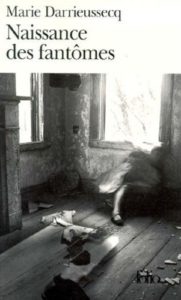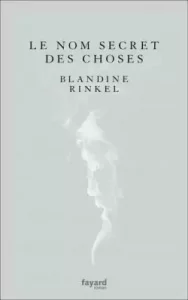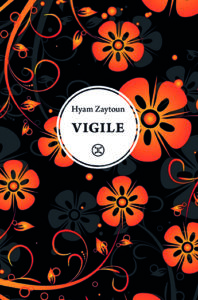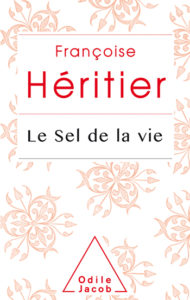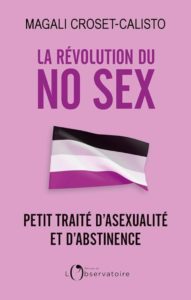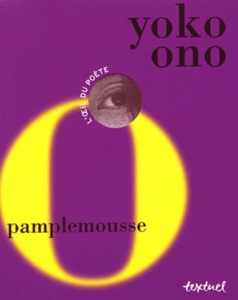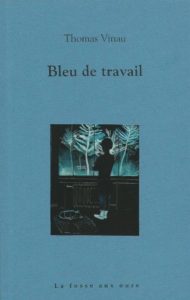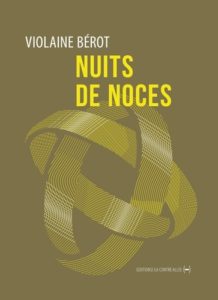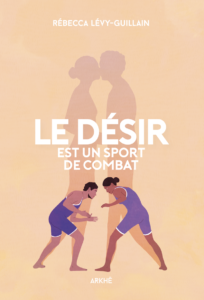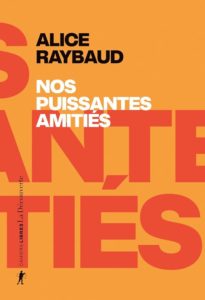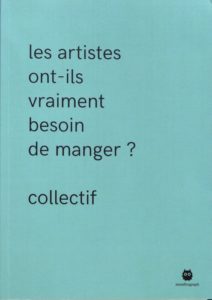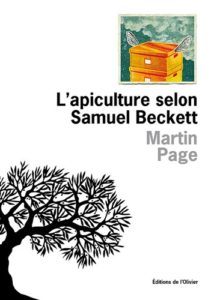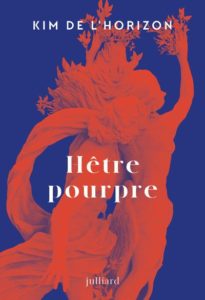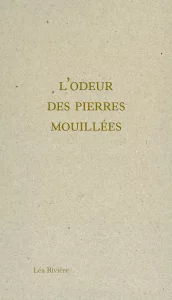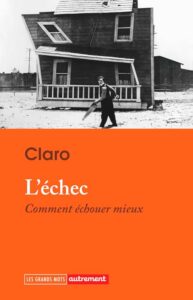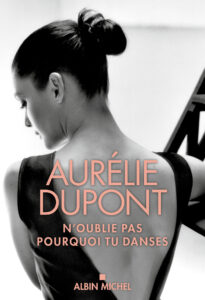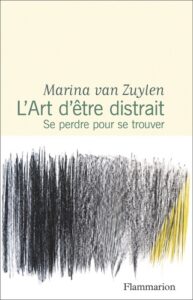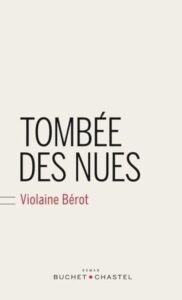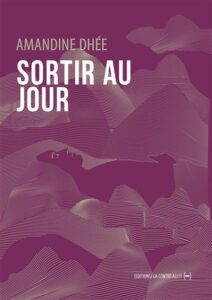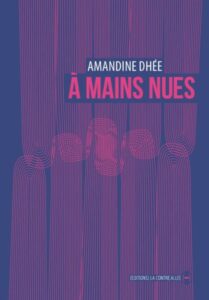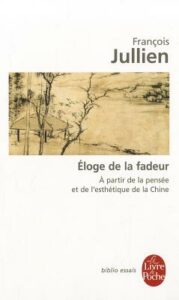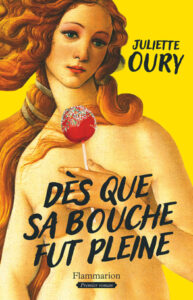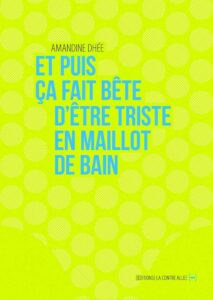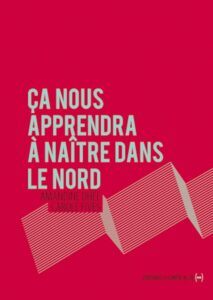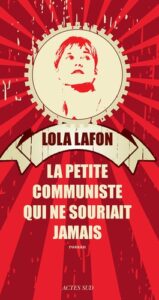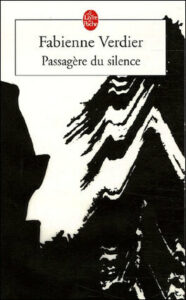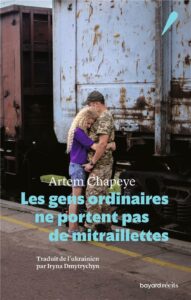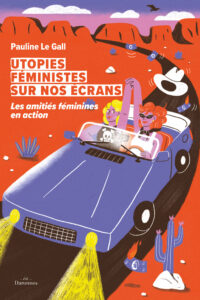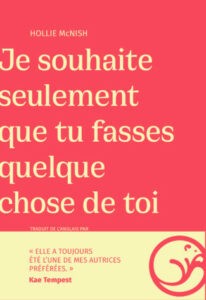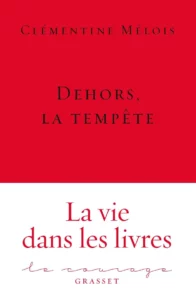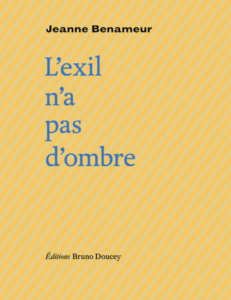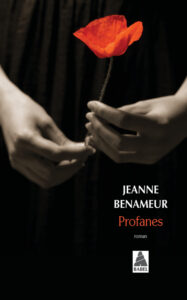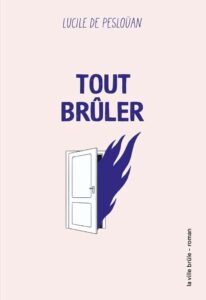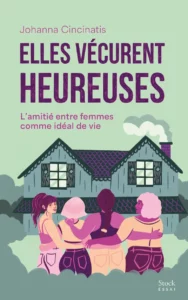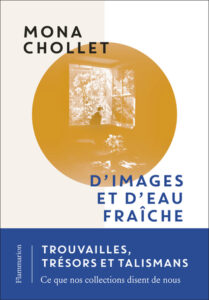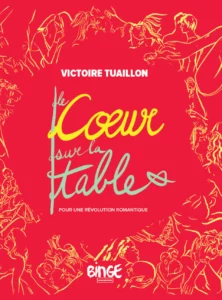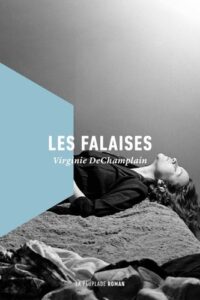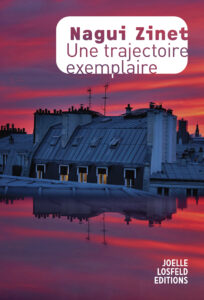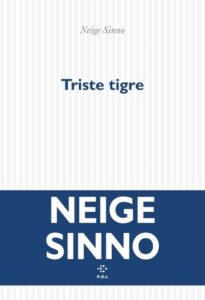Le Dernier Baiser d’Attila : j’ai ainsi contracté le titre tout le temps que le livre est resté avec la pile de mes emprunts. Le Dernier Amour d’Attila Kiss, de son titre exact, est le premier roman de Julia Kerninon, mon dernier crush littéraire en date dont je risque d’avoir tout lu avant la fin de l’année. C’est un premier roman, ça se sent : tout y est, foisonnant, entassé comme les ors et ornements dans une église baroque italienne. C’est trop et c’est parfait, riche et éblouissant, même si c’est aussi bancal, évidemment, même si cette histoire de grief historique inséré à l’échelle d’une relation est un peu dure à avaler pour qui n’est pas en année sabbatique, enfermée dans une pièce à écrire à Budapest, et Julia Kerninon le sait, qui en fait un paravant, un prétexte pour son personnage qui a d’autres choses à se reprocher. Il y a déjà là toute l’habileté narrative que la romancière déploiera avec davantage de maîtrise encore dans ses romans suivants, il y a des thèmes que l’on retrouve, la fuite comme sortie de route, le passé que l’on porte avec soi comme une lourde couronne, les relations amoureuses asymétriques en âge (et toujours l’homme plus âgé) ou encore le désir qui se sait et ne s’en excuse pas.
Encore une fois, j’ai eu envie de tout recopier. J’ai jubilé ce faisant des adverbes qu’il faudrait couper en vertu de je ne sais quelle retenue littéraire et que Julia Kerninon utilise goulûment, absolument ; je me suis gavée de toutes ces virgules qui accumulent, précisent, enrichissent et brouillent en même temps ce que l’on commençait à cerner, qui déborde toujours. J’ai recopié comme elle écrit, sans choisir, en choisissant tout, de tout embrasser.
Les extraits suivants spoilent et ne gâchent rien, mais spoilent tout de même, aussi je vous suggérerais d’arrêter de lire dès qu’ils vous auront donné envie de lire le roman. Tout est donné dès le début, dans un incipit somptueux que j’ai relu plusieurs fois avant d’embrayer sur la lecture. Tout est donné dès le début, mais tout ne se comprend pas depuis le début ; comme en thérapie chez le psy, il y a un cheminement à faire pour revenir au début et s’écrier mais c’est bien sûr, mais tout était là, et tout y était effectivement, condensé, à déployer. C’est là qu’est la volupté de la lecture, et une fois encore le savoir-faire narratif de Julia Kerninon, qui élèvera dans Liv Maria le procédé au rang de préfiguration tragique, dans une sorte d’anti-ironie dramatique.
Au début, il la vit comme une Apache à la peau claire, mi-conquérante mi-fugitive, parce qu’elle était venue s’asseoir à sa table avec cette assurance déroutante — et puis, lorsqu’elle commença à parler, le premier soir, il discerna la fille en elle, non pas l’enfant mais l’infante, la descendante, la dernière d’une lignée, portant sut sa tête quelque chose de très lourd qu’elle ne pouvait ni voir, ni toucher. Après, il découvrit la guerrière, l’orpheline, qui amenait avec elle l’amante merveilleuse aux yeux grands ouverts, et il fut séduit. Soulevant une à une les couches sédimentaires qui la recouvraient, la protégeaient, lentement il vit se dessiner l’héritière d’une fortune et d’un nom séculaires […].
Plus on précise, plus on brouille.
Peut-être, lorsque nous prononçons les mots histoire d’amour, croyons-nous désigner ainsi la qualité romanesque de nos affections, la façon dont nous pouvons les réduire a posteriori à la banalité d’un récit — mais nous oublions alors que l’autre sens du mot histoire signifie archive, mémoire, rappelant que
les passions ne sont pas seulement des fables, mais d’abord une succession de guerres gagnée set perdues, de territoires conquis, annexés, pus brûlés, de frontières sans cesse réagencés. En réalité, l’histoire d’un amour repose sur les défaillances et les concessions, les enclaves protégées, les coups d’État, les caresses, les victoires, les amnisties, les biscuits de survie, la température extérieure, les boycotts, les alliances, les revanches, les mutineries, les tempêtes, les ciels dégagés, la mousson, les paysages, les ponts, les fleuves, les collines les exécutions exemplaires, l’optimisme, les remises de médailles, les guerres de tranchées, les guerres éclairs, les réconciliations, les guerres froides, les bonnes paix et les mauvaises les défilés victorieux, la chance et la géographie. Lorsque deux individus se rencontrent et chercher à entrer en contact jusqu’à se fondre, cela commence toujours comme commence une guerre — par la considération des forces en présence.
Une histoire d’amour comme un historique (de la mise en relation).
Ceci est l’histoire d’un amour — la plus petite de toutes les histoires — l’histoire du dernier amour d’Attila Kiss. Parce que c’est une chose de déposer les armes, dans un mouvement superbe de tapage et de dévotion, mais c’en est une autre que d’accepter à partir de cet instant de se vivre comme perpétuellement désarmé.
J’adore qu’elle ne vende pas ça comme une grande histoire d’amour, mais au contraire comme une petite, la plus petite de toutes, où se jouent aussi de grandes choses. Peut-être aussi veut-on la garder petite parce que les grandes histoires d’amour le sont souvent par l’ampleur de leur fin dramatique ?
![]()
Il s’était demandé : Mais qu’est-ce que j’aime, au juste, dans cette odeur ? Et puis, immédiatement après, beaucoup plus douloureusement : Qu’est-ce que j’aime ?
Pourtant, toutes ces dernières années insensées, passées à […] mentir à tout le monde, à louvoyer sans cesse, il ne s’était pas senti coupable — il s’était senti vivant.
(On retrouve ça avec les amants concomitants de Toucher la terre ferme.)
Il entassait les toiles finies dans un coin du salon, il se faisait un monde. Il avait appris à mélanger ses couleurs lui-même. ll avait appris la perspective. Il avait appris l’échec.
(Ici je repense à Une activité respectable, à la mère qui semble ne pas connaitre l’échec, parce sa fille n’a jamais été témoin des essais infructueux tentés avant sa naissance.)
[…] des touristes hystériques se jetant dans nos thermes comme des beignets dans l’huile chaude.
J’ai ri. Je veux dire, vraiment, pas intérieurement. Des sons sont sortis de ma bouche alors que je lisais au parc Barbieux, je crois. Et j’ai eu envie de Julia Kerninon soit ma pote. Désormais de gros beignets se superposent à mes souvenirs des bains Lukács.
Il refusait de l’admettre, mais il n’était pas vraiment taillé pour la monotonie qu’il avait lui-même établie dix ans plus tôt.
Et à part des rôles, qu’est-ce qu’il affronte, ton père ? lança-t-il. — Moi, elle avait répondu après un court silence. Il m’a affrontée, moi. — Et comment ça s’est passé ? — Eh bien, il est mort.
Alors Attila la regarda en face pour de bon.
That kind of badass girl.
Et elle, elle avait été la fille de ce monstre sonore, de ce bruit massif […]. Tu étais d’abord la fille d’un homme qui criait très fort, lui dirait Attila plus tard, quand ils se connaîtraient mieux. Oui, répondrait-elle, semblant l’espace d’un court instant scandaleusement soulagée de pouvoir le réduire à ça, libérée, cette érudite de l’opéra, ce puits de science musicale, cette fille de l’art, sa fille à lui, élevée dans ses chants, apaisée d’un seul coup en osant seulement l’évoquer par le bruit permanent qu’il lui avait imposé toute son enfance. Le pire, c’est que je ne sais même pas si j’aime vraiment la musique, avait-elle avoué le premier soir.
C’était comme une cathédrale de musique, et j’étais toute seule dedans […]
Quand nous avons fait l’amour, il y avait à peine quelques heures que je t’avais vu pour la première fois, assis à cette terrasse avec tous tes vêtements sur toi, et voilà que déjà nous étions nus ensemble — c’était presque une surprise de découvrir que tu avais un corps sous le tissu, penser que c’était si proche, qu’avant ça au café je t’avais demandé si je pouvais m’asseoir avec toi, j’avais eu recours à la politesse pour demander une chose aussi minuscule […] et à présent nous ne nous demandions plus rien, nous étions déjà dans cette brèche sauvage qu’ouvre le sexe dans les rapports humains, cette zone de non-droit où tout devient plus rapide, plus exigeant, plus instinctif, et je posais ma bouche sur la tienne alors que quelques heures avant je me serais excusée si je t’avais frôlé par inadvertance.
(Cela me semble à la fois très juste et légèrement gênant post #metoo.)
Je savais très exactement quatre choses sur toi […], c’était très peu, c’était minuscule, mais l’amour est la forme de plus haute de la curiosité et je suis tombée amoureuse de toi.
Avec la simplicité obstinée d’un oiseau faisant son nid, elle apporte ses affaires l’une après l’autre, au rythme de ses allers-retours entre Vienne et Budapest.
Il aurait voulu l’avoir connue quand elle était enfant, l’avoir connue tout le temps, qu’il n’y ait rien de sa vie qu’il lui ait échappé.
(Again, légèrement creepy.)
[…] c’était sa zone de confiance, le Staatsoper, le seul endroit du monde où elle s’autorisait à pleurer, dans le noir protecteur de la grande salle ovale.
![]()
Attention, on entre en zone de spoiler niveau 1.
À s’être présentée comme la fille de son père, la fille d’un grand ténor, Theodora a occulté sa mère. Attila découvre qu’elle est fille de ténor mais aussi fille de millionnaire, et la différence de classe, s’ajoutant au grief historique des Hongrois contre les Autrichiens, est plus difficile à vivre que la différence d’âge.
En dépit de ses échecs répétés, elle retournait faire les courses avec ravissement, avec enthousiasme, et il voyait bien que ça l’amusait simplement parce qu’elle ne l’avait jamais fait vraiment, elle n’avait jamais eu à nourrir une famille, ni personne. La vie qu’il avait vécue et qui était pour lui la seule vie réelle n’était qu’une sorte de jeu pour elle.
[…] il continuait de lui faire l’amour, comme s’il avait espéré pouvoir enfin épuiser le désir qu’il avait d’elle […]
Faire l’amour à : la préposition me gêne toujours, comme si elle réifiait l’autre. Si on fait l’amour à quelqu’un et pas avec quelqu’un, il y a comme un problème — de fait, Attila a un problème envers Theodora. Je ne vous avais pas encore dit d’ailleurs, que l’héroïne se nomme Theodora, dont l’abréviation en Theo m’a tout autant perturbée que ravie.
La problème, c’est qu’il faut être au moins deux pour se faire la guerre et qu’il est extrêmement difficile et épuisant de sa battre contre un adversaire qui ignore qu’il en est un.
[…] parce qu’elle avait appris la langue hongroise d’abord en lisant de la poésie en pension, elle utilisait le temps verbal du passé archaïque, littéraire, inadapté, et ses phrases résonnaient avec une émotion accrue dans les oreilles d’Attila, comme un poème épique.
Et je ne suis pas une Habsbourg, Attila. Je suis une Babbenberg, et je t’aime. Débrouille-toi avec ça.
Je deviens vieux, pensa-t-il. J’oublie tout. J’oublie les choses précieuses.
Quand Theodora trouve beau qu’il ait vendu sa voiture pour acheter de la peinture :
C’est encore un truc de riche de trouver de la beauté dans les sacrifices les plus triviaux, parce que c’est exotique, tout ça, pour toi. Mais moi je ne trouve aucune consolation dans mon exotisme dont le vrai nom est pauvreté.
[…] il semble qu’il n’y a rien que je suisse faire qui change quoi que ce soit au fait que tu es depuis quelques mois ma personne préférée sur cette terre, et alors je suis heureux que tu aies une belle vie, mais j’aurais aimé ça, moi aussi, je crois.
J’essayais de faire des choses, moi aussi, mais tu n’étais jamais content, pourtant tu ne m’as pas dit de repartir. C’est comme ça que j’ai su que tu m’aimais. Ça avait l’air incroyablement difficile pour toi d’être avec moi, mais pourtant tu continuais, tu dormais dans mes bras, tu restais sur tes gardes, mais tu étais là. […] Elle n’essaya même pas de le séduire ou de le convaincre. Elle savait que ce qui était entre eux était trop considérable, et lui trop subtil pour que ça n’ait pas lieu. Elle attendait simplement qu’il tombe — comme un arbre en feu.
Again, la lisière est fine avec une relation toxique. Mais cette conclusion, l’arbre en feu…
La vérité, sans doute, était qu’Attila trouvait presque une forme de réconfort dans le fait de pouvoir le considérer comme une coupable.
La vérité, en vérité, encore un truc qui taraude l’autrice.
[…] c’était ce qui nous échappe toujours au moment où nous le vivons — à quel point le rapport amoureux est d’abord l’expérience confondante de l’intimité partagée avec l’altérité.
Il l’avait vue être si calme face à ses propres éclats qu’il avait pensé que telle était sa nature — il avait cru avoir exploré intégralement le terrain de sa personnalité, et que la carte qu’il en avait tracée était exacte. Mais en quelques semaines, elle devint une autre personne […] c’était comme si elle avait grandi à son insu en l’espace de quelques jours, elle avait pris de l’ampleur, elle était devenue une walkyrie furieuse, incontrôlable […].
![]()
Attention, on entre en zone de spoiler niveau 2 : la saison des opéras, point d’orgue de l’exploration psy de Theodora.
Et cette musique, dans un sens, était plus aboutie qu’elle-même, avait été plus aimée par son père qu’elle ne l’avait été elle-même. […] Elle était terrifiée, la musique était trop puissante, à chaque fois c’était un rappel du temps que son père y avait consacré à ses dépens, c’était la musique de quelqu’un qui ne sait pas ce qu’est un enfant, qui ne sait pas ce qu’est la vie réelle, ni le temps perdu. […] tout le ressentiment de Theodora ne faisait pas le poids face à sa connaissance profonde de l’opéra. Cramponnée à son fauteuil, où qu’elle soit, dès les premières notes elle était vaincue, jetée à terre, piétinée par les mouvements merveilleux inventés par son père, elle ne pouvait pas lutter, elle devait faire face, très douloureusement, à l’artiste supérieur qu’il avait été, et qui, d’une façon ou d’une autre, surpassait et effaçait l’être épouvantable qu’elle avait fréquenté intimement.
Est-ce que la musique valait ça, traiter un enfant comme un adulte parce que c’est moins fatigant, moins perturbant, est-ce que la beauté de la musique valait toutes ces absences, est-ce qu’on n’est pas supposé faire un choix entre la postérité et la descendance, quand on est un génie comme les journaux disent que tu en es un à présent que tu es mourant ? Mais à présent qu’elle était devenue malgré elle la plus grande spécialiste de son travail, elle était incapable de répondre à ces questions.
[…] elle allait devoir vivre comme la prêtresse du temps du désamour de son père. […] regarder des salles entières se lever, les yeux embués d’émotion, pour applaudit debout un homme homme qu’elle méprisait autant qu’il l’avait méprisée, et soutenir l’affront de sa musique extraordinaire, sans disposer d’aucun droit de réponse, à moins de se rendre de nuit au Wiener Zentralfriedhof avec une pelle et d’insulter son cadavre.
Ce n’est pas son père qu’elle défend — ce n’est même pas la musique au fond, c’est quelque chose de beaucoup plus subtil, c’est son honneur. Il remonta le ruisseau de ses larme jusqu’à la source, et il vit, enfant, l’enfant offensée et malheureuse qui se cachait sou la guerrière, il comprit sa soif démesurée d’amour, ses réflexes de protection, sa fureur, sa tristesse jamais consolée, son attirance pour les choses quotidiennes, son enjouement inébranlable, il recolla tous les morceaux pour arriver au panorama qui lui avait échappé depuis le début, le territoire immense qui était elle […] Tout ce qu’il savait d’elle prenait sens d’un coup — illuminé. Lorsque nous rencontrons quelqu’un, et que nous tentons de lui résumer les années vécues auparavant afin d’expliquer qui nous sommes, ce que nous disons aboutit toujours à une construction une fable, une histoire — mais, comme toutes les histoires, notre récit n’atteint sa pleine ampleur que lorsqu’il est lu par le bon lecteur. Ce jour-là, Attila la vit pour la première fois en entier, et il tomba amoureux du tout comme il était tombé amoureux de chaque morceau égaré.
Pardon, mais ce n’est pas trop beau ? (J’ai abandonné toute prétention critique, laissez-moi faire ma groupie.)
![]()
Après avoir percé la carapace de Theodora, c’est au tour d’Attila d’être percé à jour et désarmé :
Et dès qu’elle l’eût dit, il sut qu’elle avait touché juste. Oui, à la fin, si on allait au bout des choses, si on précisait jusqu’à l’os, jusqu’à la douleur, il lui en voulait pour le Burgenland arraché à son territoire pour être recousu au sien sans bonne raison valable. […] Oui, dirent ses yeux hébétés.
(Quand l’autre te devine mieux que toi.)
Je suis désolée qu’on vous ait pris ce truc, cela dit, dans la mesure où tout le monde s’en fout, on peut dire que c’est à toi, si tu veux. Tu peux être le prince secret du Burgenland.
Tu m’as fait croire que tu avais mal parce que j’ai hérité d’une fortune dont je me fous, tu m’as fait croire que tout était de ma faute, et je t’ai cru […] mais la vérité c’est que tu as trois filles que tu n’arrives pas à oubli parce que c’est impossible d’oublier une chose comme celle-là. Quel abruti.
Et plus Theodora criait, plus il se sentait bien, paradoxalement, comme si l’équilibre de la justice était enfin revenu sur la terre.
Attila a szerelmem, répondit Theo de sa voix sans merci. (Attila est celui que j’aime.) […] Attila, quelque part dans la fraîcheur de l’automne de ses cinquante-deux ans, la main dans celle de la jeune femme qui l’aimait la tête haute, déposait les armes pour la première fois de sa vie.