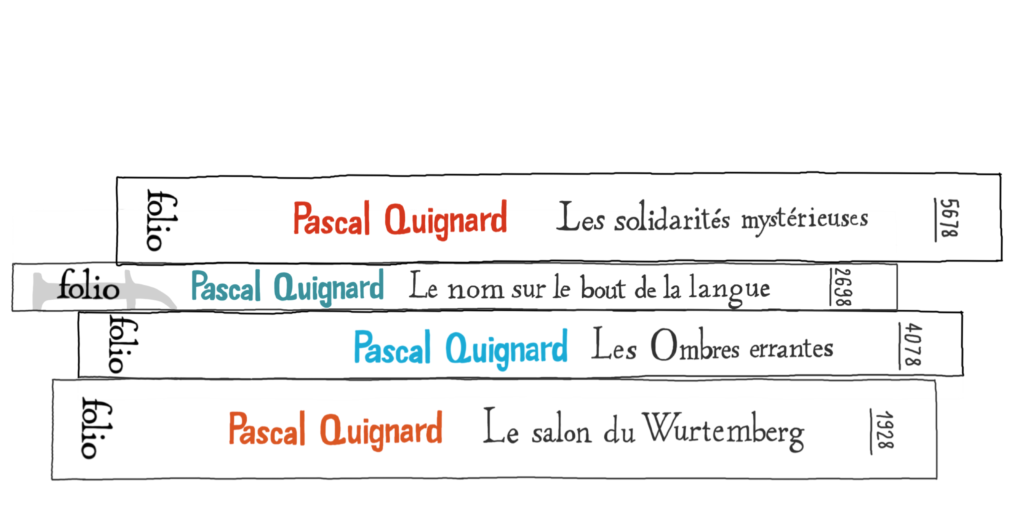L’Obsolescence programmée de nos sentiments, de Zidrou & Aimée de Jongh
Le titre m’a attrapée, mais si obsolescence il y a dans ce récit, elle concerne les corps et non les sentiments – ou alors seulement en ce qu’on les imaginait synchronisés avec le vieillissement biologique. J’étais un peu déçue de ce thème manqué par la bande-dessinée, mais on y drague avec des métaphores filées à base de fromage coulant, alors ça va.
(Il y a aussi une belle histoire racontée sur un rameur : l’histoire du poisson rouge qui rêvait de voir l’océan. Il rêve de voir l’océan et, un jour, une tempête le propulse hors de l’eau jusque dans les branches d’un arbre sur la rive : qu’importe qu’il meurt ensuite, il a vu l’océan.)
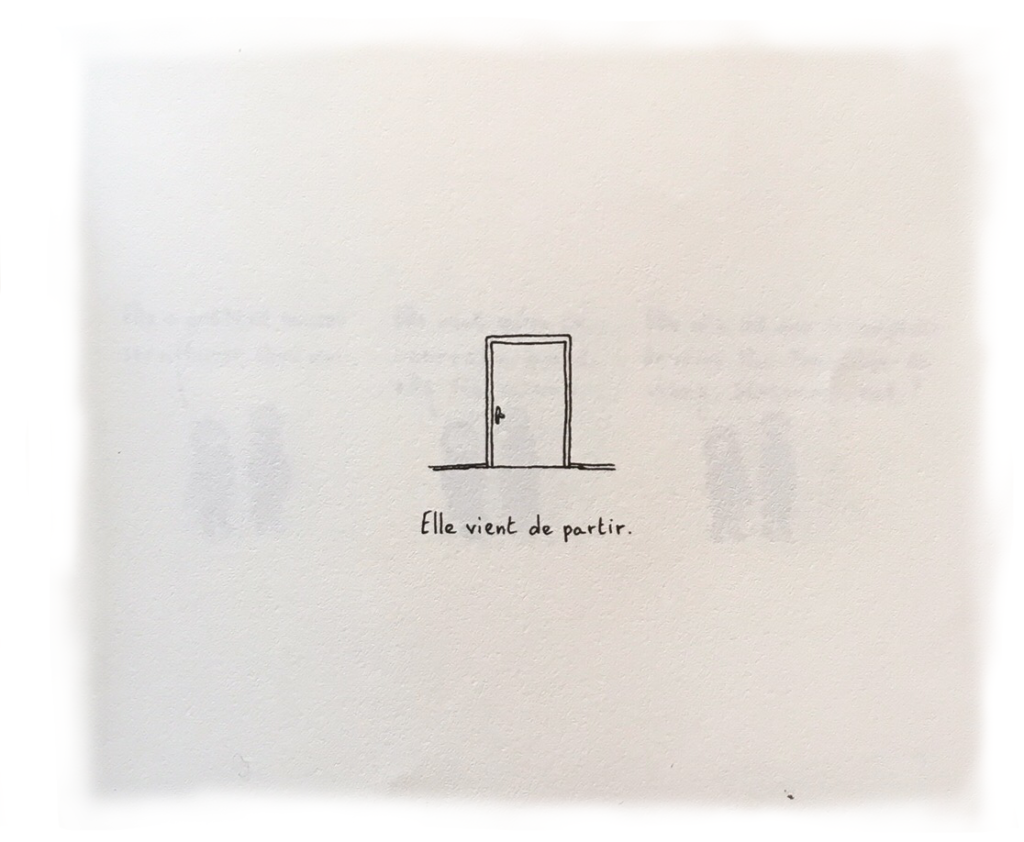
Moi non plus, d’Émilie Plateau
Émilie Plateau fait le récit d’une rupture avec une économie de moyens qui instaure rapidement un climat d’intimité. On croirait l’entendre chuchotée.
Des bribes de conversation,
des phrases notées d’une écriture serrée comme le coeur,
deux silhouettes en conversation, un ami,
les saisons en arrière-plan lorsque le canapé le cède à la marche,
une couleur complémentaire du noir, vert turquoise, qui souligne ce qu’il y a à souligner,
une présence rêvée ou crainte, la nature, les réponses au téléphone…
Le processus de rupture amoureuse se déploie tout en sensibilité et pudeur – un processus rendu d’autant plus difficile qu’il s’agit d’une relation toxique, perverse-narcissique. La rupture est consommée lorsqu’on comprend que ce qu’on pensait la fin d’un amour n’en en réalité que le début d’une reconstruction de soi.

Ni Dieu ni maître : Auguste Blanqui, l’enfermé, de Locatelli Kournwsky & Le Roy
Blanqui était la running joke du cours d’histoire en prépa : à chaque période, on faisait un point pour savoir de quel côté des barreaux l’anarchiste se trouvait.
Le souvenir m’a fait sourire, j’ai embarqué la bande-dessinée qui l’avait fait ressurgir. J’en suis heureuse, car les auteurs réussissent à faire ressurgir le drame là où la répétition le tire vers la comédie. Sous le personnage rocambolesque et les rebondissements de sa vie, le récit fait affleurer autre chose : une forme de probité, de persévérance dans la droiture, et de douleur face à l’existence.
Les soulèvements manqués et les condamnations à répétition, ponctuées d’évasions, n’entament ni son espoir ni ses convictions. L’entêté qui prête à rire finit par forcer l’admiration, lorsqu’on décèle dans son acharnement la volonté d’absolu qui le meut. Cette volonté d’absolu le rend dangereux d’un point de vue politique (il veut que le pouvoir soit au peuple, quitte à priver ledit peuple du droit de vote le temps de l’éduquer), et fascinant d’un point de vue humain : c’est un peu la même ardeur que celle d’Ida dans le film de Pawel Pawlikowski, un même renoncement à la vie au nom de la vie même.

Léonard & Salaï, de Benjamin Lacombe et Paul Echegoyen
Joli biopic sur Léonard de Vinci que cette bande-dessinée, qui narre son histoire par le prisme de sa relation avec Salaï, son disciple et son amant. On est plongé dans la vie d’atelier, où chaque commande, on a tendance à l’oublier, est un travail collectif. Entre la nécessité de faire vivre son petit monde et les déménagements plus ou moins contrôlés, Léonard de Vinci ressemble au chef d’une troupe de baladins.
On est plongé dans une époque, aussi, des villes, des décors, magnifiés par des dessins et des angles de vue magnifiques. On sent que l’esthétique a été soignée à la mesure de son sujet, et toujours stylisée. Contrairement à ce qu’on aurait pu attendre, la couleur est réservée aux peintures de Leonard de Vinci (aux dessins dans le dessin) ; les personnages, la ville, tout ce qui vit dans le récit s’anime en noir et blanc – ou bien plutôt : en clair-obscur. Avec leurs paupières toutes rondes, très marquées, les visages semblent sculptés à l’instant dans la cire. Ils en deviennent vivants au-delà de toute couleur, si bien qu’au final, le travail sur les expressions m’a davantage ravie que le récit biographique. Je n’en essayerai pas moins de mettre la main sur le second tome.