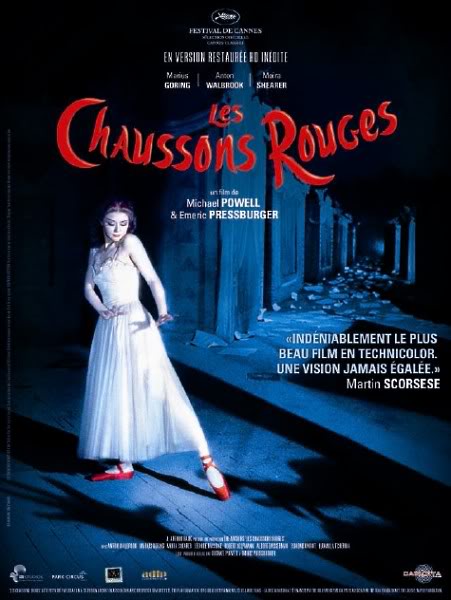Prise de remords ou d’ennui ou de court par le TD de recherche documentaire de vendredi matin, je me suis décidée à jeter un œil à quelques ouvrages critiques sur Kundera pendant les heures suivantes que le déjeuner ne parviendrait certainement pas à combler jusqu’au cours suivant. L’âge d’or du roman : le titre ne m’attirait pas, ça m’évoque trop un pré vert avec un arc-en-ciel doré au-dessus, à compléter, entre les deux, par ce à quoi s’applique l’expression, en l’occurrence, des livres. La quatrième de couverture m’a mise dans de meilleures conditions : l’auteur de l’essai explique qu’il a délibérément donné cette expression un peu vieillotte comme titre en guise de pied de nez aux éternels pessimistes pour qui le pire est toujours à venir, et le meilleur à partir. Et de montrer que la production littéraire de notre époque n’a rien à envier à celle du passé. Les articles sur Kundera étaient délicieux, si bien qu’après avoir fait couler un peu d’encre, je me suis octroyée le préface en dessert. Une défense de la critique. Je voudrais y revenir, parce qu’elle m’a d’autant plus facilement transformé les neurones en pop-corn qu’elle a ravivé des découvertes amorcées cet été à la lecture d’un numéro de la Quinzaine littéraire consacré au sujet.
Auparavant, je n’avais jamais porté attention à la division de la critique en analyses universitaires et en compte-rendus journalistiques. Pour être exacte, il faudrait dire que je n’ai même jamais pensé qu’elles pussent être unifiées (et sans unité, pas de division) : outre qu’elles occupent des espaces séparés, elles sont encore distinctes du point de vue de la temporalité, l’analyse universitaire arrivant après la lecture, la présentation journalistique, avant. Mais quand j’entends qu’on déplore l’état de la critique qui ne remplit plus sa fonction, je me dis que ma séparation n’est peut-être qu’un malheureux indice d’une situation dangereuse. Les journaux, en effet, ne critiquent pas (plus?), ils présentent les dernières parutions, et les quelques lignes qu’on leur consacre ne permettent pas d’effectuer un tri. Le choix n’est plus critique mais marketing ; le sujet, objet de consommation. De l’autre côté des lignes, à l’université, on travaille beaucoup sur les siècles passés, au risque que leur travail « à partir de » n’en vienne implicitement à leur faire penser qu’ils s’éloignent du bel et bon, bel et bien perdu.
Les classiques sont l’assurance qu’on ne perdra pas son temps qui, dans la perspective du littéraire n’est pas de l’argent, mais un élément porteur de sens, dont il est constamment à la recherche à travers un temps de lecture qui ne se contracte pas comme les trajets en train que l’on fait passer avec. On ne peut pas tout lire et l’on veut d’autant mieux bien lire. Derrière l’arrimage aux classiques, ce label rouge de la signification en littérature, il y a peut-être aussi la crainte de ne pas savoir quoi lire (problème de la critique qui fait défaut), et surtout de ne pas savoir quoi en penser (problème de la critique – sur quels critères juger d’un ouvrage ?). Je dois reconnaître que je m’aventure bien peu dans le domaine de la littérature contemporaine. Je me laisse entraîner par la couverture orange et l’incipit de l’Oiseau à ressort, de Haruki Murakami ; j’ai dans l’idée de lire un jour du Kazuo Ishiguro, dont on avait traduit un extrait en prépa ; la Bacchante me prête le Fusil de chasse ; j’espère que le livre de Marie Billedoux, que j’ai acheté à la sauvette au Relay sera moins mièvre que le nom de son auteur ; mon regard formaté à l’étiquette jaune tire un Paul Morand du rayon – confiance progressive à la collection de l’Imaginaire ; j’achète Vente à la criée du lot 49, de Thomas Pynchon pour comprendre quelque chose au cours de mercredi prochain… un peu de hasard et beaucoup de professeurs, j’ai toujours peur de lire des bêtises. Classique. Ce sera un nouvel essai.
Guy Scarpetta raconte comment il en est venu au sien : au cours d’une conversation, personne ne s’entendait sur l’époque qui constituerait l’âge d’or du roman, mais tous le situaient dans le passé et tous ont unanimement rejeté la possibilité qu’on puisse y être, là, maintenant, paradoxe qu’a tenu Guy Scarpetta. Pour le soutenir, il est aller à la librairie du coin acheter quelques ouvrages bien sentis pour ses hôtes qui ont dégusté. L’âge d’or du roman, c’est un peu faire au lecteur anonyme le cadeau que le critique a offert à ses amis.
Avant de penser au vacillement de la critique, je me serais plus longuement étonnée sur ce contre-exemple du sens du progrès – qui reste un des fondements de notre pensée même si nous avons assez creusé pour le faire remonter à la conscience et le sortir de la foi dans laquelle le positivisme l’avait plongé. Pas d’avancées en littérature sinon a posteriori. En un sens, c’est tout à fait juste, il n’y a pas de progrès en littérature (ou alors seulement en terme de conscience et de réflexivité – risque de tourner en rond, d’ailleurs). Mais l’absence d’avancées n’a pas à dégénérer en hantise de la régression. Le pessimisme littéraire serait-il si peu moderne, loin de la tentation du progrès, à brandir ses classiques des siècles passés en réaction ? A moins qu’il ne le soit que trop, et l’indice d’une résistance forcenée contre le préjugé de notre temps – pas un préjugé, mais le préjugement, la crainte de penser par soi-même et de s’abriter derrière les arguments d’autorité. Je ne dis pas qu’on n’ait pas besoin de repères qui fassent autorité, mais il faut les avoir éprouvés auparavant : après avoir goûté l’intelligence de Guy Scarpetta sur un auteur que j’ai lu, je suis tout à fait disposée à me diriger vers l’inconnu qu’il me désigne dans ses autres articles. D’une manière plus générale, le choix que l’on fait de ses critiques l’est aussi (critique), puisqu’il ne faudrait pas que le temps de passé à choisir ses lectures (paralittérature) nous ôte celui de les faire (littérature)… Il est toujours bon de savoir à qui l’on a affaire : par exemple, j’apprécie les critiques de danse détaillées et pertinentes de Syltren, mais je les (re)garde a(vec) une certaine distance, car j’ai pu constater sur des distributions que nous avons eu en commun (pas très difficile, il semble toutes les voir^^) que nous n’avons pas du tout la même sensibilité.
Il ne s’agit pas d’abord de trouver des critiques qui aient des goûts semblables aux nôtres, mais en l’intelligence desquels on ait confiance. Car, quoiqu’en disent messieurs Robert et Collins, un spoiler, dans une bonne critique, ne gâche rien. Plus on montre la cohérence d’une construction, plus la place devient forte – elle peut être complètement apparente (comme chez Kundera), cela n’ôte rien au suspens, dont la véritable nature pourrait bien être le suspends, « the willing suspension of disbelief » de Coleridge. Et Anouilh de présenter au début d’Antigone chacun de ses personnages et le destin qui les attendent : tout est dans le déroulement. Lorsque je lis une critique de Bamboo étiquetée « spoiler » comme « fragile » sur un carton de déménagement, en me disant que de toutes façons ce bouquin ne me dit rien, ou je n’irai pas voir ce film, c’est précisément une fois qu’elle en a dégagé le fonctionnement- patiemment, archéologue du sens avec son pinceau- que j’ai envie de me
précipiter sur son pré-texte. Peut-être parce que j’ai ainsi un angle d’attaque, une interprétation dont je suis curieuse de voir si je l’adopterai et si oui, avec quelles nuances.
Quid des histoires qui reposent sur un renversement final, me direz-vous ? Regarder The Village a-t-il encore un intérêt lorsqu’on sait ? Cas délicat ; celui qui laisse échapper le truc ruine la magie et est volontiers taxé d’indélicatesse. J’ai oublié son nom, mais j’ai toujours une dent contre la cruche qui avait laissé échapper que Dumbledore mourrait dans le 7ème tome que je venais juste de commencer ; ne pouvait-elle pas me laisser tranquillement croire à la petite souris ? Et pourtant… quand il est passé à la télé, je n’ai pas pu voir The Others jusqu’au bout (shampooing impératif ou trop petite pour me coucher tard, je ne sais plus), et j’avais demandé à ma mère la fin de l’histoire. Quand j’ai récupéré le DVD chez mon père, l’histoire ne m’en a pas paru moins fascinante ou effrayante. Une histoire est bien ficelé lorsque, alors que vous avez repéré et coupé toutes les ficelles, elle tient encore d’une pièce. C’est même à cela qu’on reconnaît qu’elle sera toujours ragoutante.
Guy Scarpetta utilise pour argument une analogie musicale : si un profane peut écouter de la musique et l’apprécier, les musiciens vous diront qu’entendre l’entremêlement des différentes lignes musicales, les thèmes et les variations, bref, la structure, ne diminue en rien le plaisir de l’écoute, bien au contraire. J’en suis si intimement persuadée que je trouve frustrant de ne pas être capable de saisir ces nuances, qu’une reprise (le refrain pour les pauvres d’oreille dans mon genre, qui ne perçoivent que la partie émergée de l’iceberg) m’apaise, et que la lecdture d’une telle analyse me met en joie. Pour Guy Scarpetta, l’analogie lui sert à rendre convaincant son propos sur la critique, assimilée au déchiffrement de la partition (la lecture rejoue toujours l’œuvre par la suite) ; déjà convaincue, je vais en sens inverse, la littérature me sert de paradigme pour aborder la musique.
Voilà d’ailleurs une nouvelle confirmation de la correspondance des arts, s’il l’on doutait encore de l’existence de corrélation entre des modes d’expression divers mais qu’une même sensibilité peut faire converger. La domination d’un art sur un autre est une affaire personnelle qui dépend de l’attrait qu’il exerce sur chacun de nous. Palpatine déplorait il y a quelques temps (si tu te souviens de l’emplacement de tes dires, dear cobaye, tu as le droit de m’envoyer le lien) la prolifération de nanars au cinéma, ajoutant que pour le divertissement bas de gamme, il y avait déjà les livres. Curieusement pour lui, peut-être, j’aurais fait exactement la remarque inverse, qu’il y avait les (télé)films pour cela, qu’il fallait laisser aux livres la littérature. Cinéphile et littéraire. Personne n’a raison, parce que chacun à ses raisons, comme écrit Guy Scarpetta au sujet des personnages de la Lenteur (Kundera, who else ?). Je crois que ce n’est que depuis cette année que je commence à comprendre que le cinéma puisse être un art – par le biais de Rohmer, réalisateur « littéraire » s’il en est (qui va piano va sano). Qu’un film peut tout autant donner à penser qu’un roman.
Un classement des arts en mineurs et majeurs ne contient dès lors pas de jugement de valeur. Quel sens donner alors à ce distinguo ? Guy Scarpetta reprend la distinction de Hemingway : est un art majeur celui qui survit à la mort de son créateur (le peintre laisse des tableaux, l’écrivain des livres, le sculpteur etc.) ; mineur, celui qui meurt avec lui. (Où se trouve la danse, dans cette dichotomie ? Art majeur en tant qu’art de chorégraphe ? Ou art mineur du danseur ? – une fois de plus, elle échappe aux catégorisations. Par sa nature, mais aussi peut-être en raison des théoriciens de l’art, qui m’omettent purement et simplement). Et notre critique de ranger sa discipline dans cette dernière catégorie. Alors que j’ai tendance à valoriser la fierté au risque de l’orgueil et de la prétention, j’aime cette humilité : un bon article critique sait se faire oublier en tant que tel (sinon, c’est que son auteur s’écoute parler, et cherche à bâtir sa gloire sur les miettes grattées à la réalisation d’un autre), il se fond dans la conscience que l’on a de l’œuvre en question, après avoir rendue celle-là plus aiguë et dotée d’une perspicacité qui lui permette de saisir de nouvelles richesses passées inaperçues dans celle-ci. En somme, la bonne critique enrichit, et ne réduit pas. Pas une seule bonne lecture, mais des interprétations d’autant plus valables qu’elles sont superposables. Guy Scarpetta cite Aragon pour qui la critique se doit d’être une « pédagogie de l’enthousiasme ».
Dénigrer est toujours plus facile qu’apprécier (qui n’est pas uniquement synonyme d’ « aimer », même si c’est souvent le cas pour moi qui aime ce que je peux structurer de manière significative), ne serait-ce que parce qu’apprécier nécessite d’exhiber les critères sur lesquels on juge (Guy Scarletta énumère clairement les siens : il considère comme grand roman celui qui 1° explore un territoire nouveau de la vie humaine, 2° renouvelle la forme, et 3° rende indissociable l’un et l’autre). Jugement subjectif, toujours, mais c’est le seul moyen aussi de viser juste. « Pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais un point de vue qui ouvre le plus d’horizons », écoutons Baudelaire, et les auteurs, d’une manière générale, ils savent généralement de quoi ils parlent (un démenti au mythe de l’artiste inspiré, génial malgré lui). Pédagogie de l’enthousiasme… Même si les journalistes de Télérama n’ont pas leur pareil pour passer au vitriol ce qui leur a déplu en quelques lignes réjouissantes de méchanceté, il serait peut-être bon de le leur rappeler. Comprendre pour apprécier. *J’aurais voulu être un critique…* (sur l’air de « J’aurais voulu être un artiste). De danse, dans l’idéal.
Enfin non, transversal, dans l’idéal ; danse, littérature, cinéma, philo, peinture, photo… Ce que j’aime par-dessus tout, ce sont les rapprochements improbables mais pertinents, qui ont, comme dans une métaphore, d’autant plus de force que les termes sont éloignés l’un de l’autre. Les articles où tout s’articule (les fragments que l’auteur a empruntés à des univers différents), où tout converge (les réflexions du lecteur, qui trouvent là leur expression la plus directe), d’où tout rayonne (la structuration des pensées en relance de nouvelles). Les articles dont on oublie qu’ils sont démonstratifs, où l’on chemine dans l’esprit et la culture de son auteur. Chez Palpatine, par exemple, ce sont souvent les articles hebdomadaires qui m’amusent, où se rencontrent de façon plus ou moins lâchement noués des remarques éparses, où se constitue l’expérience – ils sont certes éloignés de la « critique » par leur contenu, mais la plupart du temps bien plus proches de l’essai que ses compte-rendus. J’aime que l’on structure le monde de manière imprévue, autre. Puisqu’une critique ne saurait égaler son objet, plutôt que de s’épuiser à essayer de l’épuiser, je préfère qu’elle l’outrepasse, qu’elle puise à toutes les sources et le prenne ainsi dans ses filets, l’entourant ainsi de son affection et de sa curiosité.