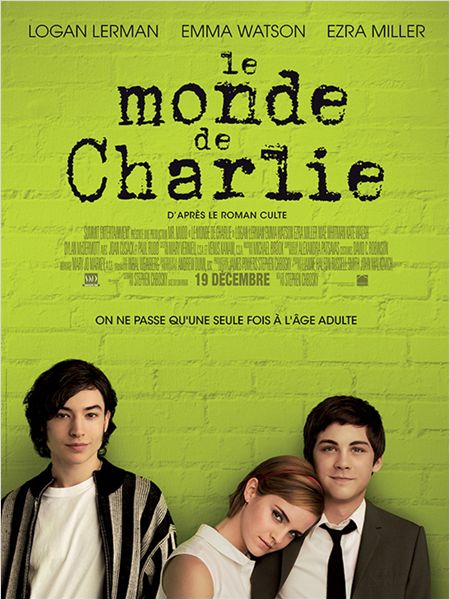Dans le Don Quichotte de Noureev/Petipa, le personnage éponyme meuble le prologue puis apparaît de loin en loin, histoire de conserver le prétexte et de permettre aux danseurs de souffler un peu. Dans la relecture colorée qu’en donne José Montalvo, le chevalier bedonnant est presque toujours en scène et imprime un ton burlesque à l’ensemble de la pièce.
C’est un peu tendue que j’assiste aux premières minutes de mime au comique bien grassouillet et de montages vidéo sauvages, prête à essuyer les foudres de Palpatine qui, je le sens, regrette déjà le Messiaen donné au théâtre des Champs-Elysées. Quand soudain surgit un petit bolide à queue de cheval rousse qui, d’un grand saut écart à la seconde, se place pour le début de la première variation. Échange entendu de regards : wow. Sandra Mercky est explosive et l’on se fiche bien qu’elle soit en dedans de temps à autres : ça dépote. Ça dépote tellement que ça part en vrille, pardon, en smurf ou je ne sais quelle autre mouvance de hip hop. Et Don Quichotte, micro à la main, de commenter tel un répétiteur : pas du Petipa, ça, ah, ça, c’est du Petipa, Petipa, Petipa, pas Petipa, pas Petipa, ah non, ça ne n’est pas du Petipa, Petipa, etc. Héritage et rupture : comme Cervantès qui emprunte aux romans médiévaux pour créer le roman moderne, José Montalvo multiplie les clins d’oeil à Petipa et offre la musique de Minkus aux danseurs de hip-hop.
On se félicite de ce que la version traditionnelle ait été programmée à l’opéra juste avant : en l’ayant en mémoire, les détournements sont encore plus savoureux. Le passage de mains en mains de l’encombrante guitare, parfois dégagée de manière musclée (exemple à 6’39), donne ainsi lieu à un véritable lancer de guitare entre Don Quichotte et Sancho, dont l’ironie est de plus en plus perceptible au fil des passes.
Mais c’est à l’entrée des toréadors que le fou rire me prend : la parade noble et pompeuse (17’20 et 17’36) a été transformée en entraînement sportif, les poses/pauses étant sifflées à intervalles réguliers par un Don Quichotte arbitre.
La parodie, qui fera bien rire les balletomanes, n’est pas le seul ressort comique ni surtout la seule ambition artistique de José Montalvo. Plus le spectacle avance, plus s’affirme la confrontation et la synthèse des genres. Comme pour mieux rendre compte de ces multiples croisements, les montages vidéos substituent aux moulins les couloirs du métro. On y regarde passer les rames à dos de canasson quand on ne chevauche pas les rampes des escalators, où l’on croise quelques tutus-pointes (on oubliera l’idée catastrophique de les faire enfiler à une danseuse contemporaine dont les derniers cours de classique doivent remonter à la petite enfance). C’est totalement déjanté mais quelque part encore dans l’esprit de Don Quichotte et de ses idéaux qui se dissolvent dans le monde moderne. Quant au rang de Sancho et son ancrage dans le monde, ils sont ingénieusement rendus par les évolutions au sol d’un danseur hip-hop hardi par rapport à son Laurel de maître.
Du joyeux capharnaüm auquel les mélanges donnent lieu, surgissent des pépites, comme le dialogue des frappes de flamenco et de la tap dance ou, plus surprenant encore, des claquettes avec les pointes. Hip-hop, classique, claquettes, contemporain, acrobaties… les styles rivalisent : la virtuosité n’est plus ici un gros mot mais une explosion d’énergie et de bonne humeur, une incitation pour chacun à dépasser ses limites et celles de sa discipline chorégraphique.
Et ça marche : quoique très hétéroclite, le groupe est une véritable troupe. Le chorégraphe opère le croisement de parcours improbables, depuis Jérémie Champagne, finaliste de l’émission You can dance et compositeur à ses heures perdues et bad boy beau gosse, jusqu’à Nathalie Fauquette, dont les grands jetés et les tours en arabesque plongée ne laissent aucun doute sur sa formation de gymnaste – dans l’équipe de France, excusez du peu –, en passant par des danseurs hip-hop des quatre coins du monde. Il y a de toutes les formations mais aussi de tous les physiques, de toutes les couleurs : une liane au cou-de-pied classique, une nana au crâne à moitié rasé ou encore un monsieur Propre, moustache comprise. C’est un grand bol d’air par rapport aux corps normés du classique (même si, entraînée à cette école, j’ai encore du mal avec le physique un peu grassouillet du comédien Don Quichotte, par exemple).
Au final, Don Quichotte du Trocadéro est une cure survitaminée de bonne humeur qui s’administre sans se prendre la tête. Je propose une séance à guichets fermés pour l’Opéra.