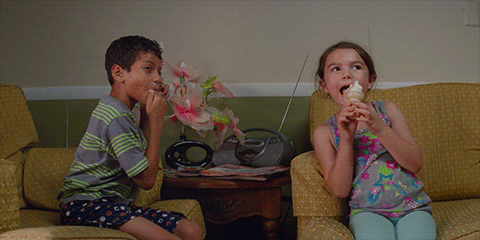Un Patient anglais au rabais, c’est un peu comme ça que, n’ayant jamais lu le roman de Romain Gary, j’imaginais La Promesse de l’aube, à partir de son affiche.
Au début du film, j’ai franchement du mal : je trouve ça surjoué, mal joué — Pierre Niney aussi bien que Charlotte Gainsbourg. Puis, je ne sais pas comment, sans m’en rendre compte, j’entends, j’adopte le ton si particulier de la narration, du héros, de l’auteur, et je finis par trouver ça magnifique, par trouver Charlotte Gainsbourg magnifique de rides et de vie, et Pierre Niney de dadais décevant par rapport aux incarnations antérieures du personnage, devient une espèce de dandy dégingandé drolatique — un drôle d’oiseau qui traduit à merveille l’humour cinglant et l’amour réel avec lequel il regarde sa mère, et leur relation.
La mère ne vit que pour son fils, sommé de ne vivre que pour sa mère, selon des codes d’honneurs fervents et farfelus.1 On rit souvent, estomaqué par les réactions fantasques et disproportionnées, dont on comprend facilement comment elles peuvent inspirer autant l’admiration que la terreur : la mère porte à son fils un amour forcené. Dans un même élan performatif, elle le voue, le veut et le fait grand écrivain, héros de guerre, diplomate, président, tous les honneurs pour son fils qui les mérite, qui se tuera à la tâche s’il le faut pour les mériter. Et il se tue à la tâche et il réussit. Et ne réussit pas, jamais, à vivre sans sa mère, sans son amour démesuré, qu’il ne retrouvera jamais qu’amoindri, parcellaire, dans les bras des autres femmes — notamment de sa femme, qui lit le manuscrit de cette émouvante déclaration d’amour et d’existence.
La faiblesse du fils qui se soumet à la volonté de sa mère s’inverse et se confond avec la force qu’il faut pour répondre à ses exigences, et l’on voit soudain autrement le fils à maman. À se demander d’ailleurs si le fils à maman ne serait pas une catégorie d’auteurs littéraires à part entière — il faudrait voir s’il y a d’autres candidats que Proust et Gary, mais rien que cela, déjà, pose son homme.
Son homme ou sa femme. J’ai vu La Promesse de l’aube peu de temps après Le Grand jeu, et j’ai été frappée de cette évidence, simpliste, essentielle : le destin forgé dans l’enfance par l’ambition-pression des parents et la carence de compréhension et de tendresse qui a pu en résulter (l’amour de la mère de Gary pour son fils est si violent qu’il en est presque exempt de tendresse – un amour flamboyant, mais sans pitié). Comme si n’avoir jamais fait / été assez pour leurs parents pourtant très présents entraînaient ces êtres dans une existence d’insatisfaction chronique, une quête de puissance et de perfectionnement où la reconnaissance et l’amour seraient au bout de l’asymptote.
(Forcément, cela m’a émue lorsque Palpatine m’a confié s’être retrouvé, un peu, dans cette enfance sur laquelle pèsent tant d’espérances, dans cette hérédité de l’ambition où les parents, pour leur enfant, ne veulent pas tant le bonheur que le meilleur.)
(Cela m’a donné envie de lire Romain Gary, aussi, que j’avais toujours imaginé-rangé dans les auteurs un peu lisses de Gallimard, à la vie plus aventurière que l’écriture. J’ai commencé Clair de femme : pourquoi ne m’aviez-vous pas dit que c’était aussi bien ?)