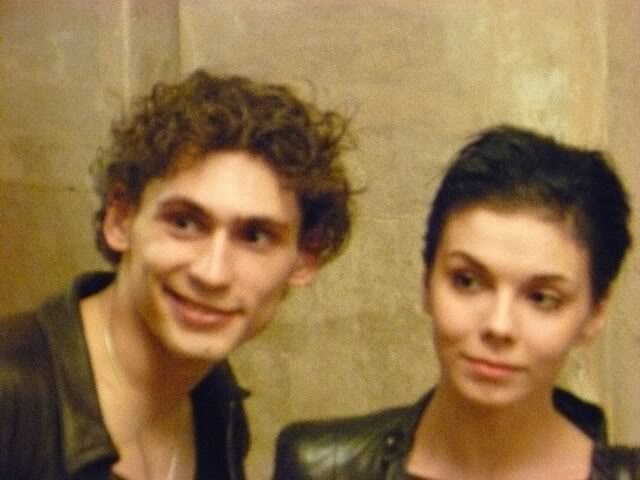De A.à Y, Y comme Youpi, je vais aller voir le gala des étoiles pour le Japon. Ni une ni deux, je rentre chez moi. Indeed, avec A. je redécouvre le plaisir de sortir, et pour cela il faut rentrer : se déshabiller prestement, courir sous la douche, passer mentalement en revue les cintres de son armoire pendant que les doigts passent entre les orteils pour tout bien savonner, et savoir en enfilant son peignoir que l’on se fera un maquillage bleu marine sur eye-liner turquoise pour aller avec les brillants marine quasi-invisibles dans la dentelle noire qu’on aperçoit dans l’ouverture échancrée de ma veste queue de pie noire. La soirée était en effet placée sous le signe de la dentelle : Pink Lady en avait sur les épaules, A. sur tout le dos de son décolleté bénitier. Autre signe de la soirée : le poisson. D’abord le sans-les-mains du pas classique, puis la version fan-les-dents mains-au-sol du Grand pas de deux comique et enfin, au café du Congrès, en soupe gruyèrée comme il se doit (elle a beau dire que j’ai vraiment un air de souris quand je suis contente, A. a montré à cette occasion qu’elle l’était au moins autant que moi). Autant dire que cette soirée se déguste dans tous les sens. Et quand je conclus « Mangez du danseur russe », sur quoi A. se récrimine, il ne faut rien y voir que ma tendance à ramener aux plaisirs de la table tout ce qui est bon. Non, vraiment, il faut importer des danseurs russes : c’est à eux que je dois les meilleurs ballets de l’année – avec la troupe de Boris Eifmann dans Anna Karénine, d’abord, découverte graalesque par excellence, puis avec le Don Quichotte du Bolchoï. Au cas où les Vassiliev de Noël seraient en rupture de stock, comme A. me l’a annoncé (mais je la soupçonne d’avoir réservé les derniers modèles) avant de me concéder Andrey Merkuriev (tu ne commences pas à regretter ?), j’ai désormais plein de jolies personnes à mettre sur ma liste. Vous allez au fur et à démesure…
Passons sur les amuse-gueules de l’école de l’Opéra de Paris, dont la démonstration n’a pas grand-chose à faire ici, à part une transition des bons sentiments (projection d’images du Japon, mode « l’eau qui dort était tellement belle », mais je ne suis pas certaine que l’usine qui respire la bonne odeur de poisson et les visages fermés comme des huîtres soient l’antithèse parfaite de la catastrophe à l’origine de la soirée) à l’artistique.
Commençons par un plat de résistance avec le sourire un peu figé de Maria Kochetkova qui résiste en effet à toutes les difficultés techniques de cette Belle au Bois Dormant de boîte à musique. Le petit côté baroque de ses bras suspendus et de sa tête inclinée me surprend, je retiens – pour le reste on connait et j’oublie la chanson.
Même prévenue par A., je me suis laissée surprendre par ce drôle d’oiseau qu’est Friedmann Vogel, capable de déployer de grandes ailes et de laisser pendre son poignet-plume sans que cela soit ridicule. Ce garçon est bondit de côté et d’autre dans son pantalon noir tout à fait seyant (justement parce que pas moulant, vous dirait A.), traverse la scène sous le coup des claques qu’il se donne (on l’entend – une des raisons pour lesquelles j’ai adoré être au premier rang, où l’on voit les visages et l’on entend les corps), hallucinant jusqu’au bout de ses doigts qui se promènent sur ses côtes. Mopey, la chorégraphie de Marco Goecke me rappelle un peu la gestuelle des Épousés de Kader Belarbi, en plus léger. Alors que le premier passage me confirmait que je ne suis décidément pas une balletomane, celui-ci me rappelle pourquoi j’aime la danse, par-delà le ballet – être fascinée par un corps et libérée par une chorégraphie. Ravie d’avoir découvert Friedmann Vogel et Marco Goecke à travers lui.
Après le drôle d’oiseau, la Chauve-Souris, Roman Lazik, que j’aurais aimé voir danser un peu plus et Olga Esina dont j’aurais aimé voir un peu moins le corps pourtant parfait, qui devient comme pesant sous son académique blanc.
Le pas de deux du cygne noir a signé la mort des volatiles et le sursis de ses deux interprètes : Fernanda Oliveira, modèle petit bolide (spécialité anglo-américaine, semblerait-il) au sourire un peu Colgate, que je préfère cependant à la rage de dents de son partenaire, Dmitry Gruzdev, un brin crispé de la mâchoire. Je ne devais pas être mieux, ceci dit, quand j’ai grimacé en espérant que la demoiselle ne se soit tordu le pied que visuellement.
Avec Sinatra Suite, on ne sait pas trop sur quel pied danser : en talons, certes, mais entre la comédie musicale américaine et le tango réinterprété par une Sibérienne loin d’être glaciale. Malgré la robe noire de Tatyana Gorokhova, très élégante avec son chignon banane, et le costume assorti pour Igor Zelensky, il y a de la violence conjugale dans leur danse de salon, distante des chansons de Sinatra qui sont enchaînées abruptement. Déconcertant, mais cela ne me déplaît pas. Avec Baryshnikov non plus.
J’ai retrouvé avec plaisir Julien Favreau du Béjart Ballet Lausanne, lumineux et donc parfaitement à son aise dans Light, duo tout en apesanteur avec Katya Shalkina qu’allongé, il tient à bout de bras à l’horizontale et descend peu à peu à lui. Doigts repliés aux lèvres et regards souvent tourné vers le public pour elle. J’aime cette épure de sensualité, blanche de toute séduction, ce pied qu’elle dépose en attitude devant dans sa main à lui.
J’ai retrouvé avec non moins de plaisir Jason Reilly dans Le Corsaire. Je n’ai pas boudé mon plaisir devant Ashley Bouder mais Polina Semionova reste mon Graal, celle qui fait dominer le féminin dans Le Corsaire. Ici, c’était dans l’ordre des choses (et des cheveux – faites quelque chose, par pitié, interdisez de les gominer) et le désordre de l’exaltation (la mienne ou celle du danseur, allez savoir) : Jason Reilly finit sa diagonale et jette à terre juste devant moi. « Celui-là, il était pour toi », me souffle A. Son tour vient à la diagonale suivante, et le dernier étalage faunesque est pour sa partenaire, tout de même. Je n’ai pas trop de l’entracte pour me remettre.
Une Dame aux camélias pour se remettre dans le bain, avec une Sue Jin Kang que sa maigreur identifie un peu trop à son héroïne, puis vient le solo de Malliphant pour Sylvie Guillem… avec Carlos Acosta. Two : deux versions, comme pour le Boléro, homme ou femme, mais surtout deux présences en scène, le danseur et la lumière. Je ne sais pas si c’était ma place loin d’être en surplomb comme au théâtre des Champs-Élysées ou la douche plus ronde que mon souvenir de double carré au sol, mais l’effet visuel n’était pas le même. Il n’empêche, la fascination est intacte : certes, la musculature de Carlos Accosta laisse s’introduire l’image du culturiste, mais c’est bien de danse dont il s’agit, et de danse archi-contrôlée lorsque le bras déplié devant lui remonte dans un ralenti accéléré de marche arrière, paume qui passe derrière la nuque tandis que la tête se détourne. Je ne vous raconte pas l’effet que ça fait, cette quasi-immobilité obtenue à force de précision et où toute la tension se trouve chez le spectateur.
On respire pour se calmer. Il y a comme une odeur de rose, d’ailleurs. A. me prévient que ce Spectre a intérêt à être bien dansé, sinon cela va lui coller le fou rire. Pas la peine, je la devance ; non pas à cause des danseurs, très bons (sauf dans le grand jeté final : c’est quoi ce saut ?) mais d’A. pendant le précipité : « Ah, oui, c’est bien le Spectre, je reconnais, c’est le fauteuil dans lequel la nana pionce et fait son rêve. » Deux gamines, oui. A posteriori, on a peut-être été très chiantes pour nos voisins.
Andrey Merkuriev et Bach nous font taire. Voilà que le matador fou de Don Quichotte est un jeune homme un peu désespéré. Lui, il est sur ma liste d’anniversaire, c’est urgent, j’ai besoin de lui faire faire des brisés battus à l’infini. Les brisés battus enchaînés sont décidément un pas de mec : non seulement parce que moi, j’ai l’air d’un bambi hippopotame quand je fais ça, mais parce que des danseurs qui font leur diagonale comme des cabris pendant la classe, c’est enivrant à regarder. Bon, j’arrête mes âneries, la chorégraphie d’Alexy Miroshnichenko (Dieu merci, je ne fais pas stage chez un éditeur de littérature russe) ne s’y prête pas .
En revanche, celle de Christian Spuck, tout à fait. Dans le noir, je lis à grand peine « Grand pas de deux », mais alors que les danseurs tardent, je commence à me poser des questions et à surveiller mes arrières dans le public. C’est seulement de côté qu’Elisa Camrrillo Cabrera lance l’offensive et les réjouissances en grimpant sur scène pour rejoindre Mikhail Kaniskin. « Je connais, je connais ! » Ce qui veut dire : tu vas voir, c’est dément. Après les ballerines-aspi et les poissons ventre à terre, voici la danseuse tortue, institutrice délurée, qui tient son sac à main par la peau de l’anse, avec à peu près autant de grâce qu’on peut en avoir à l’entracte en pinçant son programme entre les lèvres pour se laver les mains en sortant des toilettes. J’ai beau très bien savoir la prochaine ânerie que le couple va bien pouvoir
inventer, cela me fait toujours autant rire – si ce n’est plus, le comique de répétition s’accommodant très bien du rire par anticipation.
Caravaggio réinstalle une atmosphère plus sombre ou plus sobre, faudrait-il dire. Mini-tresse et curieux justaucorps formé de deux pièces de tissus amassé en bandeau autour de la poitrine et des hanches, Shoko Nakamura, le pied sur la poitrine de Michael Banzhaf part dans un lent cambré en arrière. Le même mouvement, jambe plié en attitude parallèle cette fois, clôt le pas de deux. Je serais incapable de vous dire ce qu’il y avait entre les deux, sauf que cela prolongeait la tonalité de l’épanchement pudique du cambré initial. Sauf à en connaître la chorégraphie – par cœur – on ne se souvient pas de la danse ; la faute à notre mémoire photographique (d’où l’importance d’avoir de bons photographes de danse, qui fixent nos souvenirs – moins en les figeant qu’en les déterminant).
Thaïs. Ce nom me fait à peu près le même effet qu’ « Anaïs » quand j’étais petite. Dans nos jeux avec ma cousine, il y avait toujours une bonne élève, une jolie fille, une amie intelligente et c’était toujours Anaïs, non pas à cause du parfum (qui est certes responsable de la vulgarisation du prénom) mais d’une fille de la danse, de quelques années notre aînée, juste assez pour en faire une « grande », resplendissante. Je ne vous raconte pas le dernier gala auquel elle a participé… je vais revenir à celui qui nous occupe. Si je vous dis tout ça, c’est que Lucia Lacarra est d’une certaine manière une Anaïs de la danse. Pas vraiment une star, même si elle est l’icône du Gala des étoiles au TCE : d’abord une femme, ce qui est rare sur scène où la femme est toujours en retrait par rapport à la fille-danseuse. Une femme radieuse. Elle surnage durant tout ce pas de deux avec son partenaire-radeau, mais pas un seul instant elle n’est triomphante ; seulement comblée. On le sait à son sourire qui rayonne de ses jambes-bâtonnets. Et puis il y a ce moment où son partenaire, qui tourne, la tient à l’horizontale et on ne voit plus que ses bras, ses poignets qui peignent d’invisibles cheveux et brassent l’air ondulant.
Comme en prélude au Souffle de l’esprit. J’imagine que les frères Bubenicek n’en manquent pas, ni surtout Jiri, auteur de cette chorégraphie à la fois puissante (remontée de la scène, dos au public, face aux projecteurs) et légère (détourné tourbillonnants). Je ne sais pas qui est le troisième larron, mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas Roberto Bolle, et le trio ne s’en porte que mieux.
Les Enfants du paradis ne m’a pas vraiment enthousiasmée, j’espère l’être bientôt davantage par le spectacle en entier (parce que bon, l’Opéra présente ce qui est en répétition, dès fois que cela fasse travailler autre chose et constitue une récréation tout à fait appropriée à l’esprit du gala…). J’ai passé le solo-duo-solo à me demander pourquoi Mathieu Ganio ne me faisait strictement aucun effet chorégraphiquement parlant et à regarder Isabelle Ciaravola en coulisses bouger ses épaules pour rajuster sa magnifique robe rouge (doublée de noir).
Et puis, pour m’achever : Andrey Merkuriev dans Don Quichotte. Le toréador promu en Basile, c’est totalement jouissif. Moins bourrin qu’élégance fougueuse, en fait (ah, le cheveu fou, c’est ce qui manquait à Jason Reilly, définitivement). Je crois que je ne me suis toujours pas remise du regard en coin, insolent, joueur et provocateur à le réception d’une tripotée de pirouettes. À genoux. Moi juste devant. Et sa partenaire… Evgenia Obraztsova est peut-être la plus belle fille du monde. Tout simplement. Même avec des mèches en accroche-cœur autour du visage. Une bouche immense et un sourire à tomber à la renverse. Me voilà encore grisée pour plusieurs jours. Importez du russe, que je vous dis.
Minuit, pas de Cendrillon, juste la souris du carrosse qui continue de grignoter la nuit, en son creux, quelques heures encore d’intraordinaire, avec une nappe blanche, de la tapenade, des rencontres imaginaires, du pain de seigle tartiné de beurre du bout du couteau, des yeux bleus au milieu d’un visage marqué par la fatigue et la sérénité, des escargots, des histoires de collant et de plus-que-beau, plus-que-belle. Sur le retour, une voiture de policiers demande « il fait nuit, non ? » ; sûr, il n’a pas vu les étoiles.